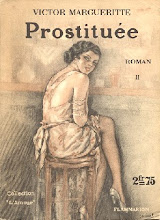Le téléphone fixe sonne.
Et j’aime pas ça.
Je suis moderne moi, ça y est, et pour cette raison, je ne suis joignable que sur une machine de communication que je transporte, c’est à dire qui est portable puisque je ne fais que me porter moi-même ça et là du matin au soir et qu’il paraît qu’on doit être joignable tout le temps.
Chez moi, il est parfaitement impossible que je discute. Quand j’y suis, chez moi, c’est pas pour parler de la vie, en bien, en mal, en long ou que sais-je, à l’horizontale; quand je suis chez moi, c’est pour être chez moi.
.
Un point s’impose, ici.
Pour marquer à quel . c’est définitif cette opinion et ô combien personne ne me fera revenir dessus.
Mais le téléphone fixe sonne. Quand même.
Je ne connais pas cette sonnerie, je pars alors à la recherche d’un réveil que j’aurais camouflé, hier, dans l’idée de me piéger moi-même pour m’obliger à le trouver et donc à sortir de mon lit. Cette hypothèse est assez vite discréditée par l’oeil que je pose sur l’heure: 01h31.
Or, je ne mets pas de réveil à cette heure là, ou du moins: pas encore. Ou du moins pas que je sache.
Et puis voilà, c’est incontestable, rendons-nous à l’évidence: le socle du téléphone clignotant avec le même empressement que mettrait un oeuf dur à sautiller au fond d’un casserole une fois cuit, je suis forcée d’admettre que c’est ça: c’est le téléphone. Le téléphone fixe donc.
Me fixe de son combiné hurlant, comme ça, caché sous la couette, avec ses yeux affamés, sans gêne.
Qu’est ce qu’il fait, là, je me demande, et à quand remonte la dernière fois où je l’ai utilisé, tout ça. C’est fou tout ce que la tête est capable de produire comme pensée le temps de 4 sonneries.
Se proposent alors d’elles mêmes deux possibilités:
-laisser sonner et interroger le répondeur pour savoir quel malfaiteur a malfait.
ou
-répondre et prendre l’incroyable risque de ne pas pouvoir couper court grâce aux stratèges habituels qui consistent à prétendre ne plus avoir de batterie ou ne plus capter ou se faire voler l’appareil à l'arraché, bon.
San compter qu’à cette heure ci, il est assez peu probable que mon interlocuteur soit une de ces crapules facilement blackboulables qui voudrait me vendre des double vitrages ou des lots d'encyclopédies universelles; travailler + pour m’emmerder +, soit, mais pas la nuit, quand même.
Ok, on respire et on décroche, c’est aussi simple que ça, allons-y, t’es cap’.
Je ne connais pas la voix, je ne connais pas le prénom mais je reconnais cette sensation de danger, latent, d’inconnu brûlant, attractif comme le vide d’une falaise d’Etretat.
Je sais que tout ça ne vaut rien de bon.
-... et donc voilà, Manon. Je m’appelle Vincent, au fait. Et je me demandais si vous aviez un peu de temps pour discuter...
-...
-Vous m’entendez?
-Heu, oui. Oui-oui.
-Mais vous ne m’écoutez pas?
-Heu, non. Pas trop, non.
-Pourquoi?
-Pourquoi? Ben, peut-être parce qu’il est minuit passé, que je ne vous connais pas, que vous arrivez chez moi d’un coup sans prévenir en connaissant mon prénom et que, comme je l’expliquais plus haut, personne ne fait ça, on ne m’appelle pas chez moi si je n’en n’ai pas formulé clairement l’envie. Par exemple.
-Vous expliquiez ça où ça, plus haut?
-Plus haut dans le texte.
-Dans le quoi... ? Ah! vous aussi vous avez des troubles psychologiques?
Mon coeur s’emballe, même s’il fait ça souvent, à chaque fois ça me turlupine un peu plus, ce qui a pour effet de lui mettre la gomme davantage encore, et ça ne s’arrête jamais. Certains jours, ma vie ressemble à s’y méprendre à un serpent qui se mordrait la queue. Une vipère, le serpent. C’est pas beau à voir, j’vous dis que ça.
Je lui dis:
Des troubles psychologiques... Et bien, et après? Qui n’en n’a pas? Faudrait être déjà à moitié mort pour ne pas être psy-cho-lo-gi-que-ment atteint, faudrait être de marbre pour ne pas s’attrister dix fois par jour, se révolter au moins autant, et baisser les bras également, un peu plus touchée, abîmée peut-être même, soyons fous. C’est un signe de santé que d’être un chouia malade, voilà ce que j’en pense.
C’est bien simple, si je n'entretenais pas ma bonhomie et mon sarcasme avec du baume du tigre, quotidiennement, de haut en bas en insistant sur les zones concernées, si je ne riais pas de tout, je serais maboule. Si on n’a pas d’humour, aujourd’hui, on ne peut être que terroriste.
En fait, non, je n’ose pas dire tout ça, je me contente de:
-Comment ça des troubles psychologiques? Non, d’ailleurs, je veux dire: comment ça «moi aussi» j’ai des troubles psychologiques? Vous voulez dire que vous en avez, vous?
-Je vous l’ai dit, mademoiselle, je sors de prison et d’un traitement de cheval. Alors si je n’en n’avais pas forcément avant, je suis assuré d’en avoir aujourd’hui.
Il m’a dit ça? , j’ai pas entendu. Mon coeur s’emballe même plus, clairement, il se prend pour Dave Grohl.

-Attendez, heu...
-Vincent
-Vincent, écoutez. Je suis pas. Voilà. Bon.J’ai pas de problèmes particuliers avec la prison, les gens qui en sortent, ceux qui y rentrent... m’enfin bon, quand l’un d’eux m’appelle chez moi alors que je ne le connais pas...
-Vous comprenez pas.
-Bah ce que je comprends c’est que c’est bizarre, déjà que je parle jamais dans ce téléphone là, fixe et tout, que j’ai l’habitude d’être... je sais pas ... dans la rue, quand je suis au téléphone, là, je vous le dis tout net, j’ai l’impression que vous êtes dans mon salon. Et j‘ai connu des sensations plus agréables pour ne rien vous cacher.
-Vous comprenez pas.
-Mais arrêtez de me dire ça, c’est vous qui comprenez pas. Vous êtes chez moi, là, dans ma vie. Y’a a assez de parasites comme ça sans vous, j’vous jure. Sans vous manquer de respect mais quand même, merde.
-Ne soyez pas grossière.
-... Ah bah! Ca alors. V’là que vous me donnez des leçons maintenant.
-Ca ne vous pas, la vulgarité, c’est tout.
-Ah super, je vois le genre, vous me connaissez un peu comme si vous lisiez en moi un peu comme si j’étais un livre ouvert et d’ailleurs un peu comme toutes les femmes, c’est ça? Vous trouvez que les gonzesses qui fument et qui boivent et qui jurent, ça craint, c’est ça? Vous êtes mal tombé: ça occupe précisément les 3/4 de mon temps. En sachant que le 4° quart est consacré à me moquer de l’humanité et à dormir. Alors vous voyez, trouvez quelqu’un d’autre à qui raconter vos histoires de savonnettes.
-Mais, vous êtes très agressive; je ne comprends pas.
-Ah je croyais que c’était MOI qui ne comprenais pas, faudrait savoir.
-...
-Ok. Bon, écoutez. C’est ce qu’on appelle une conversation stérile, je vais devoir vous laisser, je n’ai plus de batterie.
-Vous ne comprenez pas, j’ai eu du mal à vous trouver.
-Du mal comme: taper un prénom sur les pages jaunes et tomber sur mon numéro? Non parce qu’en ce moment, justement, j’évite un ado pré-pubère qui s’acharne sur mon zéro un et qui ne m’amuse plus trop et il ne m’a pas cherchée ou trouvée ou eu du mal ou je ne sais quoi, ses parents ont eu le malheur de laisser traîner un un bottin et il m’emmerde. Point.
-Ah, un ado vous harcèle?
-Oui, c’est un enfer sur pattes. Il a une voix de castra, on entend l'acné qui bouillonne, c’est vous dire. Et il veut dire des trucs cochons, mais comme il en n’a pas encore fait, des trucs cochons, il est juste... assommant.
-Je vois.
-Ce que vous voyez c’est que vous venez de me conforter dans l’idée de passer sur liste rouge et pourtant, vous voyez, c’est quelque chose que je me refusais à faire, «passer sur liste rouge». Je suis pas président public, c’est absurde, je n’ai aucune raison de recevoir des coups de fils de paumés de la vie qui veulent me pourrir mon existence. Enfin ça c’est ce que je croyais. La preuve en est, j’ai eu tort.
-Je suis cette preuve?
-Ne jouez pas sur les mots, pour quelqu’un qui sort de prison, je trouve ça limite.
Il rit, le bougre.
-Je n’y avais même pas pensé, voilà, là je vous retrouve!
M’a-t-il seulement trouvée?
-Vous me retrouvez rien du tout, vous me souhaitez bonne soirée et vous me laissez tranquille jusqu’à la fin du monde.
-Je vous fais peur?
-... Vous avez failli, oui, mais là vous passez à une autre catégorie: comment pourriez vous ne PAS m’inquiéter? Le fait que vous ne le conceviez pas m’abasourdit d’agacement. Donc vous ne me faites plus peur, vous m’enquiquinez. Mettez vous à ma place, un peu.
-Très bien, oui, non, je veux dire, je comprends.
-Bon voilà, parfait, alors heu... enchantée, bonne soirée, et là je vais raccrocher.
-Et vous traitez tous vos lecteurs de la même manière?
Mes lecteurs? Tiens donc. Pour qui me prend-il au juste? Est-ce qu’il me confond avec quelqu’un qui écrit, quelqu’un de super, quelqu’un de l’académie, qui aurait reçu un prix, qui connaîtrait Pivot, qui a sa photo ringarde en dernière de couverture, qui, qui, qui... pour qui me prend-il ?
-Et bien, écoutez, (je racle ma gorge et prend un air de princesse, ou, en tout cas, l’air que j’imagine le plus seyant pour une princesse), non. Pas du tout. Mais là, vous voyez, je suis débordée.
Quand on prend un air, l’intonation suit naturellement, c’est un truc que je vous donne parce que je suis de nature généreuse: - > prenez un air de princesse et spontanément vous aurez une élocution précieuse que vous ne vous connaissiez même pas. Ca marche à tous les coups.
-Ah oui? Vous êtes sur quoi?
-Et bien, c’est un peu indiscret comme question mais j’accepte de vous répondre: je suis sur un roman, encore. C’est à dire... non, pas «encore», mais «toujours» pour être précise.
Je me tiens debout devant mon miroir, l’audience est au max, les gens s'appellent pour se dire que jamais aucun auteur n’a été si détendu face à son succès mondial, tout le monde zappe pour moi, je baisse la lumière pour essayer de me trouver pas mal, voilà, je suis pas mal, je suis même mieux que pas mal dis donc, le monde est à moi, balancez donc vos bouts de papiers et vos preum’ de couv’ comme on dit, je suis chaude pour une petite session d’orthographe, heu pardon, hi hi, blague d’écrivain, je voulais dire «d’autographes».
J’aurais pas pu vivre cette situation avec un téléphone portable dans la rue, ça c’est sûr.
-Ah parce que vous écrivez des romans? C’est bien, ça me rassure; enfin, me rassurer est un bien grand mot, non pas que je m’inquiétais, mais je me demandais si vous faisiez un peu d’efforts quoi, un truc vraiment, comment dire, construit.
-Hein? De quoi? Qu’est ce que...
Les princesses ne parlent pas comme ça, Manon, les princesses ne font pas répéter, les princesses ne font pas d'onomatopées avec leurs bouches pures, les princesses ne sont pas prises au dépourvu, les princesses doivent bien se moquer de toi à l’heure qu’il est.
Je ne comprends décidément rien à cette conversation. Est-ce seulement une conversation? Qui suis je où vais je est ce qu’il reste du vin?
-Je trouvais tout ça très prometteur, c’est tout.
Pivot m’encourage, avec son air de grand père idéal, lui aussi il me trouve prometteuse, c’est évident, il m’invite d’une moue inimitable à y aller, à penser que oui, en effet, je suis «du genre très prometteur».
-Oui, merci, c’est ce qu’on a déjà dit à mon sujet.
Pas sûre sûre de mon coup, je rajoute:
-Enfin, surtout dans des critiques new-yorkaises, en fait, vous voyez.
Je transpire.
Est ce que les princesses transpirent? Non? Même quand elles font l’amour?
Si Pivot pouvait aussi me dire avec quel genre d’auteur le criminel me confond, ça m’ôterait une épine du pied dans le plat.
-Tiens alors justement je me demandais si vous aviez besoin de contacts ou je ne sais pas, de numéros, pour, vous voyez... rencontrer des gens. Des gens du milieu.
Des contacts, moi? Mon petit, je n’ai que ça, des contacts, j’en déborde, je ne sais plus qu’en faire, et finalement c’est moi qui deviens LE contact des autres, alors sincèrement, vos contacts...
-Des contacts? Et bien, oui, pourquoi pas.
-Non parce que je sais que le blog est un art encore assez peu considéré, et je trouve que le vôtre mérite qu’on s’y penche, il y a quelque chose à faire, c’est pour ça que je suis ravi de savoir que vous avez en fait déjà publié des romans. Où puis-je les trouver? Vous me donneriez les références?
-Mon blog????
-Oui, votre blog.
Pivot, l’audience, mes fautes d’autographes, tout, tout s’écroule dans un bruit de flaque à peu près équivalent à ce qu’aurait fait la quantité d’eau que mes larmes produiraient s’il ne fallait pas que je garde la face, là.
-Ah ouiiiiii, bien sûr, vous voulez dire «mon blog» !
-Oui... ? Ben, votre blog, oui.
-Oui, oui oui oui.
Garder la face au téléphone, c’est quand même plus facile.
-...
-Oui oui oui. Oui.
Mais bon.
-Alors, est ce que vous me donneriez les références de vos romans? Je peux vous le dire, je suis ce qu’on appelle un fan inconditionnel, et j’assume hein. En fait, c’est drôle, après 5 ans en prison, il me restait plus grand chose, bonne conduite, tout ça, et je suis passé assistant du prof de français et grâce à ça, j’ai eu accès à internet. Je ne sais pas trop comment, je suis tombé sur votre blog ... l’expression est éventée, mais c’est pourtant ce qui image le mieux ce que j’ai ressenti à ce moment-là, vous m’avez mis une claque. Aller-retour.
-Ah oui.
Sans point d’interrogation, sans point d’exclamation, non, un «ah oui» sans rien, comme ça, neutre, suisse, désillusionné et les bras ballants, un «ah oui» qu’a une seule envie c’est qu’on le laisse tranquille et qu’il puisse rentrer chez lui se coucher. Ah oui.
J’essuie mon plancher, lave mon égo, prend un bain d’humiliation.
-Vous semblez.... ailleurs...
-Pffff
Tant pis, je dis tout, je m’en fous, je suis qu’une crotte de mouche là, je vais pas faire ma pimbêche.
-Ailleurs, c’est faible. Enfin, à moins que vous considériez la situation de ma dépouille 30 mètres sous le sol déjà rongée par des insectes carnivores moqueurs... Alors oui, je suis «ailleurs», en effet.
-Mais c’est dingue comme vous passez d’une émotion à une autre.
-Vous trouvez?
-C’est rare. D’habitude, les gens sont remplis d’eux-mêmes, ce qui les empêche de ressentir tout l’extérieur et...
-Ok, on arrête, là.
-On arrête quoi?
-Je suis pas sensible à l’extérieur,je suis rien du tout, j’ai juste cru que vous m’aviez confondue avec un auteur renommé. Je suis égocentrique, voilà tout, ok?
-Mais, je ne vous ai pas confondue...
-Pffffffff. Je n’ai écrit aucun roman, vous saisissez? J’en ai deux, dans les tiroirs, ils m’emmerdent et personne n’en n’a jamais vu la couleur. Vous comprenez, là?
-Ah... Vous...
-Ah oui oui, j’ai cru que vous me confondiez et j’ai aimé la confusion.
- «Confusion» me fait toujours penser à «Confucius», pas vous?
-Non. Mais allez-y vous, écrivez un roman, et je vous appellerai pour vous féliciter, voilà, très bien, on fait comme ça, bonsoir.
-Je ne comprends pas...
-...Oh v’là que ça vous reprend. Merde quoi.
-Et vous, vous redevenez vulgaire.
-Je ne sais plus quoi vous dire. C’est bizarre. A un inconnu, je veux dire, à vous, en somme, si je n’ai plus rien à dire... Non, c’est pas ça je m’emmêle les pinceaux.
-C’est le propre de ceux qui dépeignent la réalité.
-Oh arrêtez deux minutes, c’est bon.
-...
-En tant qu’inconnu, je ne devrais pas «ne plus savoir que vous dire» mais «ne rien avoir à vous dire» et je raccrocherai et on en parlerait plus et puis c’est marre.
-Vous avez encore des choses à dire?
-Non, moi non, non. Mais vous, peut-être non?
-Oui, moi oui. Oui.
-Ok.
-Oui.
-Et donc, là, il se passe quoi? Vous me les dites ces trucs ou je dois vous envoyer un bristol?
-Non mais je pensais juste que ça ne vous intéressait pas, c’est tout! Une personne de votre envergure. Moi en face. Un type qui sort de prison. Enfin vous voyez.
-Oh arrêtez un peu, je vous ai dit que j’avais rien publié, que j’avais fait semblant et même pas correctement. Alors dîtes tout ce que vous voudrez, faîtes vous plaisir, c’est vous qui payez la communication de toutes façons.
-J’ai l’impression que vous ne comprenez pas.
-C’est une blague?
-Ah? Vous comprenez en fait?
-Non: c’est une blague que vous disiez encore «vous ne comprenez pas»? C’est fait exprès pour m'énerver c’est ça?
Les dialogues me fatiguent, au bout d’un moment, au bout de ce moment là, en tout cas. Quand ils tournent en rond et quand, en parallèle, ils sont assez taquins pour chatouiller vos entrailles. Ils me fatiguent.
Je n’ai plus envie de parler avec lui, ni non plus envie d’écrire ce qu’on s’est dit avec des tirets à la ligne et des italiques, parce que, finalement, aucun des deux n’écoutait vraiment l’autre. Ce qui est le propre des dialogues qui durent trop longtemps, de tout ce qui dure trop longtemps.
Il m’a dit que je devrais surtout considérer le fait que quelqu’un soit tombé sur mon blog et l’ait aimé, aimé au point de trouver mon numéro. Ce à quoi j’ai répondu des trucs que même le ras des pâquerettes ne cautionneraient pas, toute pragmatique que j’étais, incapable de m’élever un tant soit peu, au moins jusqu’à l’absurdité de la situation.
Au point que j’entendais même pas ses compliments.
Il m’a dit que je devrais entendre que j’ai été lue en prison, et que mon lecteur n’avait qu’une idée en tête: me trouver pour parler avec moi.
Et moi, pendant ce temps, je pensais que j'étais une nulle de l’avoir accueilli de la sorte. J’écoutais pas. Ca ne m'intéressait pas plus que ça, certainement.
J’avais cru à un rôle, un scénario, et je me retrouvais face à quelqu’un qui voulait parler de ce que j’écrivais. J’ai été simplement capable de dire:
-Si je l’écris c’est que je n’ai pas envie d’en parler. Alors, parler de ce que j’écris... Vous comprendrez que.... Vous êtes allé en prison pour quoi?
-Si je vous le dis, est ce que vous écrirez quelque chose sur moi?
-Je ne peux rien vous promettre, mais il y a de fortes chances pour que vous vous reconnaissiez dans quelques lignes.
-Vous écrirez sur mon crime?
-C’était un crime?
-On dit «crime» aussi pour un vol de sac à main vous savez.
-On ne prend pas 5 ans pour un vol de sac à main.
-Vous m’avez écoutée alors?
-Voilà que ça recommence...
-Qu’est ce qui recommence?
-Le dialogue. Les tirets. La ponctuation et chacun son tour, tout ça.
-J’ai tué une personne.
-Une seule? On tue tous des personnes tout le temps, au moins ceux qu’on aime. Une seule, c’est pas non plus...bon...pas la peine d’en faire une histoire, quoi.
-Je l’ai tuée avec mes mains. Elle est dans un cercueil.
-Ah, vous voulez dire, un crime?
-Un vol de sac à main est un crime.
-La plupart des sacs à mains volés sont eux-mêmes criminels: un cuir douteux, une atteinte au bon goût, infectés de répertoires remplis d’une famille sur qui on ne peut pas compter, de clés d’un appartement trop grand, de carte ump... pour moi c’est pas un crime, c’est un devoir civique, de les voler, ces sacs à mains. Ca leur permet de repartir à zéro.
-Oui mais moi j’ai tué quelqu’un.
C’est vrai, il a tué quelqu’un. Pour de vrai.
Si je voulais être certaine que vous vous rendiez compte de ce que ça signifie, je l’écrirais plein de fois. Pour que vous ne passiez pas à la phrase d’après sans percuter, pour que vous ressentiez, un peu, de ce que j’ai ressenti quand il me l’a dit, c’est à dire un quart du tiers du centième de ce qu’il a ressenti, lui, quand il l’a fait.
C’est vrai, il a tué quelqu’un. Pour de vrai. C’est vrai, il a tué quelqu’un. Pour de vrai.
C’est vrai, il a tué quelqu’un. Pour de vrai. Pour de vrai. Avec ses mains. C’est vrai, il a tué quelqu’un, c’est vrai de vrai. Pour de vrai. Il a tué quelqu’un. Pour de vrai. Avec ses mains. C’est vrai, il a tué quelqu’un. Pour de vrai. Avec ses mains, à lui. C’est vrai, il a tué quelqu’un. Il doit vivre avec. Pour de vrai.
Il aimait une femme. Ce qui en soit est déjà assez extraordinaire. Non, parce que, je veux dire: il aimait une femme. Pour de vrai. C’est vrai. Il aimait une femme. Avec ses mains. Pour de vrai.
Pas juste une fille qui lui tenait compagnie, un peu drôle, un peu jolie, un peu aimable, avec qui le temps passe tant bien que mal, non, non. Il aimait vraiment une femme. Et, asseyez-vous: il aimait une femme qui l’aimait. Pas comme ça, en passant. Ils s’aimaient comme c’est pas possible.
Et puis il a fini par ne plus l’aimer, elle, à force d’avoir peur de toutes les femmes, en elle.
Là, je l’ai interrompu, je sais, c’est mal, il ne l’a pas pour autant mal pris, il a compris que j’étais dedans, investie, attentive, curieuse, spontanée donc.
-...J’ai commencé à ne plus pouvoir supporter une minute passée sans elle, je ... je devenais fou, je l’imaginais faire l’amour avec tout le monde...
-C’est dingue parce que justement il y a un documentaire sur L’Enfer qui vient de sortir.
-L’enfer?
-Le film de Clouzot. Qu’il n’a jamais terminé. L’histoire d’un homme amoureux, mais jaloux. Jaloux davantage.
-D’où le titre?...
-D’où le titre oui.
Il m’a dit que c’était bien trouvé comme titre, parce qu’en effet, l’enfer, c’est exactement ce qui arrivait quand un homme perdait la tête par jalousie. Comme une maladie qui nous laisserait trop normal pour être soigné et trop fou pour s'en sortir. L’enfer pour tout le monde, pour la femme aimée-pure-pute-infidèle-parfaite, pour l’homme triste-triste-amoureux-triste, et pour tous les gens autour. Même pour le fleuriste, ça devenait compliqué.
C’est d’ailleurs là que ça avait commencé. Ou terminé. Tout dépend du point de vue et si on croit en dieu tout puissant.
-Vous croyez en dieu?
-Je ne sais pas, il y a des gens qui méritent le paradis dans votre histoire?
Elle aimait acheter des fleurs, elle avait un compte, elle payait à la fin du mois, parfois un peu en retard mais rien de grave. Une vie trépidante en somme. Lui, Vincent, un jour, il l’accompagne, sa femme adorée. Ca faisait quelques temps qu’il voulait savoir à quoi elle passait ses journées et quels hommes posaient les yeux sur son corps.
La boutique est magnifique, ça il s’en souvient, un fleuriste qui aimait son boulot, il dit. On aurait pu croire qu’on arrivait chez quelqu’un, il rajoute. Chez quelqu’un où on aurait aimé prendre le thé, parler de la vie, passer le temps.
Le bouquet de sa femme vénérée est prêt, là, scintillant sur le comptoir; ses fleurs préférées; le fleuriste et elle ne se parlent même pas; à peine elle rentre qu’il le lui tend, le bouquet fatidique et elle n’a pas à le payer.
Ils sortent.
C’est tout.
Ils sortent. Vincent, à ce moment là prend conscience de toutes les veines de son corps. Elles le brûlent. Il trouve le temps de se dire que, le corps humain, c’est bien pensé, ça irrigue tout, mais malheureusement, y’a un défaut de fabrication, c’est que ça ne ferme pas les vannes qu’il faudrait assécher, parfois, en cas de coup de sang.
Je l’interromps une seconde fois, je suis encore plus investie et spontanée et attentive et curieuse et impolie que tout à l’heure; je l’interromps.
-Ca nous rappelle qu’on n’est que ça. Dès qu’on est dépassé, le corps parle plus fort que la tête, le coeur brinquebale, les tempes tambourinent, les veines sursautent, les joues s’empourprent, les mains tremblent, les jambes flagellent, la bouche s’assèche, les pupilles se dilatent....Parfois les sexes bandent aussi.
Et puis là, quand même, je me dis que je m’emballe un peu trop face à quelqu’un qui confie son crime, je serais pas une bonne psy, ça c’est officiel. Alors je me tais.
-C’est ça. C’est exactement ça.
-Oui, le corps prend toujours le dessus quand la tête sait plus comment gérer.
Une voiture arrive de loin, à toute berzingue, sa femme amour de sa vie va pour traverser sans se rendre compte du chauffard, toute préoccupée qu’elle est à humer l’odeur du diable de ses fleurs de malheur de ce connard de fils de pute qui la baise quand? où? dans quelle position? est ce que c’est mieux qu’avec lui?
Tandis qu’elle avance, il se dit qu’elle a raison d’aimer les bégonias. Ceux-là vont parfaitement avec sont teint et c’est ce qu’il mettra sur sa tombe. Il sait pas pourquoi il se dit ça puisqu’il est hors de question qu’elle meure, puisque si elle meurt, il n’est plus rien, et en se disant ça, alors que la voiture fait crisser le pneu comme une dégénérée, son bras part pour la rattraper, agripper le bout de veste rouge et la ramener jusqu’à lui pour qu’elle ne se fasse pas... En partant, son bras, bizarrement, comme ça, soldat esclave d’une partie de son cerveau qu’il n’avait que trop mal écoutée jusque là, son bras la pousse, légèrement. Juste ce qu’il faut. Un chouia.
Pendant qu’il me raconte, je me sens vide. Vide de ce genre d’expérience. Je ne dis pas que j’en veux, je ne dis pas qu’il faudrait que je le vive pour comprendre mais, justement, n’ayant rien vécu d’approchant de ça, je suis juste vide. Son angoisse me remplit. Je suis son putain de réceptacle. Il est la falaise d’Etretat, je le savais.
Son bras la pousse, elle glisse, la voiture fait comme si elle essayait de l’éviter mais ne feinte pas la fuite, en revanche. Il s’en fiche; il est déjà en train de se demander s’il y a des témoins, si la plaque a été relevée, il est déjà en train d’espérer que le chauffeur était ivre autant que sa conduite pouvait le laisser entendre et qu’il n’aurait qu’un trou noir à la place de ce souvenir en guise de témoignage.
Et c’est ça, c’est simplement ça qu’il ne se pardonne pas.
Le geste de son bras, la jalousie, c’est de l’anatomie, il n’y pouvait rien. Mais, quand tout le monde se précipitait autour d’un corps tressaillant de derniers souffles, lui, il pensait à son alibi. Il était donc un criminel. C’est ce qu’il pensait.
Il a arrêté de parler. J’ai regardé l’heure. Non pas que je m’ennuyais, non, je sais pas... le corps encore une fois, qui décide pour la tête: j’avais besoin d’un rapport au concret et je l’avais: troisheuresvingt.
-Je me lève dans 6 heures.
Voilà ce que j’ai dit.
Je voulais croire que tout ça, la routine, les horaires, le travail où, non, Manon, on n’arrive pas en retard 4 jours de suite, non, le métro, les cigarettes qui n’en finissent plus d’augmenter... ça prenait le dessus. Je voulais me convaincre que ce qu’il me disait n’était pas la seule chose importante, qui nous rendait tous impotents, dans nos transports publics et nos petites relations réchauffées.
-Je me lève dans 6 heures.
-...
-Et vous à quelle heure vous vous levez d’ailleurs le corps après ils en ont fait quoi vous l’avez accompagnée à l'hôpital ou alors vous vous êtes dit que c’était plus qu’un corps vous vous êtes demandé si vous seriez encore amoureux un jour je sais pas vous avez eu envie de tout changer de tout recommencer vous l’avez touchée quand elle était encore chaude? Bref, je me lève dans 6 heures.
-Je ne me lève plus jamais moi vous savez.
-Vous avez été touché aussi? Vous êtes en fauteuil?
-J’aime votre enthousiasme à toute épreuve.
-Vous êtes une falaise d’Etretat.
-J’aime vos métaphores.
-Vous êtes en fauteuil roulant? pourquoi vous ne vous levez plus jamais?
-Parce que je ne peux plus me coucher, je ne dors plus.
-Ah. Ok.
-Ne vous sentez pas bête.
-Si vous me dîtes de ne pas me sentir bête c’est que trouvez qu’il y’ a matière à ce que je me sente bête.
-Non.
-Si.
-Non.
-Bref, de toute façon on ne parle pas de moi et je lève dans 6 heures mais comment vous êtes vous senti, vous l’avez touchée, est ce qu’elle a compris que vous l’aviez poussée, est ce que...
-...Vous êtes loin d’être bête, vous êtes anatomique et vous comblez ça par une grande intelligence.
-Ok, je me lève vraiment dans 5h57.
-Je vous raconterai la suite demain, si vous voulez.
J’ai utilisé le ton que j’avais entendu et admiré dans les polars des années 60, quand on demandait à une femme quelque chose d’incroyablement crucial pour l’intrigue, le scénario, alors que depuis le début, tout ce qu’on voulait d’elle, c’est qu’elle ne rentre pas trop dans le cadre et que, quand c’était indispensable, alors qu’elle mette une jolie robe et qu’elle bosse son roulement de hanche, merci bien. En général, vérifiez si vous voulez, la dame, à ce moment précis, n’est pas apprêtée comme en 40. Elle sort du lit, ou peut-être qu’elle est fatiguée par les desiderata masculins qui grouillent sous ses jupons. Alors, elle dit, en sachant que le spectateur la comprend avec un simple geste, consciente de la conséquence que sa respiration salvatrice peut insuffler, perspicace sur l’impact de l’anatomie sur le cortex, elle dit:
«Voyons ça demain, très cher, si vous voulez bien».
-Vous avez mon numéro, j'ai cru comprendre.
-Vous répondrez?
-J’aurai peur que ce soit l’ado qui dit «enculade» au lieu de «sodomie» pour me choquer mais oui, je prendrai le risque.
-Ca me fait plaisir, pour un écrivain.
-Oh, on a dit qu’on arrêtait avec ça, s’il vous plaît.
-On pourra se tutoyer demain?
-Je ne sais pas. On est aujourd’hui. Je ne fais pas de promesses que je ne suis pas sûre de tenir. C’est une règle que je me suis imposée dernièrement.
-Vous êtes un phénomène.
-Par exemple, ça, vous me l’auriez dit en me tutoyant, j’aurais trouvé ça nul.
-Je vous vouvoie toujours si vous voulez.
-Dites moi, vous n’avez pas prévu de tuer une autre femme hein? Non parce que, moi, perso, j’ai encore deux-trois choses à faire à faire, donc ...
-Deux trois romans par exemple?
-Je ne sais pas. Deux trois trucs, quoi. Passer au pressing, faire mes ongles. Acheter des fleurs. ... Je peux faire cette blague?
-...
-Vous ne dites plus rien donc j’ai peur.
-Peur de quoi?
-De vous avoir blessé. Ou que vous me blessiez, bientôt. Oui, bah pardon, mais j’ai le droit d’être sur mes gardes quand même.
-Des blagues. A ce sujet. Au sujet des fleurs. Tout ça. C’est ça qu’il me faut! Comme vous dîtes, si on n’a pas d’humour, on ne peut être que terroriste.
-Comment vous savez que j’ai dit ça?
-C’était plus haut, dans le texte.
-Je raccroche, Etretat.
-A demain?
-Si je ne suis pas là, j’aimerais bien que vous parliez sur mon répondeur. Je déteste mon téléphone fixe, mais j’adore qu’on y laisse des messages.
-Vous avez vraiment envie de connaître la suite, hein.
-J’ai surtout envie de connaître votre fin.
Chacun de nous est resté avec le bip bip lancinant de la communication interrompue alors qu’on était encore connectés.
Il y a des hommes, dans la vie réelle, qui tuent par amour, alors, faut croire.
Et, on dirait bien qu’il y a des femmes qui aimeraient savoir ce qui dérape, quand le seuil de plénitude est atteint. Des femmes qui, peut-être, ne savent que trop bien que le bonheur n’est qu’une bande annonce.
Nos films ont des longueurs, des crevasses, des travers, des silences et beaucoup, beaucoup, beaucoup de méandres.
-maispastrop-
c.e.s.t.a.d.i.r.e.p.l.u.s.t.a.r.d.c.e.s.t.b.i.e.n.p.o.u.r.l.e.s.u.s.p.e.n.s.e.