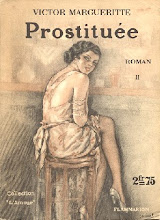les films n’ont plus de couleurs et les conversations sont sans goût.
Le froid ne fait que me frôler. Quand on me bouscule, mon corps reçoit le coup et se plie, indolent, sous l’impact du choc sans vraiment le réaliser. Mes pas reprennent le rythme, et continuent. Je n’insulte plus ces gens là.
Je voulais les tuer, avant. Je rebroussais chemin et leur attrapais le bras en leur servant, l’air le plus acariâtre possible : «Vous me bousculez parce que vous pensez que ça me fait plaisir ou parce que vous n’avez aucun sens commun? Vous voulez que je vous montre ce que ça fait? -je les bousculais- et si je pars sans m'excuser, vous voulez savoir ce qu’on ressent?» et je partais sans m’excuser, donc.
Parce que bon. Ca allait deux minutes. Sûr qu’ils bousculeraient plus jamais personne, au moins.
Ca me prenait un temps fou tous ces règlements de compte.
J’expliquais au serveur qu’il y avait de fortes chances pour qu’il voit son pourboire faire peau de chagrin s’il me servait mon café au bout de 15 interminables minutes en me le renversant à moitié sur les genoux sur une table qu’il avait jugée indigne d’être nettoyée.
Quand un vendeur s’étonnait de mon refus d’acheter finalement un pull qu’il venait de trouer en ôtant l’antivol, je lui demandais si, lui, il l’aurait acheté. J’étais impliquée dans la vie, quelque chose de fort.
S’il me répondait qu’il s’en moquait et que j’avais qu’à aller ailleurs, je prenais quelques minutes, encore, pour lui demander s’il était heureux de travailler comme ça, s’il pensait pas qu’en étant plus aimable, il aurait plus souvent la possibilité d’être aimé.
J’étais dans la vie, tout au milieu, noyée, à m’accrocher désespérément à l’idée qu’en fait, au fond, les gens étaient intrinsèquement bons. Forcément. Et qu’il fallait essayer.
Pour qui je me prenais?
Non, c’est pas la question; c’était pas par excès de confiance en moi, en grand sage philosophe, en savant moralisateur, que j’abordais les foules. C’était en petite idiote, convaincue que c’était faux archi faux, tout ce blabla des vieux qui consistait à ne pas uniquement regretter leur époque mais à aussi nous prédire la nôtre chaotique. Parfois, même, ils osaient s'en vouloir de nous y avoir pondu.
Ca, j’en pouvais plus. Et par dessus tout, je voulais leur prouver.
Que c’était leur faute. Et qu’avec un peu de volonté... tout ça. Que l’irrespect qu’ils recevaient ne tenait qu’à l’aigreur qu’ils dégageaient et m’épargnait, moi, parce que je laissais leur chance aux gens.
«Ha! Je vous l’avais dit, les gens sont sympas, la vie est belle, la guerre, c’est fini et l’eau ne mouille que les vieux réacs!»
«Nananèreuh», peut-être même en prime.
Je me prenais pour rien donc.
Je prenais simplement l’espoir. En otage, enfermé dans la cave, et je voulais pas qu’il s’en aille, jamais, et qu’il devienne simplement réel. Bientôt.
Je le choyais tous les jours un peu plus, ne voulant pas comprendre qu’il l’aimait pas, la prison que je lui avais faite. Il avait pas que ça à faire, attends. Fallait qu’il en déçoive plein, plein, plein d’autres encore. Environ 6 milliards à l’époque.
http://www.worldometers.info/
Et puis, les métaphores ont commencé à m’ennuyer.
Les profs de français ne comprenaient pas qu’on préfère sécher leurs cours pour écrire; les clochards avec qui on rigolait en profitaient pour nous subtiliser des pièces dans les poches; je faisais du mal aux garçons que j’aimais; et y’avait toujours un documentaire où on tuait des animaux simplement pour avoir des manteaux qui font genre on est riches.
L’espoir a rétréci son champ d’action, d’un coup.
J’arrivais plus à croire en tout le monde.
Je m’endormais en pensant que quelque part, on tuait une femme. Que peut-être même, on poussait le vice jusqu’à l’enterrer proportionnellement à la gravité de son crime, lui donnant ainsi la possibilité de ne pas éviter la lapidation, au lieu de ne pas du tout éviter la lapidation.
J’entendais le voisin qui pleurait après avoir bu toutes ses bières. Je le croisais parfois au supermarché, je prenais ma tête dans mes mains quand je le voyais déposer sur le tapis roulant des dizaines de canettes, espérant peut-être n’en boire qu’une, et le recroisant le lendemain en achetant la même quantité. Je pouvais pas le sauver.
Il allait plus jamais aimer personne.
J’étais inutile.
J’allais jamais sauver personne.
Je me demandais s’il achetait autant bières parce qu’il était inutile, lui aussi.
Et qu’il pouvait même pas se sauver lui-même.
L’espoir a prêté sa place à la colère, pour voir. Tiens, vas-y, installe toi, je t’ai chauffé la chaise.
La colère m’a épuisée.
Même ceux qui me connaissaient depuis toujours ne comprenaient pas, ils disaient tout le temps «où est ce que tu veux en venir???» avec plein de points d’interrogation dans la voix et des yeux exorbités.
Comme si je le savais moi-même.
Le trémolo de leur incompréhension me froissait tellement que je finissais par ne plus les aimer, eux, qui ne partageaient pas ma révolte. Et ça non plus, ils ne l’ont pas compris.
Je gardais ma révolte bien au chaud, tout me hérissait, j’enrageais pour un papier jeté par terre, je prenais plus la peine de m’expliquer, je réduisais mon vocabulaire à «Arriéré !» tout court, j’avais plus assez de salive pour leur expliquer; et si je m’étais lancée dans une de ces tirades dont mon adolescence avait eu l’exclusivité, il aurait fallu que je leur dise à quel point je les haïssais d’avoir fait de moi quelqu’un qui commençait à comprendre ce que «les vieux réacs» disaient du monde, d’eux, de moi. Que c’était leur faute.
Et je ne l’ai jamais fait parce que je commençais à comprendre que je n’aurais pas été capable d’entendre ce qu’ils m’auraient répondu : que c’était le cadet de leur souci.
Je comprenais aussi que c’était autant ma faute que la leur.
Bon, que des trucs pas très réjouissants en somme.
http://www.worldometers.info/ encore, et ça a déjà empiré.
Certains de mes acolytes en étaient encore à se couper les avant-bras pour être sûrs d’être vivants quand j’évitais à tout prix de m’attarder sur le fait que je ressentais moins de choses, de peur de réaliser que j’étais presque morte.
Un matin, une prof de lettres m’avait pour ainsi dire fermé la porte au nez. Dans le bon sens du terme, c’est à dire, pour me garder dans la pièce, pas pour m’en exclure.
J’avais ce défaut d’arriver toujours la dernière et de repartir pas davantage en avance, les quelques fois où je venais. Facile comme un jeu d’enfant alors, pour l’adulte qu’elle était, de bloquer la moitié de femme qui m’habitait dans son antre. Je me rappelle que la pièce n’avait plus la même odeur quand on s’y est retrouvées seules.
Au moins, elle en avait une.
- Je ne suis pas du genre moralisatrice.
- J’ai remarqué. Mais votre entrée en matière est flippante quand même. - Je ne t’ai jamais donné de conseils. Ni même d’ordres.
- Je dirais le contraire...
- ? Je t’en ai donné ?
- Non, je veux dire, je le dirais dans l’autre sens. Vous ne m’avez jamais donné d’ordres. Ni même de conseils.
- Ca se vaut, en effet. Mais, pourquoi aurais-je construit cette phrase dans ce sens là?
- Pour souligner à quel point vous êtes cool.
- Est ce que tu me trouves cool?
- Me suis jamais posé la question, mais la façon dont vous me traquenardez avec vos phrases, et l’intro que vous faîtes à un tirage d’oreille tout en faisant croire que vous n’allez pas en faire, c’est mieux si vous faîtes la phrase dans l’autre sens, d’après moi. Comme ça, c’est l’avis d’une personne cool. Genre. Et c’est ni de la morale, ni des ordres. Tout ça tout ça.
- Je suis pas sûre que le verbe «traquenarder» existe, mais je vois où tu veux en venir et...
- ... Ah non! moi je veux en venir nulle part hein. Ni maintenant ni jamais. C’est vous qui m’avez traquenardée dans la pièce pour me faire la morale et me donner des ordres, moi j’ai rien demandé.
- Manon... - ...
- Je sens bien que tu perds prise ces derniers temps.
C’est con, c’est la dernière chose que j’avais envie d’entendre. Même si j’avais fait ma maligne, façon «on me l’a fait pas, je me ferai pas avoir», j’attendais que ça, qu’elle me la fasse et qu’elle m’ait. Et voilà qu’elle tombait dans le grand panneau «attention chute de clichés».
- Je perds pas prise, vous comprenez rien, je lâche prise. Vous n’avez pas saisi la nuance. A ce titre, vous ne méritez pas que j’écoute vos morales une seconde de plus. Si c’est pour me dire de ne pas le faire, de toute façon, c’est trop tard. Et si c’est pour me dire que c’est mal, alors vous devenez une pas-cool. Et si c’est pour m’encourager... Si c’est pour m’encourager, votre cynisme me dégoûte. Vous êtes foutue. Vous vous êtes traquenardée toute seule. Pourtant je voulais vous laisser une chance. Sérieux.
Et comme elle avait claqué la porte, je vois pas pourquoi moi, qui faisais manifestement preuve de davantage de jugeote, j’aurais pas eu le droit de le faire, résultat, je l’ai fait, voilà. Dans le mauvais sens du terme. C’est à dire en l’excluant.
Pourtant elle a quand même dit quelque chose, en la rouvrant, sur mes pas amers qui résonnaient dans les couloirs.
- Vous n’êtes pas de ceux qui baissent les bras.
Je comprenais pas, j’avais pas l’impression d’avoir abandonné quoique ce soit. Peut-être que mon imperceptible haussement d’épaule l’a amenée à insister.
- Vous n’êtes pas désillusionnée. Vous ne le serez jamais.
Ca m’a fait un pic dans le corps quand elle a dit ça. Je sais plus trop où. Partout sûrement, nulle part à la fois.
-Ha, désillusionnée! Super... Encore faudrait-il que j’ai été illusionnée, j’vous signale.
Je n’avais pas encore relevé qu’elle m’avait vouvoyée pour la première fois.
- Tu n’es ni désillusionnée ni illusionnée, tu aimes les gens, je crois vraiment que tu veux les aimer, et l’essentiel, c’est d'essayer, et de bien le leur expliquer, ils seront d’accord, toujours, tout le monde veut toujours qu’on l’aime.
J’avais ralenti. Non pas que ses mots me parlaient, mais, je sais pas, elle me donnait beaucoup d’elle, je trouvais. Je me devais de l’écouter.
- Vous pourriez me dire de me mêler de ce qui me regarde. Et pourtant vous voulez me laisser parler parce que vous m’aimez. Vous ne devez pas baisser les bras. Vous devez rester une enfant. Vous êtes une formidable enfant.
Je réalisais tout à coup qu’elle me disait «vous».
- Vous m’avez vouvoyée pour me dire de rester une gamine. Vous êtes une super prof mais, sérieux, ne vous reconvertissez pas en psy. Parce que vous seriez nulle.
Elle m’avait vouvoyée. J’étais foutue, adulte, responsable, cramoisie.
J'étais comme elle maintenant, j'essaierai peut-être même d'empêcher les autres de grandir.

Baisser les bras... quelle idée. Toujours je les garde relevés pour danser, faire la fête, commander un autre verre, héler un taxi ou me pendre à tout plein de cous.
Je ne connais plus ni l’espoir ni la colère. L’envie, parfois. Quand eux on le droit de rester dans le bar qui ferme alors que moi non. Et puis juste après, je m’en fous. Ca c’est ce que je connais le mieux. M’en foutre.
Qu’est ce qui compte? Hein? Je demande quand même parfois entre deux vodkas. Hein, dis le moi, toi là, qu’est ce qui compte? A part ton verre à recommander, ta demoiselle à séduire, l’autre à flouer et les blagues du lendemain, à bien construire pour faire rire l’assemblée.
La syntaxe, ça vaut aussi pour l’humour. Certains profs de littérature nous auront au moins servi à se foutre de leur gueule en bon français, c’est toujours ça.
J’ai pas froid parce que j’ai bu et puis après j’ai trop chaud parce que l’alcool s’en va mais pas toi et je ne te voulais pas vraiment dans mon lit, ou pas aussi longtemps. Je parle de rien. Je ris de tout. Je commence à vivre en diagonale.
J’ai mal partout.

Un jour, on croise une amie qu’on n’avait pas vu depuis au moins aussi longtemps que l’espoir. Elle était restée dans une cave, elle aussi, en quelque sorte. Je marchais comme ça, je sais plus trop pourquoi d’ailleurs, je me rendais pas loin de là où il fallait, à peu près à l’heure requise et j’avais même pas froid. J’avais plus envie d’écrire, ni de lire, le cinéma, j’y allais plus et les conversations sentaient la mauvaise haleine de l’alcool ou le chewing-gum poli. Les gens grelottaient, je crois, j’en suis même pas sûre parce que j’avais du mal à les considérer comme des gens, alors je peinais à leur attribuer des sensations humaines. Des trucs qui viendraient du corps, je pensais que plus personne faisait ça.
On m’avait bousculée et, quand même, l’espace d’une seconde je m’étais dit qu’à une époque, lointaine, presque antérieure à moi même, j’avais été une fille qui refusait qu’on la bouscule.
Je me disais qu’en même temps, refuser qu’on nous bouscule ne nous assurait pas du fait qu’on ne nous bouscule plus jamais, mais que quand même... le refuser nous poussait peut-être à leur expliquer qu’il ne fallait pas faire ça, parce que ne pas considérer les gens et ne même plus se rendre compte qu’ils étaient forcément du genre à ne pas apprécier qu’on les bouscule, c’était être une vieille peau. Et puis je me disais que je divaguais, d’ailleurs ça m’avait fait perdre un temps fou, j’avais pas sorti ma carte de transport alors que j'étais déjà presque dans les escaliers du métro. C’est comme si je n’avais rien pensé du tout, et que personne ne m’avait bousculée, ou alors y’a très longtemps.
- Manon?!
Ca me rebouscule, mais plus gentiment.
-Je te suis rentrée dedans mais comme une furie! t’as pas vue? Je faisais tomber mon téléphone et je savais plus où j’en étais et pour le rattraper sans raccrocher j’ai fait n’importe quoi je t’ai bousculée et puis j’ai cru te reconnaître et puis c’est bizarre parce que comme tu t’es pas retournée je me suis dit que ça pouvait pas être toi parce que pour moi, toi, tu te serais retournée pour m’insulter tu vois, mais c’est con, je sais pas pourquoi je pense ça et puis je t’ai observée quand même et je t’ai vue regarder en l’air et t’arrêter et t’étais comme .... chais pas, ralentie par rapport aux autres gens tu devais penser à un truc fort, j’en sais rien, mais là je me suis dit, alors que je t’avais pas toujours vue de face hein, mais je me suis dit «bon c’est sur c’est elle!»
La fille, enfin, respire. J’en pouvais plus de sa tirade, je souffrais pour elle.
- Ok. Bon, mais, on se connait?
- Ha ha, je te reconnais bien là.
Je pense «super, elle me reconnaît bien là alors que moi je l’ai pas reconnue ailleurs, donc elle me reconnaît deux fois et moi je la remets jamais» mais je dis juste:
- J’étais au ralenti, tu dis?
- C’est marrant, tu vois, j’ai toujours pensé qu’on s’entendrait, un jour.
- Et, ce jour arrivera dans une autre vie non?
- Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Tu me vexeras pas, tu sais.
- Bah oui, non, j’en n’ai pas envie d’ailleurs. Mais, heu... je comprends pas trop trop...
- T’étais hyper ...
Ok, j’ai compris, elle va me parler de comment j’étais avant, me parler de quelqu’un d’autre, de comme je ne suis plus, et me tuer un peu plus. Ok, on veut m’achever. J’abdique. Voilà, j’abdique. Laissons cette greluche déblatérer et passons à la pharmacie pour acheter plein de médocs, après.
-T’étais hyper... Hyper pareille en fait. T’as pas changé. C’est dingue.
Je. J’ai un peu le souffle coupé. Parce que, si, j’ai changé, si si si, je suis aigrie, j’aime plus personne, d’ailleurs toi même tu m’emmerdes, j’ai pas que ça à faire.
- T’es toujours autant...
Je pense : «autant capable de te tuer?» et encore une fois, je dis rien. J’ai compris la leçon.
-Toujours autant à fond quoi. T’es à fleur de peau. On se le disait souvent.
J’aimerais savoir qui est le «on» mais manifestement ma bouche décide d’autre chose:
-Tu me trouves à fleur de peau?
-Tu plaisantes? Regarde toi. Tout t'énerve, tout te plaît. Ca doit être super fatiguant, sérieux.
Je le prends dedans mes bras. Dedans, vraiment, comme si je voulais tatouer l’accolade dans ma peau. Je sais pas pourquoi je fais ça, je l’aime pas tellement, son parfum est entêtant et vulgaire et puis, quand même, elle m’a bousculée. Je suis fatiguée. Je me repose un peu sur elle, un instant.
J’y repense de temps en temps. Elle a voulu qu’on se voit, moi j’avais envie de tout sauf de ça, c’était pas ma came et, ça va hein, bon, peut-être m’avait-elle sortie de mon hibernation, mais, elle n’en savait rien et puis, elle aurait pas compris. C’est pas parce que je l’avais prise dedans mes bras qu’on était liées à la vie à la mort. Compte tenu du nombre de gens que j’aimais à crever et que j’avais jamais pris dans mes bras, cette théorie ne marchait pas.
Je baissais pas les bras, je les levais pas non plus, je les posais sur mes hanches, comme ça, comme quelqu’un qui réfléchirait dans un film muet; la gestuelle bien exagérée pour qu’on comprenne sans les paroles. Et sans les paroles, mes mains sur mes mes hanches, je me disais «alors comme ça, y’a des gens que t’aimes à en crever?»
Parce que je me dis «tu» quand je me parle.
Y’avait des gens que j’aimais à en crever.
Certains morceaux ne durent pas assez longtemps et il m’arrive de jeter des livres, tout à coup, vite, pour ne pas les finir. Je les cache, comme ça je sais qu’il me reste du bonheur quelque part. Les gens, certains, seraient comme ces bouts de livres et les chansons qui restent dans la tête. Et moi, je serais comme une enfant qui se remettrait aux métaphores, pour voir si leur place est assez chaude, encore, pour que je ne me moque plus d’elles.
La colère et l’espoir avaient réduit leur champ d’action, comme prévu. De beaucoup. Beaucoup-beaucoup.
On était passé, eux, et moi avec, à 6 milliards et quelques à une vingtaine de personnes. Puis, on a avait réalisé qu'il restait encore du linge sale dans la séléction, alors on avait encore réduit et on était arrivé à un petit noyau de 5,6 élus. Du beau vrai licenciement.
J’étais exclue du monde parce que j’avais décidé de me tenir à l'écart, peut-être. Je voulais pas le détester mais ça avait été pour mieux me protéger, on aurait dit.
Et, là, comme ça, je réalisais dans mon mètre 60 que j’avais toujours la même colère et toujours le même espoir, et que j’avais mis potentiellement l’un et nécessairement l’autre dans ces 5,6 pauvres bougres.
Si ceux là me décevaient, si j’avais mal prévu mon coup, j’irai sûrement acheter tellement de canettes de bières qu’une lapidation de tigre en direct ne me ferait ni chaud ni froid, comme quand les saisons n’avaient pas de température ni d’emprise sur le corps que j’habitais plus.
J’avais encore fait la gamine.
Et levé les bras trop haut.
Si ça se trouve, j’étais intacte.
Mais ceux que j’aimais, ça pouvait pas être autrement: ils étaient le monde, le grand, ils allaient se sauver et m’aider à le faire aussi. Ils avaient forcément 5,6 victimes auxquelles ils accrochaient leur naïveté cynique, comme moi. Et ainsi de suite. Ca allait marcher.
Et puis, même s’ils étaient pas nombreux, ils étaient grands, très grands, presque trop grands pour mes petits bras finalement trop courts.
-maispastrop-