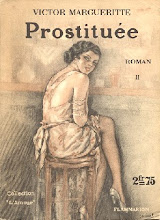Pour Invalides changez à Opéra, et restez-y.
Aujourd'hui, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai été fascinée par le siège du métro tout à coup.
Comme le wagon était désert, j'ai pu observer. J'aime bien faire ça, observer. Je n'avais jamais remarqué la courbe dessinée pour -j'imagine-adopter l'envie d'un déformé par du, de, des, par la vie. Le fauteuil, en soi, la courbe en tout cas, l'ergonomie de cette courbe est émouvante au plus haut point. Une cambrure qu'on réserverait à la mère de nos enfants, ou celle à qui on voudrait en faire, en gros. Là, tout à coup, le siège m'est apparu éminemment sensuel ce qui était plutôt bizarre comme sensation à Marcadet Poissonniers sur les coups de 20h.
Quelqu'un a réfléchi à ça, la manière dont mon dos aimerait se caler après 10 heures de dur labeur. Et il est payé pour.
Peut-être est-ce quelqu'un qui a travaillé dix heures aussi, dans un bureau, avec des gens auxquels ils sourit et avec qui il s'entend, par la force des choses et du temps, peut-être est-ce cette personne qui a décidé de la forme toute séduisante des fauteuils de cette ligne de métro.
Je suis persuadée d'une chose: celui qui a dessiné le fauteuil ne doit pas s'entendre des masses avec celui qui a décidé de l'imprimé et de la matière de ces fauteuils. Si c'est la même personne, j'entends. Si jamais il y en avait un responsable de l'imprimé et un autre responsable de la matière, ils doivent pas aller boire des coups avec celui responsable de la forme. Mais eux deux, ils vont très certainement faire la fermeture des bars ensemble; c'est d'ailleurs là bas qu'ils doivent décider de ce sur quoi, nous, pauvres mortels, allons poser nos fonds de culotte. Si tant est qu'il nous en reste. Des fonds de culotte. Et peut-être même qu'eux aussi s'asseyent sur leurs croisillons criards en faux velours pour se rendre à la prochaine réunion décidant de la tonalité de voix de la dame qui annonce les prochaines stations; une première fois comme si elle nous interrogeait, une seconde et dernière fois comme si, tout réflexion faite, elle nous sommait de descendre. Peut-être même qu'elle nous interpelle. Et qu'elle va pas tarder à nous engueuler. Nan mais sans rire, on dirait ma prof de seconde qui fait l'appel et devant un silence d'église réitère sa question alors qu'il n'y a rien à répondre sinon ma tête endormie. Parfois, quand la fille des enceintes du métro prononce ma station avec une intonation en point d'interrogation, j'ai comme le réflexe de lever la main en criant "présente" pour pas qu'on me fourgue des heures de colle.
Si tout ça:
la forme du fauteuil, ses imprimés, sa matière et l'inflexion de madame "Barbès Rochechouart?"- "Barbès Rochechouart!" sont le fruit d'un seul et même cerveau, je serai gré à quiconque qui le sait de ne pas me le dire. J'ai déjà connaissance de beaucoup trop de choses affligeantes comme ça.
-maispastrop-
Comme le wagon était désert, j'ai pu observer. J'aime bien faire ça, observer. Je n'avais jamais remarqué la courbe dessinée pour -j'imagine-adopter l'envie d'un déformé par du, de, des, par la vie. Le fauteuil, en soi, la courbe en tout cas, l'ergonomie de cette courbe est émouvante au plus haut point. Une cambrure qu'on réserverait à la mère de nos enfants, ou celle à qui on voudrait en faire, en gros. Là, tout à coup, le siège m'est apparu éminemment sensuel ce qui était plutôt bizarre comme sensation à Marcadet Poissonniers sur les coups de 20h.
Quelqu'un a réfléchi à ça, la manière dont mon dos aimerait se caler après 10 heures de dur labeur. Et il est payé pour.
Peut-être est-ce quelqu'un qui a travaillé dix heures aussi, dans un bureau, avec des gens auxquels ils sourit et avec qui il s'entend, par la force des choses et du temps, peut-être est-ce cette personne qui a décidé de la forme toute séduisante des fauteuils de cette ligne de métro.
Je suis persuadée d'une chose: celui qui a dessiné le fauteuil ne doit pas s'entendre des masses avec celui qui a décidé de l'imprimé et de la matière de ces fauteuils. Si c'est la même personne, j'entends. Si jamais il y en avait un responsable de l'imprimé et un autre responsable de la matière, ils doivent pas aller boire des coups avec celui responsable de la forme. Mais eux deux, ils vont très certainement faire la fermeture des bars ensemble; c'est d'ailleurs là bas qu'ils doivent décider de ce sur quoi, nous, pauvres mortels, allons poser nos fonds de culotte. Si tant est qu'il nous en reste. Des fonds de culotte. Et peut-être même qu'eux aussi s'asseyent sur leurs croisillons criards en faux velours pour se rendre à la prochaine réunion décidant de la tonalité de voix de la dame qui annonce les prochaines stations; une première fois comme si elle nous interrogeait, une seconde et dernière fois comme si, tout réflexion faite, elle nous sommait de descendre. Peut-être même qu'elle nous interpelle. Et qu'elle va pas tarder à nous engueuler. Nan mais sans rire, on dirait ma prof de seconde qui fait l'appel et devant un silence d'église réitère sa question alors qu'il n'y a rien à répondre sinon ma tête endormie. Parfois, quand la fille des enceintes du métro prononce ma station avec une intonation en point d'interrogation, j'ai comme le réflexe de lever la main en criant "présente" pour pas qu'on me fourgue des heures de colle.
Si tout ça:
la forme du fauteuil, ses imprimés, sa matière et l'inflexion de madame "Barbès Rochechouart?"- "Barbès Rochechouart!" sont le fruit d'un seul et même cerveau, je serai gré à quiconque qui le sait de ne pas me le dire. J'ai déjà connaissance de beaucoup trop de choses affligeantes comme ça.
-maispastrop-
Rendez vous page 209
Je prête des livres, parfois.
J'aime qu'ils correspondent un tant soit peu au lecteur alors je ne prends pas tellement de risques et je prête, avec enthousiasme, mais rarement.
J'ai prêté un livre dernièrement, c'était chouette, c'est une expérience que je conseille vivement.
Au fond, je ne prête certainement que les livres qui me ressemblent aux gens qui me parlent pour qu'on s'aime d'une autre manière, qu'on se retrouve à travers quelqu'un qu'on ne connaît pas, nous deux. Il y aura toujours ça entre nous, le livre qu'on aura lu, au travers duquel on se sera aimé.
C'est ce qu'il y a de formidable avec l'idée de prêter un livre.
Oui, je fais écouter des musiques, et en fait, j'emporte souvent des camarades à une exposition, et en plus je bavarde pas mal sur ce qu'il m'arrive de vivre.
Mais quand je prête un livre... je ne sais pas. J'ai possédé la chose, elle m'a accompagnée dans des transports en commun, dans des nuits en solo, au fond d'un sac, sur la table de chevet; il y a des pages que j'ai cornées, d'autres sur lesquelles, peut-être, j'ai pleuré (mais c'est pas sûr parce que je suis pas une mauviette), des phrases soulignées aussi; j'ai développé un attachement à l'objet parce qu'il s'est posé sur mon torse et qu'il a tout suivi de ces derniers mois, il était là, mes derniers Moi. Il avait sa place dans la bibliothèque et peut-être même que j'y jetais un coup d'oeil avant de m'endormir. Et ça, même si ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas touché.
Alors, quand je le prête...
Y'a un peu de moi qui part, dans le sac de quelqu'un d'autre. Ses trajets en métro, ses tables de chevet, ses pauses déjeuners, son torse, l'intérieur de sa tête surtout, le dedans de celui qui lit; tout ça, ses moments à cette personne alors que je ne suis pas là mais un peu quand même.
Parce que je me prends à deviner à quel endroit il en est et ce que ça peut lui faire comme frissons. Parce qu'aussi, ils me disent que ça leur fait des frissons sans imaginer ceux qu'ils me procurent en me le disant.
C'est assez intime pour moi de prêter un livre.
C'est plutôt important. J'ai pas envie de me tromper, d'ailleurs je n'ai jamais vraiment pris le risque, je me lance quand je sais que l'essentiel de ce que j'ai aimé dans ces pages et qui me ressemblent sera apprécié en face.
Un jour, y'a quelqu'un qui m'a dit, en m'offrant un livre dans un paquet cadeau et tout, que le dit livre "était pour moi". Ce qui, je ne le cacherais pas davantage m'a un tant soit peu effrayée sur le coup. Ce quelqu'un était important, je l'aimais, c'était une fille avec de l'humour et des traits de visage des années 60, c'est pour dire... Et puis, je n'avais jamais moi-même offert un livre à quelqu'un pour qui j'aurais jugé qu'il était fait pour, et l'envie ne m'avait cependant pas manquée, mais, ça n'était jamais arrivé. Je n'avais encore jamais vécu ça, c'était pour moi un genre d'instant magique réservé aux films.
Aussi, quand j'ai attrapé le cadeau, j'ai senti mes jambes trembler. Et mon coeur avec. (ils font toujours tout de pair ces 3 là).
J'ai eu peur. Peur que non, ça ne soit pas "pour moi". Et j'ai été excitée, comme une adolescente, à l'idée que, oui, peut-être, c'était pour moi. J'ai regardé la personne qui me l'offrait et puis voilà, ça arrive ce genre d'illuminations, après avoir feuilleté les trois premières phrases, j'ai arrêté de faire trembler mes jambes avec ma peur parce que je n'avais plus peur et que je n'avais plus de jambes non plus.
Je l'ai lu en moins de temps qu'il ne faut pour le dire et j'aurais pourtant aimé que ça dure toujours; parce que ce livre était mon ami, mon cher et tendre et qu'il fallait que ça ne s'arrête jamais. Il était en effet fait pour moi. J'ai écrit à l'auteur, d'ailleurs, en lui demandant, s'il vous plaît, de sortir de ma tête parce que ça devenait gênant. Il était fait pour moi au point qu'il ressemblait à celui que j'avais écrit. C'était peut-être égotiste comme fascination, mais c'était fascinant. Aux 3/4, je surveillais, inquiète: je ne voulais pas avancer trop vite, je savais que quand ce serait fini, ce serait fini. Et quand il n'y a plus eu que 5 pages, je me suis tout à coup trouvé un paquet d'occupations m'éloignant de la dernière de couverture. Je voulais pas que ça s'arrête. Je voulais pas qu'on se quitte alors qu'on s'aimait plus que jamais, mieux que personne, je voulais pas en voir la fin.
Et puis.
C'était pas un dimanche, non. C'était un vendredi, en plus.
A cette heure là, mon corps était habitué à encaisser un grand nombre de décibels, un nombre non moins conséquent d'alcool, et un nombre voisin de conversations qu'on n'entend qu'à moitié à cause des décibels et dont on se moque à cause de l'alcool.
Mais ce vendredi là, j'avais rendez-vous. Je savais qu'il fallait que ça arrive alors j'ai choisi un jour où mes amis, mes camarades, mes faux amis et mes rien à foutre s'encanaillaient. Je voulais qu'il se passe quelque chose de festif pour notre séparation, quelque part.
J'ai mis du temps, un temps fou, inimaginable, à tourner la dernière page.
J'avais, au préalable aperçu l'imprimé. Alors je savais qu'il me restait quelque chose comme 15, 16, 17 lignes tout au plus avant que ce soit fini. Avant d'être plus vieille.
Plus remplie, plus touchée, plus dure.
J'aime pas les adieux. Voilà c'est dit. Les trucs qui se terminent, ça me mine.
Lui, il s'en fout, il a écrit son livre, il l'a terminé, il a rompu, divorcé... il fait peut-être du yoyo à l'heure qu'il est. Quand je peine à tourner la page, si ça se trouve, il en entame une autre, le traître.
Alors d'accord, je passe aux derniers mots, l'oeil fébrile, et je ne peux pas, JE NE PEUX PAS, m'empêcher de lire la toute fin. Les mots sur lesquels l'auteur a peut-être passé un mois, et sur lesquels mon Moi trépasse, encore une fois.
Bon, l'oeil fébrile pleure, la belle affaire.
Les plus belles choses, on les voit toujours floues, à cause du liquide lacrymal.
Les dernières lignes, elles étaient floues, belles, lacrymales.
Jamais je ne finirai un livre dans un endroit public.
Est ce qu'on divorce dans le métro?
Un peu de pudeur, merde.

J'ai prêté un roman et c'était chouette; ça m'a donné envie de le relire. Je n'y avais jamais pensé, à ça, le relire. Je croyais que quand c'était fini, bah, c'était la fin.
Je le relis, je le redécouvre. Je n'ai plus peur. Il s'est passé un truc, un machin qui ne porte pas vraiment de nom. Je l'ai prêté à quelqu'un et il me revient comme enorgueilli, à moi, comme vierge.
Si c'est pas formidable.
Tout peut recommencer. Et commencer.
-maispastrop-
J'aime qu'ils correspondent un tant soit peu au lecteur alors je ne prends pas tellement de risques et je prête, avec enthousiasme, mais rarement.
J'ai prêté un livre dernièrement, c'était chouette, c'est une expérience que je conseille vivement.
Au fond, je ne prête certainement que les livres qui me ressemblent aux gens qui me parlent pour qu'on s'aime d'une autre manière, qu'on se retrouve à travers quelqu'un qu'on ne connaît pas, nous deux. Il y aura toujours ça entre nous, le livre qu'on aura lu, au travers duquel on se sera aimé.
C'est ce qu'il y a de formidable avec l'idée de prêter un livre.
Oui, je fais écouter des musiques, et en fait, j'emporte souvent des camarades à une exposition, et en plus je bavarde pas mal sur ce qu'il m'arrive de vivre.
Mais quand je prête un livre... je ne sais pas. J'ai possédé la chose, elle m'a accompagnée dans des transports en commun, dans des nuits en solo, au fond d'un sac, sur la table de chevet; il y a des pages que j'ai cornées, d'autres sur lesquelles, peut-être, j'ai pleuré (mais c'est pas sûr parce que je suis pas une mauviette), des phrases soulignées aussi; j'ai développé un attachement à l'objet parce qu'il s'est posé sur mon torse et qu'il a tout suivi de ces derniers mois, il était là, mes derniers Moi. Il avait sa place dans la bibliothèque et peut-être même que j'y jetais un coup d'oeil avant de m'endormir. Et ça, même si ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas touché.
Alors, quand je le prête...
Y'a un peu de moi qui part, dans le sac de quelqu'un d'autre. Ses trajets en métro, ses tables de chevet, ses pauses déjeuners, son torse, l'intérieur de sa tête surtout, le dedans de celui qui lit; tout ça, ses moments à cette personne alors que je ne suis pas là mais un peu quand même.
Parce que je me prends à deviner à quel endroit il en est et ce que ça peut lui faire comme frissons. Parce qu'aussi, ils me disent que ça leur fait des frissons sans imaginer ceux qu'ils me procurent en me le disant.
C'est assez intime pour moi de prêter un livre.
C'est plutôt important. J'ai pas envie de me tromper, d'ailleurs je n'ai jamais vraiment pris le risque, je me lance quand je sais que l'essentiel de ce que j'ai aimé dans ces pages et qui me ressemblent sera apprécié en face.
Un jour, y'a quelqu'un qui m'a dit, en m'offrant un livre dans un paquet cadeau et tout, que le dit livre "était pour moi". Ce qui, je ne le cacherais pas davantage m'a un tant soit peu effrayée sur le coup. Ce quelqu'un était important, je l'aimais, c'était une fille avec de l'humour et des traits de visage des années 60, c'est pour dire... Et puis, je n'avais jamais moi-même offert un livre à quelqu'un pour qui j'aurais jugé qu'il était fait pour, et l'envie ne m'avait cependant pas manquée, mais, ça n'était jamais arrivé. Je n'avais encore jamais vécu ça, c'était pour moi un genre d'instant magique réservé aux films.
Aussi, quand j'ai attrapé le cadeau, j'ai senti mes jambes trembler. Et mon coeur avec. (ils font toujours tout de pair ces 3 là).
J'ai eu peur. Peur que non, ça ne soit pas "pour moi". Et j'ai été excitée, comme une adolescente, à l'idée que, oui, peut-être, c'était pour moi. J'ai regardé la personne qui me l'offrait et puis voilà, ça arrive ce genre d'illuminations, après avoir feuilleté les trois premières phrases, j'ai arrêté de faire trembler mes jambes avec ma peur parce que je n'avais plus peur et que je n'avais plus de jambes non plus.
Je l'ai lu en moins de temps qu'il ne faut pour le dire et j'aurais pourtant aimé que ça dure toujours; parce que ce livre était mon ami, mon cher et tendre et qu'il fallait que ça ne s'arrête jamais. Il était en effet fait pour moi. J'ai écrit à l'auteur, d'ailleurs, en lui demandant, s'il vous plaît, de sortir de ma tête parce que ça devenait gênant. Il était fait pour moi au point qu'il ressemblait à celui que j'avais écrit. C'était peut-être égotiste comme fascination, mais c'était fascinant. Aux 3/4, je surveillais, inquiète: je ne voulais pas avancer trop vite, je savais que quand ce serait fini, ce serait fini. Et quand il n'y a plus eu que 5 pages, je me suis tout à coup trouvé un paquet d'occupations m'éloignant de la dernière de couverture. Je voulais pas que ça s'arrête. Je voulais pas qu'on se quitte alors qu'on s'aimait plus que jamais, mieux que personne, je voulais pas en voir la fin.
Et puis.
C'était pas un dimanche, non. C'était un vendredi, en plus.
A cette heure là, mon corps était habitué à encaisser un grand nombre de décibels, un nombre non moins conséquent d'alcool, et un nombre voisin de conversations qu'on n'entend qu'à moitié à cause des décibels et dont on se moque à cause de l'alcool.
Mais ce vendredi là, j'avais rendez-vous. Je savais qu'il fallait que ça arrive alors j'ai choisi un jour où mes amis, mes camarades, mes faux amis et mes rien à foutre s'encanaillaient. Je voulais qu'il se passe quelque chose de festif pour notre séparation, quelque part.
J'ai mis du temps, un temps fou, inimaginable, à tourner la dernière page.
J'avais, au préalable aperçu l'imprimé. Alors je savais qu'il me restait quelque chose comme 15, 16, 17 lignes tout au plus avant que ce soit fini. Avant d'être plus vieille.
Plus remplie, plus touchée, plus dure.
J'aime pas les adieux. Voilà c'est dit. Les trucs qui se terminent, ça me mine.
Lui, il s'en fout, il a écrit son livre, il l'a terminé, il a rompu, divorcé... il fait peut-être du yoyo à l'heure qu'il est. Quand je peine à tourner la page, si ça se trouve, il en entame une autre, le traître.
Alors d'accord, je passe aux derniers mots, l'oeil fébrile, et je ne peux pas, JE NE PEUX PAS, m'empêcher de lire la toute fin. Les mots sur lesquels l'auteur a peut-être passé un mois, et sur lesquels mon Moi trépasse, encore une fois.
Bon, l'oeil fébrile pleure, la belle affaire.
Les plus belles choses, on les voit toujours floues, à cause du liquide lacrymal.
Les dernières lignes, elles étaient floues, belles, lacrymales.
Jamais je ne finirai un livre dans un endroit public.
Est ce qu'on divorce dans le métro?
Un peu de pudeur, merde.

J'ai prêté un roman et c'était chouette; ça m'a donné envie de le relire. Je n'y avais jamais pensé, à ça, le relire. Je croyais que quand c'était fini, bah, c'était la fin.
Je le relis, je le redécouvre. Je n'ai plus peur. Il s'est passé un truc, un machin qui ne porte pas vraiment de nom. Je l'ai prêté à quelqu'un et il me revient comme enorgueilli, à moi, comme vierge.
Si c'est pas formidable.
Tout peut recommencer. Et commencer.
-maispastrop-
Demain, je continue
Ils arrêtent.
Beaucoup d'entre eux, d'entre nous, des miens. Ils arrêtent et comptent les jours passés sans, cochent parfois les jours sur les calendriers, même.
Je croyais qu'on comptait les jours qu'il nous restait à vivre tandis qu'eux, d'une certaine façon, comptabilisent ceux qu'ils gagnent peut-être.
Le petit fil peine parfois à se séparer de l'emballage, mais quand on s'y prend bien, c'est un de ces gestes gratifiants que j'affectionne tant il est limpide et constructif. En effet, une fois le plastique mis à part, on arrive au vif du sujet, au centre de l'attention, l'objet du désir. On n'a pas fait tout ça pour rien.
Quand je la sors du paquet, le bruit est soyeux. Comme de la soie, oui. De la soie qui se frotterait à une autre soie, mais dans le bon sens du terme, le bon sens du poil, pas celui qui fait grincer des dents. Deux bouts de soie dans la même direction, un accord de mélodie tout à fait pop et élégant.
Quand je l'attrape entre mon index et mon doigt d'honneur, entre ce que je pointe et ce que j'emmerde, elle trouve sa place, elle est comme à la maison. Fais comme chez moi, je lui dis.
D'ailleurs ma maison sent un peu comme elle en fin de semaine, je sais c'est mal, mais il se trouve que c'est comme ça, elle prend son odeur. Un amoureux dort deux nuits de suite sur un de vos oreillers et le tissu de la taie adopte l'odeur de sa nuque. Je passe mon dimanche au lit avec elle, et c'est itou, c'est comme ça, disais-je. Pas autrement. Et quand on dit "c'est comme ça", c'est une manière à peine déguisée de faire comprendre que vos critiques n'y changeront rien et qu'on s'en fout comme de l'an 40, ma gauloise blonde bleue et moi.
Quand je l'amène à ma bouche, mes lèvres se tendent vers elle avec une habitude lassive, comme vers un amant trop connu et dont on ne peut pourtant pas se passer, qui fait toujours, encore, battre le coeur après tant d'années de vie commune.
Déjà, mon sang s'agite, mon coeur l'accompagne, mon organe vital est bien obligé de suivre ma circulation vous me direz. Ou peut-être est-ce l'inverse. Tous les deux sont pourtant d'accord sur un point: c'est pas une bonne fréquentation, cette blonde aux yeux bleus, on court à notre perte, faut arrêter, faut plus la voir, lui refuser l'entrée, quelque chose, mais ne plus l'accueillir et la faire circuler dans les poumons, la gorge, sur la langue, entre les dents, sur le bouts des doigts, ça suffit, merde.
Ca suffit.
Et pourtant.
Regardez comme ça change son fusil d'épaule, tout cet attirail de revendication, dès qu'une carotte rouge clignote sur un trottoir parisien.
J'aime arriver chez mon buraliste et ne pas avoir à prononcer un seul mot; je pourrais même, si je le voulais, garder la musique dans mes oreilles et me contenter de le contenter d'un simple sourire, mais, j'ôte toujours -par politesse- un écouteur et lui souris pendant qu'il attrape déjà mon paquet alors que j'ai à peine fini de dire "bonjour".
Un par jour. Un paquet. Un homme, un film, un verre de vodka, un livre, un rêve, un texte, un plat. Et toutes ces cigarettes de ce seul paquet qui accompagnent l'homme, le film, la vodka, le livre, le texte, le rêve, le plat.
Parfois deux.
Les grands soirs. Deux paquets et généralement une moitié d'homme, je me sens comme la cinémathèque après 9 verres de vodka, où est mon livre, je rêve pas je ronfle, et j'ai rien à écrire d'façon, ou trop de choses; j'ai pas faim mais je mangerais bien 4 bavettes à l'échalotte. Ou toi.
Et toujours ces cigarettes pour témoigner de tout"ça".
Si un jour on me juge extraordinaire au point de mériter une biographie, je voudrais que ce soit mes tiges qui s'en chargent parce qu'elles savent tout de ce que les journalistes et les paparazzis n'auront pas pu attraper, dans la salle de bain le matin ou tard, très-trop tard, presque tôt, au lit. Elles savent tout.
Et elles se gêneront pas pour balancer, elles n'ont pas de scrupule. Elles sont pas là pour ça.
Ils arrêtent tous parce que le temps passe, -oui il fait ça souvent le temps- et que la nicotine commence à essouffler peut-être, à griser le teint ou je ne sais quoi. Quand est ce qu'ils prennent cette bizarre décision, je me demande. Quand ils peinent à monter 6 étages d'un seul souffle? Ou parce qu'il est écrit qu'il faut devenir sérieux, à un moment donné, et faire des enfants par exemple pour fêter ça. Ce qui est, nous sommes d'accord, la pire preuve de sérieux qui existe. Ils arrêtent donc parce qu'ils veulent s'occuper d'eux, non? J'entends par là, prendre soin de leur corps, espérer qu'ils passeront entre les mailles des milliards de filets des millions de cancers, manger bio peut-être, faire du sport, se coucher tôt, tiens, tant qu'on y est, et ne pas mettre les coudes sur la table. Vivre plus longtemps.
Plus longtemps que quoi? Que qui?
Ma Cigarette, je vous le dis tout net, elle a une espérance de vie qui dépasse rarement les 5 minutes et c'est très bien comme ça (bis)(ter). Mais, comme je suis toute à elle et elle, ô combien toute à moi, ce sont les 5 minutes les meilleures de sa vie.
Ca tombe bien, elle n'en n'aura pas d'autres.
Quand j'approche le briquet, elle frétille comme une pimbêche au bal de promo et le bic -noir de préférence- se la joue sobre, une petite flamme et pis, c'est marre, il s'en retourne dans sa poche chérie; C'est pas un mec facile, ce briquet.
Ca crépite, ca "frchit" dans l'univers, ma gauloise blonde bleue se souvient de toutes les fois où je me suis jetée sur elle, frénétique, en sortant d'une séance de cinéma où De Niro fumait de manière obsènement communicative. Quand De Niro fume, l'ingé son devient un génie du détail, un r.p. marlboro, il communique les moindres frétillements du papier, l'ardeur avec laquelle la nicotine râpe la gorge déjà empêtrée de la star d'Hollywood, et la moiteur du filtre qui se décolle de la bouche. Sans parler du moment où la chose est écrabouillée dans un cendrier déjà rempli. Ce son là qui me donne envie de partir de la salle en courant pour absolument mettre ma blonde aux yeux bleux dans mon sang rouge. Il faudrait faire une bande originale des moments de cigarette au cinéma.
Quand j'en suis à la moitié, parfois, je me lasse. Si par malheur, je l'installe dans son panier de cendrier parce que je dois faire quelque chose avec deux mains, quand je reviens vers elle, cette fumée grisâtre m'ennuie, alors, dans un réflexe tout à fait pavlovien, je la fume encore la coquine, mais avec une hâte réservée normalement aux connasses qui s'avèrent décevantes une fois qu'on les a déshabillées. On n'en voulait plus, bon, c'est juste là, alors d'accord, on en veut encore, c'est sous le coude, donc pourquoi pas, mais sans enthousiasme, ne vous emballez pas non plus, on va faire ça rapide, l'air de rien et vite passer à autre chose.
Pourtant, je vous le donne en mille, en deux mille, en... en combien vous voudrez, en chameaux si ça vous arrange, au moment où ma main va pour s'en séparer, quand le cendrier croit voir arriver son quatre heures, non, ma tête en veut encore. Ma tête dit à ma main qu'elle ne veut pas que ça s'arrête comme ça, qu'elle aime encore cette blonde aux yeux bleux, que, non, elle ne veut pas la quitter. C'est pas de cette façon qu'on traite une vieille amie, un peu de respect bon sang. Bon sang nicotiné qui manque d'oxygène.
J'ai pas envie de me préserver. J'imagine que je n'accorde pas beaucoup d'importance aux années. Et pourtant, je les aime toutes, une par une, sur le coup, d'une force herculéenne. Parfois même je les considère au point de les disséquer en mois, pourquoi pas en semaine, et chaque jour est un jour, un vrai jour, le seul.
Arrêter de fumer. J'aurais trop peur de devoir me prendre en main, main à qui ça allait si bien de fumer. Arrêter tout, et peut-être que respirer aussi c'est dangereux. D'ailleurs, dites donc, vivre ça ferait pas mourir par hasard?
Et peut-être que c'est pas grave surtout. Qu'est ce qu'on est, nous, petites crottes, pour vouloir vivre absolument jusqu'à la fin des temps?
La fin des temps, même des miens, je meurs pas d'envie de les vivre.
Vous me raconterez.
-maispastrop-
Beaucoup d'entre eux, d'entre nous, des miens. Ils arrêtent et comptent les jours passés sans, cochent parfois les jours sur les calendriers, même.
Je croyais qu'on comptait les jours qu'il nous restait à vivre tandis qu'eux, d'une certaine façon, comptabilisent ceux qu'ils gagnent peut-être.
Le petit fil peine parfois à se séparer de l'emballage, mais quand on s'y prend bien, c'est un de ces gestes gratifiants que j'affectionne tant il est limpide et constructif. En effet, une fois le plastique mis à part, on arrive au vif du sujet, au centre de l'attention, l'objet du désir. On n'a pas fait tout ça pour rien.
Quand je la sors du paquet, le bruit est soyeux. Comme de la soie, oui. De la soie qui se frotterait à une autre soie, mais dans le bon sens du terme, le bon sens du poil, pas celui qui fait grincer des dents. Deux bouts de soie dans la même direction, un accord de mélodie tout à fait pop et élégant.
Quand je l'attrape entre mon index et mon doigt d'honneur, entre ce que je pointe et ce que j'emmerde, elle trouve sa place, elle est comme à la maison. Fais comme chez moi, je lui dis.
D'ailleurs ma maison sent un peu comme elle en fin de semaine, je sais c'est mal, mais il se trouve que c'est comme ça, elle prend son odeur. Un amoureux dort deux nuits de suite sur un de vos oreillers et le tissu de la taie adopte l'odeur de sa nuque. Je passe mon dimanche au lit avec elle, et c'est itou, c'est comme ça, disais-je. Pas autrement. Et quand on dit "c'est comme ça", c'est une manière à peine déguisée de faire comprendre que vos critiques n'y changeront rien et qu'on s'en fout comme de l'an 40, ma gauloise blonde bleue et moi.
Quand je l'amène à ma bouche, mes lèvres se tendent vers elle avec une habitude lassive, comme vers un amant trop connu et dont on ne peut pourtant pas se passer, qui fait toujours, encore, battre le coeur après tant d'années de vie commune.
Déjà, mon sang s'agite, mon coeur l'accompagne, mon organe vital est bien obligé de suivre ma circulation vous me direz. Ou peut-être est-ce l'inverse. Tous les deux sont pourtant d'accord sur un point: c'est pas une bonne fréquentation, cette blonde aux yeux bleus, on court à notre perte, faut arrêter, faut plus la voir, lui refuser l'entrée, quelque chose, mais ne plus l'accueillir et la faire circuler dans les poumons, la gorge, sur la langue, entre les dents, sur le bouts des doigts, ça suffit, merde.
Ca suffit.
Et pourtant.
Regardez comme ça change son fusil d'épaule, tout cet attirail de revendication, dès qu'une carotte rouge clignote sur un trottoir parisien.
J'aime arriver chez mon buraliste et ne pas avoir à prononcer un seul mot; je pourrais même, si je le voulais, garder la musique dans mes oreilles et me contenter de le contenter d'un simple sourire, mais, j'ôte toujours -par politesse- un écouteur et lui souris pendant qu'il attrape déjà mon paquet alors que j'ai à peine fini de dire "bonjour".
Un par jour. Un paquet. Un homme, un film, un verre de vodka, un livre, un rêve, un texte, un plat. Et toutes ces cigarettes de ce seul paquet qui accompagnent l'homme, le film, la vodka, le livre, le texte, le rêve, le plat.
Parfois deux.
Les grands soirs. Deux paquets et généralement une moitié d'homme, je me sens comme la cinémathèque après 9 verres de vodka, où est mon livre, je rêve pas je ronfle, et j'ai rien à écrire d'façon, ou trop de choses; j'ai pas faim mais je mangerais bien 4 bavettes à l'échalotte. Ou toi.
Et toujours ces cigarettes pour témoigner de tout"ça".
Si un jour on me juge extraordinaire au point de mériter une biographie, je voudrais que ce soit mes tiges qui s'en chargent parce qu'elles savent tout de ce que les journalistes et les paparazzis n'auront pas pu attraper, dans la salle de bain le matin ou tard, très-trop tard, presque tôt, au lit. Elles savent tout.
Et elles se gêneront pas pour balancer, elles n'ont pas de scrupule. Elles sont pas là pour ça.
Ils arrêtent tous parce que le temps passe, -oui il fait ça souvent le temps- et que la nicotine commence à essouffler peut-être, à griser le teint ou je ne sais quoi. Quand est ce qu'ils prennent cette bizarre décision, je me demande. Quand ils peinent à monter 6 étages d'un seul souffle? Ou parce qu'il est écrit qu'il faut devenir sérieux, à un moment donné, et faire des enfants par exemple pour fêter ça. Ce qui est, nous sommes d'accord, la pire preuve de sérieux qui existe. Ils arrêtent donc parce qu'ils veulent s'occuper d'eux, non? J'entends par là, prendre soin de leur corps, espérer qu'ils passeront entre les mailles des milliards de filets des millions de cancers, manger bio peut-être, faire du sport, se coucher tôt, tiens, tant qu'on y est, et ne pas mettre les coudes sur la table. Vivre plus longtemps.
Plus longtemps que quoi? Que qui?
Ma Cigarette, je vous le dis tout net, elle a une espérance de vie qui dépasse rarement les 5 minutes et c'est très bien comme ça (bis)(ter). Mais, comme je suis toute à elle et elle, ô combien toute à moi, ce sont les 5 minutes les meilleures de sa vie.
Ca tombe bien, elle n'en n'aura pas d'autres.
Quand j'approche le briquet, elle frétille comme une pimbêche au bal de promo et le bic -noir de préférence- se la joue sobre, une petite flamme et pis, c'est marre, il s'en retourne dans sa poche chérie; C'est pas un mec facile, ce briquet.
Ca crépite, ca "frchit" dans l'univers, ma gauloise blonde bleue se souvient de toutes les fois où je me suis jetée sur elle, frénétique, en sortant d'une séance de cinéma où De Niro fumait de manière obsènement communicative. Quand De Niro fume, l'ingé son devient un génie du détail, un r.p. marlboro, il communique les moindres frétillements du papier, l'ardeur avec laquelle la nicotine râpe la gorge déjà empêtrée de la star d'Hollywood, et la moiteur du filtre qui se décolle de la bouche. Sans parler du moment où la chose est écrabouillée dans un cendrier déjà rempli. Ce son là qui me donne envie de partir de la salle en courant pour absolument mettre ma blonde aux yeux bleux dans mon sang rouge. Il faudrait faire une bande originale des moments de cigarette au cinéma.
Quand j'en suis à la moitié, parfois, je me lasse. Si par malheur, je l'installe dans son panier de cendrier parce que je dois faire quelque chose avec deux mains, quand je reviens vers elle, cette fumée grisâtre m'ennuie, alors, dans un réflexe tout à fait pavlovien, je la fume encore la coquine, mais avec une hâte réservée normalement aux connasses qui s'avèrent décevantes une fois qu'on les a déshabillées. On n'en voulait plus, bon, c'est juste là, alors d'accord, on en veut encore, c'est sous le coude, donc pourquoi pas, mais sans enthousiasme, ne vous emballez pas non plus, on va faire ça rapide, l'air de rien et vite passer à autre chose.
Pourtant, je vous le donne en mille, en deux mille, en... en combien vous voudrez, en chameaux si ça vous arrange, au moment où ma main va pour s'en séparer, quand le cendrier croit voir arriver son quatre heures, non, ma tête en veut encore. Ma tête dit à ma main qu'elle ne veut pas que ça s'arrête comme ça, qu'elle aime encore cette blonde aux yeux bleux, que, non, elle ne veut pas la quitter. C'est pas de cette façon qu'on traite une vieille amie, un peu de respect bon sang. Bon sang nicotiné qui manque d'oxygène.
J'ai pas envie de me préserver. J'imagine que je n'accorde pas beaucoup d'importance aux années. Et pourtant, je les aime toutes, une par une, sur le coup, d'une force herculéenne. Parfois même je les considère au point de les disséquer en mois, pourquoi pas en semaine, et chaque jour est un jour, un vrai jour, le seul.
Arrêter de fumer. J'aurais trop peur de devoir me prendre en main, main à qui ça allait si bien de fumer. Arrêter tout, et peut-être que respirer aussi c'est dangereux. D'ailleurs, dites donc, vivre ça ferait pas mourir par hasard?
Et peut-être que c'est pas grave surtout. Qu'est ce qu'on est, nous, petites crottes, pour vouloir vivre absolument jusqu'à la fin des temps?
La fin des temps, même des miens, je meurs pas d'envie de les vivre.
Vous me raconterez.
-maispastrop-
Inscription à :
Articles (Atom)