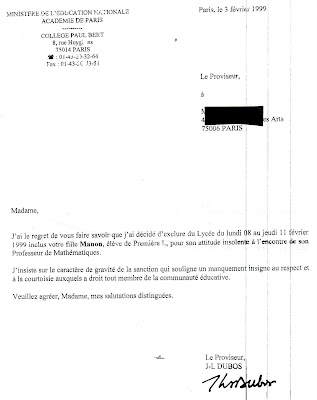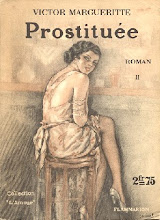La vie en fille d'attente.
Parfois, c’est d’une vie de vieille fille dont j’ai besoin.
Une vieille fille riche, s’entend.
Un grand appartement, aux couloirs interminables agrémentés de cadres remplis de photos sépia de familles qu’on a peut-être jamais connues, qui ne sont même pas des branches de mon arbre, si ça se trouve. Un piano, qui prend la poussière à force de n’être que trop peu aimé. Des livres reliés, aux pages encore scellées. Un plancher en bois ciré, un de ceux qui grince dès qu’on y fait 2,3 pas de fox trot de trop.
Et un environnement de vieux, plongé dans la naphtaline. Quelque chose qui serait déjà décalé de la vie, du cours de la vie, et figé pour toujours, en dehors, ailleurs, envers et contre les modes des canapés design et des feng shui-fait chier.
La rue pourrait continuer de fourmiller, le JT pourrait annoncer encore des nouvelles morts, des menaces, un tremblement de terre imminent, peut-être, rien ne bougerait. Paisible. Inaltérable. Loin.
Un contexte qui ne me rappellerait en rien, jamais, que j’ai, paraît-il, toute la vie devant moi.
Parce que c’est en ayant toute la vie devant moi que je prends le temps de ne jamais m’en occuper. Je ne prends jamais le temps de m’en occuper, de ma vie devant moi, parce que j’ai des amis de mon âge à voir, de la vodka à boire, des nuits à rattraper, des livres à dévorer, des séries américaines à empiffrer, des rues à arpenter, des trains à rater et beaucoup, beaucoup d’entre deux. Un état mi-pensif mi-léthargique qui m’amène à m’installer à mon bureau et à laisser mes yeux traîner sur les tickets de carte bleue du week-end. Pendant plusieurs heures, j’veux dire, mes yeux font ça, ils traînent sur les tickets de carte bleue du week-end.
Si seulement ces tickets de carte bleue m’inspiraient une idée révolutionnaire qui renverserait le monde et étoufferait les méchants... Mais non, devant ces tickets où, déjà, le carbone pâlit, je me pâme, d’abord, d’avoir passé une formidable soirée. Je découvre ensuite le montant, formidable, lui, aussi. Et puis, je blêmis et j’essaie de me rappeler. C’est moi, la méchante étouffée, maintenant. De formidable, ma soirée passe à formidiable. C’est comme ça que je dis, depuis peu, pour qualifier une soirée dont je pourrais jurer qu’elle était sensas’ mais que je ne peux me remémorer que par shots de souvenirs. Et puis, généralement, c’est à ce moment là que je pense à l’incalculable quantité d’€ investis dans des trous noirs. Autant de biffetons, qui, si je les avais économisé consciencieusement, m’auraient permis de ne plus avoir peur d’en dépenser plus que je n’en ai. Je vis tellement au dessus de mes moyens que de tout là haut, ils ont l’air encore plus petits.Il paraît que ça peut pas durer.
Je ne suis pas la première à le dire, je serai pas non plus la dernière: si j’avais été très riche, j’aurais été autrement géniale. J’aurais offert à ma vie ce que je lui promettais, petite, dans le Dear Diary.
Je ne dis pas que j’aurais exclusivement oeuvré pour l’humanité ou remué ciel et terre pour la couche d’ozone. Si ça se trouve, j’aurais même pas «fait» danseuse étoile qui sauve des lions pendant les vacances. J’aurais été la même finalement, mais en mieux, en un million d’€ de fois mieux.
Une sorte d’oisive jouisseuse, sur un plus beau canapé. Entourée d’horloges qui n’indiquent que les saisons. C’est vraiment tout ce qui compte, les saisons; les heures, elles ont même pas de personnalité à elles.
Et, surtout, quelqu’un se serait occupé de ranger le désordre de mon jeudi soir. Alors, le vendredi, j’aurais pu m’attabler devant un bureau débarrassé de tous ces tickets de carte bleue; un bureau ami, qui ne m’aurait pas déconcentrée. Et, cerise sur Ladurée, je n’aurais pas culpabilisé.
Pour qu’il n’y ait pas méprise, je le précise: je suis pas à plaindre, et d’ailleurs, je ne me plains pas. Je sais simplement que l’argent et le temps me gâchent. L’argent que je n’ai pas, le temps que j’ai décidé de prendre quand même. L’argent qui manque et le temps qu’il reste, en somme.
Personnellement, je n’ai..., je n'aurais aucun problème avec l’idée de vivre dans un lit à écrire et lire et et manger, et d’autres trucs qu’on fait allongée et du genre qu’on couche pas sur le papier. L’ambition, la carrière, la reconnaissance, tout ça, ça me passe bien au dessus de mon mètre 60. Un peu trop, j'imagine.
Mais voilà, d’après mon banquier, je ne peux tout simplement pas me le permettre et j’ose dire que je trouve ça incroyablement injuste, ne pas pouvoir se permettre ce pour quoi on a été taillée. Surtout dans la mesure où, non, tout le monde n’aimerait pas vivre au lit à lire et écrire et tout le reste. Non. Je ne prendrais la place de personne. C'est pas vrai. Vous, par exemple, aimeriez-vous le faire? Il y a suffisamment de gens qui veulent déplacer des montagnes, monter une entreprise ou faire des enfants comme ça, il n’y a que ça, d’ailleurs.
Pour de vrai, moi qui aime tellement ne rien faire, je trouve absurde de n’être pas née riche héritière.
C’est un truc que j’ai mis dans ma liste des 10 choses les plus injustes de ma vie, «ne pas être une riche héritière». Et c’est en deuz. La première c’est d’être du genre à mettre cette injustice en deuxième position. La troisième c’est d’être un petit peu folle, bon. Tout ça se goupille finalement pas mal.
Mais le fait d’être un petit peu folle est aussi dans la liste des choses dont je suis contente d’être habitée sans avoir rien demandé. Oui, j’ai aussi cette liste là. Quoi? Je suis un petit peu folle, c’est tout. Et je m’en plains et m’en vante en 3° position de toutes mes listes. Oui, parce que, j’ai d’autres listes. Celles, des livres, des restaurants, des cocktails, des pays, des connards que, si je les croise je leur crache à la gueule, des amours que, s’ils me toisent, je les prends dedans mes bras. A chaque fois, ce qui arrive en 3°, c’est que, soit je suis un petit peu folle, soit, je m’excuse du choix fou du 2° de la liste à cause de ma petite folie.
Une vie de demoiselle, à l’horizontale, d’où tout est toujours plus joli.
Le droit de ne pas me préoccuper du monde, de ne même pas me demander comment je pourrai(s) être utile au déroulement de ce monde, de ne surtout pas réaliser que je ne suis rien et que je ne serai jamais utile à ce pauvre, pauvre monde où toutes les verticalités annoncent autant d’effondrements que les nineoneone et autres esclaves, morts debout pour construire la tour de Shanghai la plus haute de la terre alors qu’on est jamais aussi bien que couché, et que c'est comme ça qu'on devrait tous mourir.
Une vie de vieille fille, à n’écouter que les radios qui parlent de musique classique et à éviter tout ce qui concerne de près ou de loin, l’Actualité.
Une vie d'ermite, où, cependant, les sushis seraient livrés plus vite, et meilleurs que dans les autres quartiers.
Une vie sans vous, j’imagine, aussi.
Pourtant.
Souvent, c’est une vie de jeune maboule que je mène. J’écris sur la poussière du piano «me voy a la nouba bambalaya, hasta la vista, baby» et avec les virgules.
Je m’écoute parler, avoir des avis sur la vie, la mort, la peine, la peine de mort, l’avortement, et l’amour. Je me moque de moi. Je suis à mon propre spectacle: une demoiselle qui, avec des amis, échange sur ce que d’autres connaissent mieux, connaissent, tout court, mais n'arrivent justement pas à tourner à la plaisanterie. Je me moque de nous. Nous me faisons rire. Et je souris en rêvant, repoussant ce bruit de fin du monde que fait mon réveil pour m’indiquer que la vie m’attend. Qu’elle n’attend que moi, paraît-il.
J’espère qu’elle est patiente.
-maispastrop-
Une vieille fille riche, s’entend.
Un grand appartement, aux couloirs interminables agrémentés de cadres remplis de photos sépia de familles qu’on a peut-être jamais connues, qui ne sont même pas des branches de mon arbre, si ça se trouve. Un piano, qui prend la poussière à force de n’être que trop peu aimé. Des livres reliés, aux pages encore scellées. Un plancher en bois ciré, un de ceux qui grince dès qu’on y fait 2,3 pas de fox trot de trop.
Et un environnement de vieux, plongé dans la naphtaline. Quelque chose qui serait déjà décalé de la vie, du cours de la vie, et figé pour toujours, en dehors, ailleurs, envers et contre les modes des canapés design et des feng shui-fait chier.
La rue pourrait continuer de fourmiller, le JT pourrait annoncer encore des nouvelles morts, des menaces, un tremblement de terre imminent, peut-être, rien ne bougerait. Paisible. Inaltérable. Loin.
Un contexte qui ne me rappellerait en rien, jamais, que j’ai, paraît-il, toute la vie devant moi.
Parce que c’est en ayant toute la vie devant moi que je prends le temps de ne jamais m’en occuper. Je ne prends jamais le temps de m’en occuper, de ma vie devant moi, parce que j’ai des amis de mon âge à voir, de la vodka à boire, des nuits à rattraper, des livres à dévorer, des séries américaines à empiffrer, des rues à arpenter, des trains à rater et beaucoup, beaucoup d’entre deux. Un état mi-pensif mi-léthargique qui m’amène à m’installer à mon bureau et à laisser mes yeux traîner sur les tickets de carte bleue du week-end. Pendant plusieurs heures, j’veux dire, mes yeux font ça, ils traînent sur les tickets de carte bleue du week-end.
Si seulement ces tickets de carte bleue m’inspiraient une idée révolutionnaire qui renverserait le monde et étoufferait les méchants... Mais non, devant ces tickets où, déjà, le carbone pâlit, je me pâme, d’abord, d’avoir passé une formidable soirée. Je découvre ensuite le montant, formidable, lui, aussi. Et puis, je blêmis et j’essaie de me rappeler. C’est moi, la méchante étouffée, maintenant. De formidable, ma soirée passe à formidiable. C’est comme ça que je dis, depuis peu, pour qualifier une soirée dont je pourrais jurer qu’elle était sensas’ mais que je ne peux me remémorer que par shots de souvenirs. Et puis, généralement, c’est à ce moment là que je pense à l’incalculable quantité d’€ investis dans des trous noirs. Autant de biffetons, qui, si je les avais économisé consciencieusement, m’auraient permis de ne plus avoir peur d’en dépenser plus que je n’en ai. Je vis tellement au dessus de mes moyens que de tout là haut, ils ont l’air encore plus petits.Il paraît que ça peut pas durer.
Je ne suis pas la première à le dire, je serai pas non plus la dernière: si j’avais été très riche, j’aurais été autrement géniale. J’aurais offert à ma vie ce que je lui promettais, petite, dans le Dear Diary.
Je ne dis pas que j’aurais exclusivement oeuvré pour l’humanité ou remué ciel et terre pour la couche d’ozone. Si ça se trouve, j’aurais même pas «fait» danseuse étoile qui sauve des lions pendant les vacances. J’aurais été la même finalement, mais en mieux, en un million d’€ de fois mieux.
Une sorte d’oisive jouisseuse, sur un plus beau canapé. Entourée d’horloges qui n’indiquent que les saisons. C’est vraiment tout ce qui compte, les saisons; les heures, elles ont même pas de personnalité à elles.
Et, surtout, quelqu’un se serait occupé de ranger le désordre de mon jeudi soir. Alors, le vendredi, j’aurais pu m’attabler devant un bureau débarrassé de tous ces tickets de carte bleue; un bureau ami, qui ne m’aurait pas déconcentrée. Et, cerise sur Ladurée, je n’aurais pas culpabilisé.
Pour qu’il n’y ait pas méprise, je le précise: je suis pas à plaindre, et d’ailleurs, je ne me plains pas. Je sais simplement que l’argent et le temps me gâchent. L’argent que je n’ai pas, le temps que j’ai décidé de prendre quand même. L’argent qui manque et le temps qu’il reste, en somme.
Personnellement, je n’ai..., je n'aurais aucun problème avec l’idée de vivre dans un lit à écrire et lire et et manger, et d’autres trucs qu’on fait allongée et du genre qu’on couche pas sur le papier. L’ambition, la carrière, la reconnaissance, tout ça, ça me passe bien au dessus de mon mètre 60. Un peu trop, j'imagine.
Mais voilà, d’après mon banquier, je ne peux tout simplement pas me le permettre et j’ose dire que je trouve ça incroyablement injuste, ne pas pouvoir se permettre ce pour quoi on a été taillée. Surtout dans la mesure où, non, tout le monde n’aimerait pas vivre au lit à lire et écrire et tout le reste. Non. Je ne prendrais la place de personne. C'est pas vrai. Vous, par exemple, aimeriez-vous le faire? Il y a suffisamment de gens qui veulent déplacer des montagnes, monter une entreprise ou faire des enfants comme ça, il n’y a que ça, d’ailleurs.
Pour de vrai, moi qui aime tellement ne rien faire, je trouve absurde de n’être pas née riche héritière.
C’est un truc que j’ai mis dans ma liste des 10 choses les plus injustes de ma vie, «ne pas être une riche héritière». Et c’est en deuz. La première c’est d’être du genre à mettre cette injustice en deuxième position. La troisième c’est d’être un petit peu folle, bon. Tout ça se goupille finalement pas mal.
Mais le fait d’être un petit peu folle est aussi dans la liste des choses dont je suis contente d’être habitée sans avoir rien demandé. Oui, j’ai aussi cette liste là. Quoi? Je suis un petit peu folle, c’est tout. Et je m’en plains et m’en vante en 3° position de toutes mes listes. Oui, parce que, j’ai d’autres listes. Celles, des livres, des restaurants, des cocktails, des pays, des connards que, si je les croise je leur crache à la gueule, des amours que, s’ils me toisent, je les prends dedans mes bras. A chaque fois, ce qui arrive en 3°, c’est que, soit je suis un petit peu folle, soit, je m’excuse du choix fou du 2° de la liste à cause de ma petite folie.
Une vie de demoiselle, à l’horizontale, d’où tout est toujours plus joli.
Le droit de ne pas me préoccuper du monde, de ne même pas me demander comment je pourrai(s) être utile au déroulement de ce monde, de ne surtout pas réaliser que je ne suis rien et que je ne serai jamais utile à ce pauvre, pauvre monde où toutes les verticalités annoncent autant d’effondrements que les nineoneone et autres esclaves, morts debout pour construire la tour de Shanghai la plus haute de la terre alors qu’on est jamais aussi bien que couché, et que c'est comme ça qu'on devrait tous mourir.
Une vie de vieille fille, à n’écouter que les radios qui parlent de musique classique et à éviter tout ce qui concerne de près ou de loin, l’Actualité.
Une vie d'ermite, où, cependant, les sushis seraient livrés plus vite, et meilleurs que dans les autres quartiers.
Une vie sans vous, j’imagine, aussi.
Pourtant.
Souvent, c’est une vie de jeune maboule que je mène. J’écris sur la poussière du piano «me voy a la nouba bambalaya, hasta la vista, baby» et avec les virgules.
Je m’écoute parler, avoir des avis sur la vie, la mort, la peine, la peine de mort, l’avortement, et l’amour. Je me moque de moi. Je suis à mon propre spectacle: une demoiselle qui, avec des amis, échange sur ce que d’autres connaissent mieux, connaissent, tout court, mais n'arrivent justement pas à tourner à la plaisanterie. Je me moque de nous. Nous me faisons rire. Et je souris en rêvant, repoussant ce bruit de fin du monde que fait mon réveil pour m’indiquer que la vie m’attend. Qu’elle n’attend que moi, paraît-il.
J’espère qu’elle est patiente.
-maispastrop-
Sans laisser d'adresse
( Si vous n'avez pas pris l'avion cet été, il y a assez peu de chances pour que vous ayez pu vous délécter de cette nouvelle estivale. Ca aurait été terriblement dommage de passer au dessus, n'est ce pas? )
Ce matin encore, je me suis levé à l’aube. Mes yeux n’en voulaient pas, mais mon corps a forcé la
main, et dans la salle de bain, je me suis rappelé que j’étais matinal pour une bonne raison. La
meilleure qui existe. La seule, peut-être. Dans le rétroviseur, le chauffeur de taxi surveillait mon
sourire d’un air suspect; c’est à dire qu’on est plus vraiment habitués aux gens heureux. Une fois
arrivé, j’ai compté avec satisfaction les minutes d’avance que j’avais devant moi, je me suis installé
et j’ai attendu.
Ca y est, voilà, je ne ressens plus aucune fatigue. Au lieu de ça, une excitation gamine
circule un peu partout dans un corps que j’estime à chaque fois trop vieux pour s’emballer à ce
point. Je me sens bien, ici; ça me fait cet effet à tous les coups, j’ai l’impression d’être à ma place
plus que nulle part ailleurs. Il y a cette possibilité latente de partir n’importe où, il y a des étrangers
à tous les coins de salles d’attente, et des bagages remplis de souvenirs. Il y a, au delà de tout,
une conviction qu’on n’appartient jamais à rien ni à personne; conviction qui resplendit mieux que
jamais, là, dans cet endroit où tout semble pourtant me posséder tellement il me rend vivant. Je
me sens bien. Je les regarde.
Je pourrais être cet homme, à ma droite, qui -si l’on en croit l’empressement qu’il met à se
recoiffer chaque minute- doit certainement retrouver une femme qui lui procure aussi pas mal de
sensations. Je pourrais être cet enfant, qui voyage seul, mais semble accompagné, pourtant, de
toutes ses frasques estivales, comme si elles le protégeaient d’une aura ensoleillée. Je pourrais
être cette femme, cernée par un chagrin que le lieu public et la proximité avec des étrangers
n’arrivent pas à contenir, et qui pleure parce que... elle a du perdre quelqu’un. J’imagine. Peut-être
se rend-elle à un enterrement. Je pourrais être cette femme, mais je ne préfère pas.
Il se trouve que je suis un homme qui aime les aéroports comme certains enfants raffolent des
confiseries: sans retenue, absolument, quitte à s’y casser les dents.
J’ai la chance de les fréquenter 2 à 3 fois par mois. Je me rends bien compte que c’est un luxe.
J’ai lu un truc, un article assez sérieux, qui expliquait que beaucoup de gens n’avaient jamais pris
l’avion. C’est à dire: jamais de leur vie. Des gens que j’ai peut-être croisés dans le métro, et tout.
L'intérêt de l’article consistait à s'intéresser à des témoins qui étaient déjà vieux. Parce que, moi
non plus, à 25 ans, je n’avais jamais pris l’avion. Or, ces gens, dans l’article respectable, là, ils
avaient un âge tout à fait idéal pour attraper le lecteur, faire en sorte qu’il se sente sinon concerné,
au moins compatissant. J’avais compati à fond les ballons. Je me souviens «Paul a vécu 67 ans
dans le Larzac et ne l’a jamais quitté». 67 ans quand même, c’est pas rien, je me dis.
Je me demande s’il y a un Paul, près de moi, qui part pour la première fois.
Les passagers à destination de leur destin sont priés de se présenter porte 5, merci.
L’appel de mon vol interrompt le cours de mes pensées, c’est aussi ce que j’aime dans les
aéroports, ça va, ça vient ; je me lève, je n’y pense plus, à Paul, aux autres, aux premières fois. Je
suis simplement un homme qui aime les aéroports, à chaque fois. Je lance le chariot à bagages,
en prenant soin d’appuyer mes avants bras sur la résistance, pour que ça ne freine pas. C’était
pas comme ça, les chariots, y’a encore une dizaine d’années. Je n’ai pas de réels bagages, je ne
pars que quelques jours, mais je maîtrise comme personne les virages de chariots à Orly.
L’attente n’est pas trop longue et les hôtesses sont... hospitalières même si leurs jupes sont un
peu longues à mon goût. J’ai envie de demander les menus mais, par timidité, je préfère attraper
des journaux que je ne lirai pas, en souriant nonchalamment. Ca fait plus sérieux, je crois, la
nonchalance.
-C’est ça, 30% alors?
-Oui oui, je vous dis, j’ai lu cet article moi aussi. 30% des Français.
-Mais... 30%... c’est précis...
-... Vous vous demandez si je bluffe.
-Non, pas du tout, je...
-Si, si, je le vois bien. Je comprends d’ailleurs. C’est suspect de tomber sur quelqu’un qui, hop,
précisément connaît les chiffres d’une enquête dont on lui parle, comme ça, en voisin d’avion.
-Suspect, je ne sais pas, mais... Bon, 30% quand même, ça me paraît assez énorme.
-Vous voulez savoir pourquoi je sais ça, et tout le reste de l’enquête d’ailleurs?
-Je veux tout savoir et ça en particulier.
-Parce que je n’avais moi-même jamais pris l’avion avant aujourd’hui.
Mon sang fait mille tours.
-Jamais, jamais?
-De toute ma vie. Et avant que vous n’ayez la courtoisie de ne pas me demander mon âge, je vous
le confie: 39 ans. En 39 ans, j’avais jamais pris l’avion, voilà.
-... Mais qu’est ce que vous avez fait, alors, pendant tout ce temps?
-Autant vous dire que l’enquête m’a parlé. J’ai même découpé l’article. Et, pour ne rien vous
cacher, je l’ai relu hier soir. J’aurais du le prendre, tiens, je vous les aurais montrés les 30%.
-Et, vous n’étiez jamais allé dans un aéroport?
-Ah si, si. Je viens souvent chercher maman. Elle me visite pendant les soldes. Elle est très...
-Intéressée par la mode?
-Radine.
L'hôtesse hospitalière nous sert nos plats. Pierre et moi, on échange un peu plus que des idées, il
me donne son beurre, je lui offre mon dessert, c’est une affaire qui roule.
-Et (là, je parle la bouche pleine, mais la curiosité me dépasse), ça vous fait quoi, alors, de prendre
l’avion pour la première fois?
Il me regarde en mastiquant. Le pain est un chouia caoutchouteux, ça doit être pour ça.
-Vous êtes bien curieux. Ca vous fascine, mon dépucelage aérien?
-Je crois que, oui, ça me fascine, oui. Vous savez, moi je suis accro à ça, les avions, les voyages,
les aéroports et tout, alors... vous êtes une sorte d’ovni pour moi.
-Ah vous travaillez dans le voyage alors?
-Non, pas du tout, je travaille dans le textile. J’achète des tissus, pour faire court. Par internet,
depuis mon bureau, à Paris. Et puis, je pars vérifier le matériel, enfin, vous voyez.
-Et, ce qui vous fascine, c’est les voyages?
-Oui. Et les aéroports, les départs, les avions. Tout ça.
-C’est étonnant de travailler dans un bureau quand on est attiré par l’instant et le mouvement,
non?
Nous traversons actuellement une légère zone de turbulences, veillez à ne pas perdre la
tête, merci.
Mon sang s’arrête. Il me gifle en freinant. J’ai dans les bras un fourmillement désagréable et
anesthésiant, au point que j’hésite à sonner l'hôtesse. J’adore sonner l'hôtesse mais j’ai passé
l’âge, alors, comme un grand, je m’interdis tout le temps de le faire.
-Vous vous sentez bien?
En fait, oui, je me sens parfaitement nickel, je crois même que je frôle la béatitude: il aura fallu que
Pierre, un parfait inconnu, pousse des portes que j’avais déjà entrouvertes, dans ma petite tête,
pour que l’évidence s’impose d’elle même. Je finis ma mignonnette d’un seul trait.
Je ne dors pas, j’attends. J’ai déjà relevé ma tablette, et ma ceinture frétille à l’idée d’être
raccrochée. L’arrivée pointe son nez, et, avec elle, mon irrévocable départ. Aujourd’hui, j’accorde
une attention toute particulière à l’annonce du capitaine concernant l’heure, la température et tout
le toutim. Pour être honnête, j’avais presque oublié ma destination, et je découvre avec joie que la
météo de juin à Tel-Aviv n’est pas très différente de celle de Paris. Mes 2 costumes feront l’affaire
le temps que je m'acclimate. J’ouvre ma sacoche dans laquelle je pensais n’avoir pris que
l’essentiel: les coordonnées du vendeur de soie, mon téléphone, mon ordinateur et mon billet de
retour. Elles apparaissent alors comme les choses les plus superflues que j’ai été amené à voir de
toute ma mini vie. Je ne suis pas pressé de sortir, je laisse les impatients se ruer dans les allées
embouteillées et je me lève après tout le monde. Ca me laisse le loisir d’observer, encore, ces
gens en transit, remplis d’émotions et d’attentes. C’est la toute première fois que je sors en
dernier, ça me permet de relever la fatigue sur les sourires des hôtesses; sourires que j'interprète
néanmoins comme des encouragements.
-Nous espérons que vous avez fait un bon voyage en notre compagnie.
-«Le meilleur» me dis-je, en serrant fort contre moi la sacoche qui contient tout ce dont je veux
maintenant me séparer.
Le hall fourmille. Je jette un dernier regard à mon ordinateur, à mon téléphone et: poubelle. Je
déchire le billet de retour en plein de tous petits morceaux. Paris s’effrite. Je n’ai pas la moindre
idée de l’endroit où je vais aller; et je sais que Louise serait dubitative quant à la manière dont je
décide tout à coup de recommencer ma vie. Mais, après tout, qu’est ce que ça peut me faire? Je
n’ai plus de femme, je n’ai plus rien, je suis comme neuf avec 2 costumes et 2 jours pour
construire une existence qui m’attend depuis mon premier hall d’aéroport. J’espère que quelqu’un
pensera à arroser le ficus du bureau.
-maispastrop-
Ce matin encore, je me suis levé à l’aube. Mes yeux n’en voulaient pas, mais mon corps a forcé la
main, et dans la salle de bain, je me suis rappelé que j’étais matinal pour une bonne raison. La
meilleure qui existe. La seule, peut-être. Dans le rétroviseur, le chauffeur de taxi surveillait mon
sourire d’un air suspect; c’est à dire qu’on est plus vraiment habitués aux gens heureux. Une fois
arrivé, j’ai compté avec satisfaction les minutes d’avance que j’avais devant moi, je me suis installé
et j’ai attendu.
Ca y est, voilà, je ne ressens plus aucune fatigue. Au lieu de ça, une excitation gamine
circule un peu partout dans un corps que j’estime à chaque fois trop vieux pour s’emballer à ce
point. Je me sens bien, ici; ça me fait cet effet à tous les coups, j’ai l’impression d’être à ma place
plus que nulle part ailleurs. Il y a cette possibilité latente de partir n’importe où, il y a des étrangers
à tous les coins de salles d’attente, et des bagages remplis de souvenirs. Il y a, au delà de tout,
une conviction qu’on n’appartient jamais à rien ni à personne; conviction qui resplendit mieux que
jamais, là, dans cet endroit où tout semble pourtant me posséder tellement il me rend vivant. Je
me sens bien. Je les regarde.
Je pourrais être cet homme, à ma droite, qui -si l’on en croit l’empressement qu’il met à se
recoiffer chaque minute- doit certainement retrouver une femme qui lui procure aussi pas mal de
sensations. Je pourrais être cet enfant, qui voyage seul, mais semble accompagné, pourtant, de
toutes ses frasques estivales, comme si elles le protégeaient d’une aura ensoleillée. Je pourrais
être cette femme, cernée par un chagrin que le lieu public et la proximité avec des étrangers
n’arrivent pas à contenir, et qui pleure parce que... elle a du perdre quelqu’un. J’imagine. Peut-être
se rend-elle à un enterrement. Je pourrais être cette femme, mais je ne préfère pas.
Il se trouve que je suis un homme qui aime les aéroports comme certains enfants raffolent des
confiseries: sans retenue, absolument, quitte à s’y casser les dents.
J’ai la chance de les fréquenter 2 à 3 fois par mois. Je me rends bien compte que c’est un luxe.
J’ai lu un truc, un article assez sérieux, qui expliquait que beaucoup de gens n’avaient jamais pris
l’avion. C’est à dire: jamais de leur vie. Des gens que j’ai peut-être croisés dans le métro, et tout.
L'intérêt de l’article consistait à s'intéresser à des témoins qui étaient déjà vieux. Parce que, moi
non plus, à 25 ans, je n’avais jamais pris l’avion. Or, ces gens, dans l’article respectable, là, ils
avaient un âge tout à fait idéal pour attraper le lecteur, faire en sorte qu’il se sente sinon concerné,
au moins compatissant. J’avais compati à fond les ballons. Je me souviens «Paul a vécu 67 ans
dans le Larzac et ne l’a jamais quitté». 67 ans quand même, c’est pas rien, je me dis.
Je me demande s’il y a un Paul, près de moi, qui part pour la première fois.
Les passagers à destination de leur destin sont priés de se présenter porte 5, merci.
L’appel de mon vol interrompt le cours de mes pensées, c’est aussi ce que j’aime dans les
aéroports, ça va, ça vient ; je me lève, je n’y pense plus, à Paul, aux autres, aux premières fois. Je
suis simplement un homme qui aime les aéroports, à chaque fois. Je lance le chariot à bagages,
en prenant soin d’appuyer mes avants bras sur la résistance, pour que ça ne freine pas. C’était
pas comme ça, les chariots, y’a encore une dizaine d’années. Je n’ai pas de réels bagages, je ne
pars que quelques jours, mais je maîtrise comme personne les virages de chariots à Orly.
L’attente n’est pas trop longue et les hôtesses sont... hospitalières même si leurs jupes sont un
peu longues à mon goût. J’ai envie de demander les menus mais, par timidité, je préfère attraper
des journaux que je ne lirai pas, en souriant nonchalamment. Ca fait plus sérieux, je crois, la
nonchalance.
-C’est ça, 30% alors?
-Oui oui, je vous dis, j’ai lu cet article moi aussi. 30% des Français.
-Mais... 30%... c’est précis...
-... Vous vous demandez si je bluffe.
-Non, pas du tout, je...
-Si, si, je le vois bien. Je comprends d’ailleurs. C’est suspect de tomber sur quelqu’un qui, hop,
précisément connaît les chiffres d’une enquête dont on lui parle, comme ça, en voisin d’avion.
-Suspect, je ne sais pas, mais... Bon, 30% quand même, ça me paraît assez énorme.
-Vous voulez savoir pourquoi je sais ça, et tout le reste de l’enquête d’ailleurs?
-Je veux tout savoir et ça en particulier.
-Parce que je n’avais moi-même jamais pris l’avion avant aujourd’hui.
Mon sang fait mille tours.
-Jamais, jamais?
-De toute ma vie. Et avant que vous n’ayez la courtoisie de ne pas me demander mon âge, je vous
le confie: 39 ans. En 39 ans, j’avais jamais pris l’avion, voilà.
-... Mais qu’est ce que vous avez fait, alors, pendant tout ce temps?
-Autant vous dire que l’enquête m’a parlé. J’ai même découpé l’article. Et, pour ne rien vous
cacher, je l’ai relu hier soir. J’aurais du le prendre, tiens, je vous les aurais montrés les 30%.
-Et, vous n’étiez jamais allé dans un aéroport?
-Ah si, si. Je viens souvent chercher maman. Elle me visite pendant les soldes. Elle est très...
-Intéressée par la mode?
-Radine.
L'hôtesse hospitalière nous sert nos plats. Pierre et moi, on échange un peu plus que des idées, il
me donne son beurre, je lui offre mon dessert, c’est une affaire qui roule.
-Et (là, je parle la bouche pleine, mais la curiosité me dépasse), ça vous fait quoi, alors, de prendre
l’avion pour la première fois?
Il me regarde en mastiquant. Le pain est un chouia caoutchouteux, ça doit être pour ça.
-Vous êtes bien curieux. Ca vous fascine, mon dépucelage aérien?
-Je crois que, oui, ça me fascine, oui. Vous savez, moi je suis accro à ça, les avions, les voyages,
les aéroports et tout, alors... vous êtes une sorte d’ovni pour moi.
-Ah vous travaillez dans le voyage alors?
-Non, pas du tout, je travaille dans le textile. J’achète des tissus, pour faire court. Par internet,
depuis mon bureau, à Paris. Et puis, je pars vérifier le matériel, enfin, vous voyez.
-Et, ce qui vous fascine, c’est les voyages?
-Oui. Et les aéroports, les départs, les avions. Tout ça.
-C’est étonnant de travailler dans un bureau quand on est attiré par l’instant et le mouvement,
non?
Nous traversons actuellement une légère zone de turbulences, veillez à ne pas perdre la
tête, merci.
Mon sang s’arrête. Il me gifle en freinant. J’ai dans les bras un fourmillement désagréable et
anesthésiant, au point que j’hésite à sonner l'hôtesse. J’adore sonner l'hôtesse mais j’ai passé
l’âge, alors, comme un grand, je m’interdis tout le temps de le faire.
-Vous vous sentez bien?
En fait, oui, je me sens parfaitement nickel, je crois même que je frôle la béatitude: il aura fallu que
Pierre, un parfait inconnu, pousse des portes que j’avais déjà entrouvertes, dans ma petite tête,
pour que l’évidence s’impose d’elle même. Je finis ma mignonnette d’un seul trait.
Je ne dors pas, j’attends. J’ai déjà relevé ma tablette, et ma ceinture frétille à l’idée d’être
raccrochée. L’arrivée pointe son nez, et, avec elle, mon irrévocable départ. Aujourd’hui, j’accorde
une attention toute particulière à l’annonce du capitaine concernant l’heure, la température et tout
le toutim. Pour être honnête, j’avais presque oublié ma destination, et je découvre avec joie que la
météo de juin à Tel-Aviv n’est pas très différente de celle de Paris. Mes 2 costumes feront l’affaire
le temps que je m'acclimate. J’ouvre ma sacoche dans laquelle je pensais n’avoir pris que
l’essentiel: les coordonnées du vendeur de soie, mon téléphone, mon ordinateur et mon billet de
retour. Elles apparaissent alors comme les choses les plus superflues que j’ai été amené à voir de
toute ma mini vie. Je ne suis pas pressé de sortir, je laisse les impatients se ruer dans les allées
embouteillées et je me lève après tout le monde. Ca me laisse le loisir d’observer, encore, ces
gens en transit, remplis d’émotions et d’attentes. C’est la toute première fois que je sors en
dernier, ça me permet de relever la fatigue sur les sourires des hôtesses; sourires que j'interprète
néanmoins comme des encouragements.
-Nous espérons que vous avez fait un bon voyage en notre compagnie.
-«Le meilleur» me dis-je, en serrant fort contre moi la sacoche qui contient tout ce dont je veux
maintenant me séparer.
Le hall fourmille. Je jette un dernier regard à mon ordinateur, à mon téléphone et: poubelle. Je
déchire le billet de retour en plein de tous petits morceaux. Paris s’effrite. Je n’ai pas la moindre
idée de l’endroit où je vais aller; et je sais que Louise serait dubitative quant à la manière dont je
décide tout à coup de recommencer ma vie. Mais, après tout, qu’est ce que ça peut me faire? Je
n’ai plus de femme, je n’ai plus rien, je suis comme neuf avec 2 costumes et 2 jours pour
construire une existence qui m’attend depuis mon premier hall d’aéroport. J’espère que quelqu’un
pensera à arroser le ficus du bureau.
-maispastrop-
Illustrations © Marc Zory-Casali
Ode à l'inconnue, comme dit l'autre.
Prendre une retraite sentimentale à mon âge, pour certains, ça n’a pas de sens; pour d’autres, ça représente quelque chose d’assez magique.
Ca n’a pas de sens pour ceux qui ne s’adonneraient jamais à ce type d’occupation. C’est magique pour ceux qui se l’offrent. On se comprend entre ceux qui doivent se comprendre, donc. Tout va pour le mieux dans tous les mondes y compris le meilleur, s’il existe.
Je pars, seule, loin.
Tout ce qui n’est pas à côté, à 2 pâtés de maison des copains, c’est loin. Sans parler du XIII° arrondissement, qui est carrément sur un autre continent. Alors quand on est à 2 heures de train du Carillon, c’est le bout de monde, quasi, là où on est.
Avoir envie, tout à coup, de retrouver quelqu’un à 3h et quelques 45 minutes de la nuit s’avère, sinon impossible, trop long et compliqué et cher et fatiguant et tout à accomplir pour se résoudre à l’accomplir. Et, ce qui tombe plutôt pas mal, c’est que, quand on prend une retraite sentimentale, on n’a envie de rejoindre personne à je sais pas quelle heure, du jour, de la nuit. Jamais. Personne. Ce serait pas honnête, on serait pas nous-même vu qu’on est déjà à moitié dans notre tête, à moitié ailleurs, dans un lieu non défini, difficilement définissable; ça servirait à rien du tout, un rendez-vous de ce genre pendant une retraite sentimentale. Ca équivaudrait à retrouver des amis en ne leur adressant pas un mot de la soirée. Et ce serait de la triche pour ladite retraite, également. Venir la bousculer en lui imposant quelqu’un d’étranger, comme ça, quelqu’un à qui il faut dire des trucs en faisant des phrases, et si ça se trouve des sourires. Commenter la brise marine, c’est déjà la ressentir un peu moins. Je n’échange pas d’opinions, je n’écoute pas d’avis, je vis, tout court, pour rien. Je dérive sans entraîner quiconque, ce serait pas sympa. Certains chaos organisés ne peuvent accueillir personne dans leur placard, et on n’écrit pas un journal intime pour le faire lire.
Non, vraiment, la retraite sentimentale n’est pas portée sur ce genre d’activité.
Je dis «retraite sentimentale», c’est parce que j’ai pas d’autres termes sous la main. Y’a pas vraiment de sentiments dont j’ai envie de me retirer, mais une ambiance générale que j’ai envie de voir de loin, puis d’oublier, puis de reprendre, peut-être, en rentrant. Une sorte de bilan annuel. Sans en être vraiment un, sans être tout à fait annuel non plus, puisque toute la ressource de ce que nous appellerons dorénavant ce «retrait» consiste à ne pas penser à ce dont on se retire, précisément. Et à le renouveler autant que nécessaire, tant pis si c’est 2 fois de suite.
L'intérêt, alors, me demanderez-vous, ousqu’il est?
Ben, l'intérêt c’est qu’on sait pas vraiment ousqu’il est, l'intérêt. On le trouve à tâtons, comme ça, sans réellement s’en rendre compte. Si ça se trouve, on le trouve pas.
Honnêtement, c’est pas très important.
Je suis seule, loin.
Certains amis partent en groupes d’amis, d’autres travaillent et se regroupent, quand même, le soir, pour fabriquer de l’ambiance estivale autour d’un pastis, en terrasse. Et moi, grand luxe, je suis seule, loin. Pas isolée au point que mon téléphone ne capte pas si on m’appelle, mais retirée au point qu’on n’ose pas m’appeler. D’ailleurs mon téléphone, je le coupe. Il me dit «le monde est à vous» quand je l’éteins, même que; ce qui, si on y pense une seconde, est plutôt ironique dans la mesure où, précisément, du monde, je veux m’en éloigner quand je ne veux pas qu’on puisse me joindre. Le monde est aux autres, en réalité.
Depuis que j’ai cette manie, j’ai regardé, observé, zyeuté, pris des notes même, j’ai vu personne faire ça. Et cette fois encore, comme depuis 10 ans, pas une seule fille de mon âge seule de son plein gré à retirer ses sentiments d’on ne sait trop où pour en faire on sait pas quoi. Personne. Queudale. Non pas que j’en tire de la fierté, si je me penchais sur le sujet, peut-être même y trouverais-je matière à m’inquiéter. N’empêche, j’ai vu personne faire ça, je le dis, c'est tout.
Et puis, il y a eu une fille, que je croisais, qu’était tout le temps toute seule, et qui a retenu mon attention. Pourtant, c’est pas le genre de fille qui retient l’attention, autant le dire tout de suite. Pas l’attention de ceux portés sur l'esthétisme ou sur le mélange de quelconques muqueuses, disons. Vraiment, y’avait rien chez elle qui attisait ces deux penchants.
Plus jeune, plus bête, j’aurais trouvé là la raison de sa solitude; et puis, avec le temps et l’intelligence, et bien sûr le génie qui me caractérise, j’ai appris que tout le monde avait des amis, même les filles pas attirantes et négligées comme elle. Elle a forcément une amie aussi moche et mal fagotée, peut-être même plus moche encore, si elle l’a bien choisie. C’est comme ça, c’est la règle du jeu.
Et pourtant non, toujours je la voyais seule et l’air de pas trop s’en plaindre, ce qui me foutait un sacré coup: y’aurait quelqu’un d’autre comme moi? et c’est à ça que ça ressemble?
Je voulais être foudroyée sur place.
Ou: faire une enquête sur place.
Entre l’un et l’autre, allez savoir pourquoi, j’ai vite fait mon choix.
C’était simple comme bonjour. Elle allait tous les jours au même endroit pour boire son thé, comme une vieille anglaise jamais mariée, peut-être pucelle, encore. Une mademoiselle qui trouverait en avance dans l’occupation des vieux tout ce que sa jeunesse attendait, sans honte. Et, puisqu’on s’était croisées pas mal de fois et que j’avais remarqué chez elle l’envie de faire connaissance, manifestée par son avancée du menton à mon égard et une petite gêne adolescente en me saluant, j’étais sûre à fond qu’en m’installant à la table voisine, elle m’adresserait la parole. J’aurais parié ma mère, sur ce coup. Ou ma bière, disons.
L’endroit était vraiment pas à mon goût, une connerie pseudo-rustique même pas authentique, un attrape couillon ou un q.g. d’habitués de 50 ans et plus. J’aurais préféré le PMU du coin, ou le bar du Normandy, m’enfin bon, c’était là qu’elle était, c’est donc là que je m’installais l’air de rien mine de crayon.
Lalalilala, je pose mon sac et commande un café, youplaboum, je sors mon livre, ahlala, y’a du soleil, tiens tiens tiens, c’est où donc que j’ai mis mes lunettes déjà et.
-Bonjour.
Simple comme ça, j’vous avais dit.
-Bonjour.
Avec l’air un peu étonné, faut bien.
-Vous...
V’là qu’elle cherche ses mots. Y’a pas grand chose qui m‘horripile davantage que quelqu’un qui engage la conversation et qui n’a rien à dire au bout de la deuxième réplique.
-Fait chaud hein.
Bon, j’aide comme je peux. Et puis d’ailleurs, je n’aide pas, j’enquête, c’est différent.
-Ouhla oui.
-Mmmmh.
-Vous...
V’là que ça le reprend. Elle a qu’à pas dire «vous» si ça la bloque.
-Vous pouvez me tutoyer. On s’est croisées plusieurs fois, on doit avoir la même décennie, donc, moi, ça me dérange pas.
Mon dieu, je ne me savais pas capable de m’abaisser à ce point pour une investigation.
-Ah! Tant mieux, ça me gêne un peu le vouvoiement, moi.
-Oui, j’ai cru comprendre.
-Pardon?
-Non mais, à chaque fois que vous m’avez vouvoyée, ben, vous n’avez pas fini votre phrase.
-Ah, non, ça c’est parce que je suis très timide.
-Ok. ... Ok. Et moi mal à l’aise donc. Pardon. Excusez-moi, je voulais pas... Je pensais que...
-Non mais y’a pas de problème, je voulais te parler parce que je t’avais vue ces derniers jours, pas mal de fois, je me disais: on a le même âge, c’est bête, «va lui parler» tout ça, et puis j’osais pas parce que je me disais que peut-être t’avais envie d’être seule, enfin, qu’on te parle pas, t’avais pas vraiment l’air d’avoir envie qu’on te parle, donc bon, mais là, t’es là, et on se parle donc c’est chouette, ça tombe bien quoi. Tu fais quoi dans la vie?
Ok, heu, et ça, c’est être timide?
-Heu, je.
Mon café arrive. Je devrais tenir un carnet où je noterais toutes les fois où un café m’a sauvée d’une phrase que j’avais pas envie de terminer, qu’on m’a forcée à commencer. J’opterais pour la 17298° fois, aujourd’hui. Ou quelque chose dans ce goût là.
-Je trouve pas mes foutues lunettes!
Là c’est une façon de changer de sujet tout en subtilité, vous avez vu ça.
-Oh, je te prête les miennes si tu veux!
Alors on est déjà meilleures amies, la «timide» et moi? Ok, stop, on arrête, l’investigation est bouclée, remballez le matos, on se replie. Dispersez-vous.
-Non merci, je, j’avais pas vu l’heure, j’aurais même pas du me permettre un café, je dois y aller.
Partir dans l’urgence nécessite d’être ok pour laisser 3€ sur la table sans attendre la monnaie alors que ce jus ne valait même pas les 2€10 facturés.
-Mais, tu vas où? Tu fais quelque chose ce soir?
-Je rentre à Paris. A la prochaine !
La fille seule comme moi n’était pas seule comme moi. La fille seule était seule, foutrement, et se cherchait une amie. Elle avait cru la voir en la personne de moi-même qui, précisément fuyait toute compagnie humaine. C’est mal foutu quand même la vie, parfois. Enfin, pour elle, surtout.
Je suis pas méchante, entendons nous bien.
La façon dont je parle de l’esseulée moche et mal habillée n’est pas vraiment révélatrice de l’amour que je peux porter à l’être humain; c’est simplement que, de manière générale, je trouve très maladroit de forcer la main à quelqu’un pour s’en faire un ami. Elle m’avait mise mal à l’aise. J’avais rien de rien à lui dire.
Sur le chemin, j’ai regretté l’excuse que je lui avais servie. Parce que, non, je ne rentrais pas à Paris et qu’il allait s’avérer périlleux de circuler librement dans ce bled sans tomber nez à nez avec son petit air de «ben j’croyais que t’étais partie / ah t’es là, chouette / on va boire un café?.»
Elle avait dit «chouette» une fois, elle était cap’ de remettre ça. Qu’est ce que j’allais bien pouvoir faire alors?
Lui dire la vérité?
Personne n’aime la vérité.
Surtout quand elle ne leur va pas au teint.
Je mentirai donc. Je dirai que, je devais partir en effet, et puis je suis revenue. Et avant même qu’elle me pose des questions, là, je dirai un bout de vérité. Tant pis. Que je suis là pour être tranquille. Que j’espère qu’elle passe un bon moment. Qu’elle me laissera passer un bon moment tranquille. J’espère qu’elle comprendra. J’ai même croisé les doigts, hier soir, dans mon lit, pour qu’elle me comprenne si, par malheur, je devais me retrouver dans la situation de confrontation. Il faudra un jour que j’arrête de croiser les doigts pour rien et de faire des voeux à 22h22, c’est plus de mon âge.
Mais elle était là, ce matin, à la terrasse, avec son thé de miss Marple. Et elle m’a interpellée. Et j’ai été incapable de produire ne serait-ce qu’un son avec ma bouche. Alors je me suis assise à côté d’elle, et j’ai écouté tout ce que nous allions faire ensemble, elle et moi, et à quel point c’était CHOUETTE qu’on se soit trouvées. Elle avait plein de boutiques à me faire découvrir, et elle ne me laissait pas le temps de lui dire que le shopping, c’était pas ma came, et que si je devais en faire, ce ne serait pas avec une fille habillée comme ma prof de piano de 75 ans. Autant recevoir des conseils de beauté d'une fille qui a les sourcils très épilés en forme de V. Elle voulait me présenter son cousin, assistant du maire ump, et je ne pouvais même pas caser que l’ump me donnait des crises de fous rires qu’elle prenait déjà rendez-vous. Elle touchait mes cheveux pour savoir comment avoir les mêmes boucles et là, j’attrapais son bras et la stoppais net.
-Pardon, mais non.
-Pardon?
-Non.
-Non quoi?
-Tu ne touches pas mes cheveux.
-...Ah. Pardon.
-Ouais.
-Non mais je voulais juste savoir... comment ils étaient, doux, ou pas, j’avais envie de...
-Et si moi j’ai envie de savoir si t’as ne serait-ce qu’une once de bienséance, dans ton cerveau, je vais aller t’ouvrir le crâne pour y fouiller?
-...
-Non. Je ne le ferai pas. Donc ne touche pas mes cheveux.
La serveuse avait décidé, dieu sait pourquoi, de nous offrir une nouvelle tournée. J’imagine qu’elle avait enfin réussi à faire l’amour depuis 1 ou 10 mois qu’elle essayait et que le bonheur continuait de circuler dans certains endroits de son corps. La Normandie, c’est pas le Lido, hein.
-A la tienne.
Dieu que c’était désarmant: être gentille, encore, alors que je lui avais présenté mon mr Hyde.
-A la mienne, oui.
Et puis elle savait même pas trinquer.
Finalement, je lui demandais son prénom. Lucille, comme la chanson.
-Quelle chanson?
Mon coeur tombait définitivement dans mes chaussettes.
Moi qui m’étais débrouillée pour n’entretenir aucune sorte d’intimité avec des gens que je vois depuis 15 ans, ici, il a fallu que je me fasse avoir, comme ça, sur un coup de grosse tête.
Ca m’apprendra.
-maispastrop-
Ca n’a pas de sens pour ceux qui ne s’adonneraient jamais à ce type d’occupation. C’est magique pour ceux qui se l’offrent. On se comprend entre ceux qui doivent se comprendre, donc. Tout va pour le mieux dans tous les mondes y compris le meilleur, s’il existe.
Je pars, seule, loin.
Tout ce qui n’est pas à côté, à 2 pâtés de maison des copains, c’est loin. Sans parler du XIII° arrondissement, qui est carrément sur un autre continent. Alors quand on est à 2 heures de train du Carillon, c’est le bout de monde, quasi, là où on est.
Avoir envie, tout à coup, de retrouver quelqu’un à 3h et quelques 45 minutes de la nuit s’avère, sinon impossible, trop long et compliqué et cher et fatiguant et tout à accomplir pour se résoudre à l’accomplir. Et, ce qui tombe plutôt pas mal, c’est que, quand on prend une retraite sentimentale, on n’a envie de rejoindre personne à je sais pas quelle heure, du jour, de la nuit. Jamais. Personne. Ce serait pas honnête, on serait pas nous-même vu qu’on est déjà à moitié dans notre tête, à moitié ailleurs, dans un lieu non défini, difficilement définissable; ça servirait à rien du tout, un rendez-vous de ce genre pendant une retraite sentimentale. Ca équivaudrait à retrouver des amis en ne leur adressant pas un mot de la soirée. Et ce serait de la triche pour ladite retraite, également. Venir la bousculer en lui imposant quelqu’un d’étranger, comme ça, quelqu’un à qui il faut dire des trucs en faisant des phrases, et si ça se trouve des sourires. Commenter la brise marine, c’est déjà la ressentir un peu moins. Je n’échange pas d’opinions, je n’écoute pas d’avis, je vis, tout court, pour rien. Je dérive sans entraîner quiconque, ce serait pas sympa. Certains chaos organisés ne peuvent accueillir personne dans leur placard, et on n’écrit pas un journal intime pour le faire lire.
Non, vraiment, la retraite sentimentale n’est pas portée sur ce genre d’activité.
Je dis «retraite sentimentale», c’est parce que j’ai pas d’autres termes sous la main. Y’a pas vraiment de sentiments dont j’ai envie de me retirer, mais une ambiance générale que j’ai envie de voir de loin, puis d’oublier, puis de reprendre, peut-être, en rentrant. Une sorte de bilan annuel. Sans en être vraiment un, sans être tout à fait annuel non plus, puisque toute la ressource de ce que nous appellerons dorénavant ce «retrait» consiste à ne pas penser à ce dont on se retire, précisément. Et à le renouveler autant que nécessaire, tant pis si c’est 2 fois de suite.
L'intérêt, alors, me demanderez-vous, ousqu’il est?
Ben, l'intérêt c’est qu’on sait pas vraiment ousqu’il est, l'intérêt. On le trouve à tâtons, comme ça, sans réellement s’en rendre compte. Si ça se trouve, on le trouve pas.
Honnêtement, c’est pas très important.
Je suis seule, loin.
Certains amis partent en groupes d’amis, d’autres travaillent et se regroupent, quand même, le soir, pour fabriquer de l’ambiance estivale autour d’un pastis, en terrasse. Et moi, grand luxe, je suis seule, loin. Pas isolée au point que mon téléphone ne capte pas si on m’appelle, mais retirée au point qu’on n’ose pas m’appeler. D’ailleurs mon téléphone, je le coupe. Il me dit «le monde est à vous» quand je l’éteins, même que; ce qui, si on y pense une seconde, est plutôt ironique dans la mesure où, précisément, du monde, je veux m’en éloigner quand je ne veux pas qu’on puisse me joindre. Le monde est aux autres, en réalité.
Depuis que j’ai cette manie, j’ai regardé, observé, zyeuté, pris des notes même, j’ai vu personne faire ça. Et cette fois encore, comme depuis 10 ans, pas une seule fille de mon âge seule de son plein gré à retirer ses sentiments d’on ne sait trop où pour en faire on sait pas quoi. Personne. Queudale. Non pas que j’en tire de la fierté, si je me penchais sur le sujet, peut-être même y trouverais-je matière à m’inquiéter. N’empêche, j’ai vu personne faire ça, je le dis, c'est tout.
Et puis, il y a eu une fille, que je croisais, qu’était tout le temps toute seule, et qui a retenu mon attention. Pourtant, c’est pas le genre de fille qui retient l’attention, autant le dire tout de suite. Pas l’attention de ceux portés sur l'esthétisme ou sur le mélange de quelconques muqueuses, disons. Vraiment, y’avait rien chez elle qui attisait ces deux penchants.
Plus jeune, plus bête, j’aurais trouvé là la raison de sa solitude; et puis, avec le temps et l’intelligence, et bien sûr le génie qui me caractérise, j’ai appris que tout le monde avait des amis, même les filles pas attirantes et négligées comme elle. Elle a forcément une amie aussi moche et mal fagotée, peut-être même plus moche encore, si elle l’a bien choisie. C’est comme ça, c’est la règle du jeu.
Et pourtant non, toujours je la voyais seule et l’air de pas trop s’en plaindre, ce qui me foutait un sacré coup: y’aurait quelqu’un d’autre comme moi? et c’est à ça que ça ressemble?
Je voulais être foudroyée sur place.
Ou: faire une enquête sur place.
Entre l’un et l’autre, allez savoir pourquoi, j’ai vite fait mon choix.
C’était simple comme bonjour. Elle allait tous les jours au même endroit pour boire son thé, comme une vieille anglaise jamais mariée, peut-être pucelle, encore. Une mademoiselle qui trouverait en avance dans l’occupation des vieux tout ce que sa jeunesse attendait, sans honte. Et, puisqu’on s’était croisées pas mal de fois et que j’avais remarqué chez elle l’envie de faire connaissance, manifestée par son avancée du menton à mon égard et une petite gêne adolescente en me saluant, j’étais sûre à fond qu’en m’installant à la table voisine, elle m’adresserait la parole. J’aurais parié ma mère, sur ce coup. Ou ma bière, disons.
L’endroit était vraiment pas à mon goût, une connerie pseudo-rustique même pas authentique, un attrape couillon ou un q.g. d’habitués de 50 ans et plus. J’aurais préféré le PMU du coin, ou le bar du Normandy, m’enfin bon, c’était là qu’elle était, c’est donc là que je m’installais l’air de rien mine de crayon.
Lalalilala, je pose mon sac et commande un café, youplaboum, je sors mon livre, ahlala, y’a du soleil, tiens tiens tiens, c’est où donc que j’ai mis mes lunettes déjà et.
-Bonjour.
Simple comme ça, j’vous avais dit.
-Bonjour.
Avec l’air un peu étonné, faut bien.
-Vous...
V’là qu’elle cherche ses mots. Y’a pas grand chose qui m‘horripile davantage que quelqu’un qui engage la conversation et qui n’a rien à dire au bout de la deuxième réplique.
-Fait chaud hein.
Bon, j’aide comme je peux. Et puis d’ailleurs, je n’aide pas, j’enquête, c’est différent.
-Ouhla oui.
-Mmmmh.
-Vous...
V’là que ça le reprend. Elle a qu’à pas dire «vous» si ça la bloque.
-Vous pouvez me tutoyer. On s’est croisées plusieurs fois, on doit avoir la même décennie, donc, moi, ça me dérange pas.
Mon dieu, je ne me savais pas capable de m’abaisser à ce point pour une investigation.
-Ah! Tant mieux, ça me gêne un peu le vouvoiement, moi.
-Oui, j’ai cru comprendre.
-Pardon?
-Non mais, à chaque fois que vous m’avez vouvoyée, ben, vous n’avez pas fini votre phrase.
-Ah, non, ça c’est parce que je suis très timide.
-Ok. ... Ok. Et moi mal à l’aise donc. Pardon. Excusez-moi, je voulais pas... Je pensais que...
-Non mais y’a pas de problème, je voulais te parler parce que je t’avais vue ces derniers jours, pas mal de fois, je me disais: on a le même âge, c’est bête, «va lui parler» tout ça, et puis j’osais pas parce que je me disais que peut-être t’avais envie d’être seule, enfin, qu’on te parle pas, t’avais pas vraiment l’air d’avoir envie qu’on te parle, donc bon, mais là, t’es là, et on se parle donc c’est chouette, ça tombe bien quoi. Tu fais quoi dans la vie?
Ok, heu, et ça, c’est être timide?
-Heu, je.
Mon café arrive. Je devrais tenir un carnet où je noterais toutes les fois où un café m’a sauvée d’une phrase que j’avais pas envie de terminer, qu’on m’a forcée à commencer. J’opterais pour la 17298° fois, aujourd’hui. Ou quelque chose dans ce goût là.
-Je trouve pas mes foutues lunettes!
Là c’est une façon de changer de sujet tout en subtilité, vous avez vu ça.
-Oh, je te prête les miennes si tu veux!
Alors on est déjà meilleures amies, la «timide» et moi? Ok, stop, on arrête, l’investigation est bouclée, remballez le matos, on se replie. Dispersez-vous.
-Non merci, je, j’avais pas vu l’heure, j’aurais même pas du me permettre un café, je dois y aller.
Partir dans l’urgence nécessite d’être ok pour laisser 3€ sur la table sans attendre la monnaie alors que ce jus ne valait même pas les 2€10 facturés.
-Mais, tu vas où? Tu fais quelque chose ce soir?
-Je rentre à Paris. A la prochaine !
La fille seule comme moi n’était pas seule comme moi. La fille seule était seule, foutrement, et se cherchait une amie. Elle avait cru la voir en la personne de moi-même qui, précisément fuyait toute compagnie humaine. C’est mal foutu quand même la vie, parfois. Enfin, pour elle, surtout.
Je suis pas méchante, entendons nous bien.
La façon dont je parle de l’esseulée moche et mal habillée n’est pas vraiment révélatrice de l’amour que je peux porter à l’être humain; c’est simplement que, de manière générale, je trouve très maladroit de forcer la main à quelqu’un pour s’en faire un ami. Elle m’avait mise mal à l’aise. J’avais rien de rien à lui dire.
Sur le chemin, j’ai regretté l’excuse que je lui avais servie. Parce que, non, je ne rentrais pas à Paris et qu’il allait s’avérer périlleux de circuler librement dans ce bled sans tomber nez à nez avec son petit air de «ben j’croyais que t’étais partie / ah t’es là, chouette / on va boire un café?.»
Elle avait dit «chouette» une fois, elle était cap’ de remettre ça. Qu’est ce que j’allais bien pouvoir faire alors?
Lui dire la vérité?
Personne n’aime la vérité.
Surtout quand elle ne leur va pas au teint.
Je mentirai donc. Je dirai que, je devais partir en effet, et puis je suis revenue. Et avant même qu’elle me pose des questions, là, je dirai un bout de vérité. Tant pis. Que je suis là pour être tranquille. Que j’espère qu’elle passe un bon moment. Qu’elle me laissera passer un bon moment tranquille. J’espère qu’elle comprendra. J’ai même croisé les doigts, hier soir, dans mon lit, pour qu’elle me comprenne si, par malheur, je devais me retrouver dans la situation de confrontation. Il faudra un jour que j’arrête de croiser les doigts pour rien et de faire des voeux à 22h22, c’est plus de mon âge.
Mais elle était là, ce matin, à la terrasse, avec son thé de miss Marple. Et elle m’a interpellée. Et j’ai été incapable de produire ne serait-ce qu’un son avec ma bouche. Alors je me suis assise à côté d’elle, et j’ai écouté tout ce que nous allions faire ensemble, elle et moi, et à quel point c’était CHOUETTE qu’on se soit trouvées. Elle avait plein de boutiques à me faire découvrir, et elle ne me laissait pas le temps de lui dire que le shopping, c’était pas ma came, et que si je devais en faire, ce ne serait pas avec une fille habillée comme ma prof de piano de 75 ans. Autant recevoir des conseils de beauté d'une fille qui a les sourcils très épilés en forme de V. Elle voulait me présenter son cousin, assistant du maire ump, et je ne pouvais même pas caser que l’ump me donnait des crises de fous rires qu’elle prenait déjà rendez-vous. Elle touchait mes cheveux pour savoir comment avoir les mêmes boucles et là, j’attrapais son bras et la stoppais net.
-Pardon, mais non.
-Pardon?
-Non.
-Non quoi?
-Tu ne touches pas mes cheveux.
-...Ah. Pardon.
-Ouais.
-Non mais je voulais juste savoir... comment ils étaient, doux, ou pas, j’avais envie de...
-Et si moi j’ai envie de savoir si t’as ne serait-ce qu’une once de bienséance, dans ton cerveau, je vais aller t’ouvrir le crâne pour y fouiller?
-...
-Non. Je ne le ferai pas. Donc ne touche pas mes cheveux.
La serveuse avait décidé, dieu sait pourquoi, de nous offrir une nouvelle tournée. J’imagine qu’elle avait enfin réussi à faire l’amour depuis 1 ou 10 mois qu’elle essayait et que le bonheur continuait de circuler dans certains endroits de son corps. La Normandie, c’est pas le Lido, hein.
-A la tienne.
Dieu que c’était désarmant: être gentille, encore, alors que je lui avais présenté mon mr Hyde.
-A la mienne, oui.
Et puis elle savait même pas trinquer.
Finalement, je lui demandais son prénom. Lucille, comme la chanson.
-Quelle chanson?
Mon coeur tombait définitivement dans mes chaussettes.
Moi qui m’étais débrouillée pour n’entretenir aucune sorte d’intimité avec des gens que je vois depuis 15 ans, ici, il a fallu que je me fasse avoir, comme ça, sur un coup de grosse tête.
Ca m’apprendra.
-maispastrop-
Ground control to Major Tom
On devrait tous passer notre vie en transit.
Je crois au pouvoir magique des trains, des avions et des bus. Je ne parle même pas des gros et grands bateaux qui font des randonnées de plusieurs jours.
J'émets cependant une certaine réserve concernant les taxis, comme tout bon parisien, et ce n’est pas à vous que j’expliquerai pourquoi. -Si vous ne voyez pas ce à quoi je fais référence, estimez-vous chanceux, tout simplement.-
Mais, les transports, les vrais, ceux dont on ne voit pas le conducteur, ceux où les passagers inconnus nous côtoient, nous frôlent, parfois; ceux où le paysage défile tantôt minuscule et lointain, tantôt grandeur nature, juste là, et campagnard peut-être, .... ceux-là abritent mes espoirs de bonheur pour l’humanité. L’humanité entière. Rien que ça. Oui, oui. J’y crois dur comme fer.
D’ailleurs, et pour y avoir réfléchi un chouia, il n’y a rien d’autre que j’estime plus à même de rendre l’homme heureux que le voyage. Non pas la destination, mais le trajet d’un point à un autre, et la magie avec laquelle cet espace-temps de tous les possibles s’empare de notre cortex et notre matière grise -ou ce qu’il en reste- pour nous ramener à ce qui nous anime et qui, étrangement, n’a pas sa place dans nos pensées et rêveries quotidiennes.
Peut-être parce que, au jour le jour, la rêverie et la pensée n’ont pas réellement leur place. Tout simplement, peut-être. Peut-être.
Souvent, la perspective de m’installer dans un TGV vers des vacances en Provence pour un mois m'enthousiasme bien plus que celle de me rendre en Provence pour le mois. Je n’ai pas honte de le dire. Ca ne signifie aucunement que le mois provençal à venir ne me fait pas envie, ça souligne simplement l’impatience de ressentir la rareté des émotions qui me remplissent lorsque je m’installe à une place précise dans une ville et qu’à la même place, quelques heures plus tard, je suis ailleurs. Dans une autre ville. Ailleurs où on ne parle parfois pas la même langue, ou bien, pas avec le même accent, et où je suis moi-même encore en train de traduire ce que je ressens alors qu’il faut déjà, paraît-il, prendre garde de n’avoir rien oublié et faire attention à la distance entre la marche et le quai.
J’oublierai tout, pourtant. Et la distance entre la marche et le quai n'arrête jamais, jamais, jamais de grandir. Elle est absolument affamée d’être plus grande qu’immense, cette distance. C’en est éreintant. Et fascinant à la fois.
Et toutes ces choses auxquelles j’aurais pensé pendant le trajet resteront comme suspendues, pour toujours, parce qu’elles ne sont pas productives, ou concrètes, mais enfouies quelque part et toujours furibondes. Pas du genre à se laisser attraper ou à se fixer quelque part.
Ce serait, si je voulais les imager, comme des animaux dans moi qui ne sortent le museau que lorsque leur niche avance à + de 50 km/h. Ca veut dire que je suis leur niche, pour ceux qui ne suivent qu’à moitié. Les ours hibernent l’hiver, et bien, eux, mes animaux furibonds, ils fleurissent en période de mouvement.
J’aimerais que mon bureau soit une cabine SNCF.
J’aimerais vraiment ça.
N’en déplaise à la table parisienne sur laquelle je couche beaucoup de paperasses et d’idées, aussi, quelquefois.
J’aimerais que ma jolie table parisienne, une fois que je m’y installe, se télétransporte dans un train qui n’aurait pas de destination sinon celle qui saurait que, quand je n’aurai plus rien à dire, ce sera ok, on pourra rentrer à la maison.
Et, il se trouve qu’on n’a jamais plus rien à dire.
Ou alors on est mort.
Ce train là est passé par mal de péripéties. Le genre d’emmerdements qui saupoudre encore un peu plus de miettes de honte sur les agents SNCF. Et sur les fonctionnaires en général, j’imagine.
D’abord, et bien, ce sera en retard que vous prendrez votre train.
Et, d’ailleurs, on ne sait pas de combien de minutes sera le retard.
Mais régulièrement, ça, très régulièrement, quelque chose comme toutes les 5 minutes, on vous assurera que le retard est effectif et que notre incompétence est pire.
Et puis, on vous fera monter dans le train, oui, mais on aura un problème de signalisation; un problème qui fait que, à un des stop, on marquera finalement une sorte d’arrêt. Un arrêt dont on ne peut pas dire s’il est définitif ou non.
Quand le train finira par repartir, on vous annoncera qu’à cause des problèmes sus-cités, on roulera à vitesse réduite. Mais on ne sait pas pour combien de temps. Ni vraiment à quelle vitesse, d’ailleurs.
On vous annonce le retard qu’on a déjà mais on ne peut pas s’exprimer sur celui qu’on aura au final, en gare, au terminus, là où tout le monde semble impatient d’arriver.
Alors les langues se délient.
Et ce n’est pas tout à fait ce que j’aime, dans le concept du voyage, l’imprévu qui fait que n’importe qui trouve normal de faire part de ses états d’âme n’importe comment. L’idée initiale était de laisser mes états d’âme tranquilles et libres de s’amuser, au fait, j’aurais du le leur dire. Et zut. Note pour plus tard: le leur dire. Le leur dire avant, au départ.
Je vois qu’ils n’aiment pas ça, la perspective de passer une heure de plus ici, alors j’en conclue avec ce que j’ai de sens de la déduction qu’ils envisagent ce train comme un simple train.
Ca me fait de la peine pour le train en question, le train qui abrite mes animaux furibonds et rares. J’ai envie de m’excuser auprès de ce train. Et auprès de mes animaux furibonds.
Il faut que j’arrête de croire tout le temps que tout a une âme. Non mais sérieusement, quand vous vous retrouverez dans la situation où, honteuse, vous réfléchissez à la meilleure façon de vous excuser de vos brusques et rustres congénères auprès d’une machine, vous comprendrez mon malheur, vous direz vous aussi qu’il faut que j’arrête de croire tout le temps que tout a une âme.
Je suis exaspérée par la vulgarité des passagers, la banalité avec laquelle ils accueillent la nouvelle, le costume évident du client en rogne qu’ils revêtent à la vitesse lumière, je me prends à réaliser qu’ils ne sont pas, eux, ici pour apprécier le trajet, mais pour aller d’un endroit à un autre. Point.
«On va toujours tous d’un endroit à un autre», j’me dis. «Qu’ils se calment un peu, là», je pense. Ca me rend folle qu’ils ne respectent pas davantage ce lieu précis où toutes les imaginations et tous les souvenirs peuvent grossir. Ca me rend folle.
Et puis, c’est pas comme si on était sur un Paris/New-York remplis de personnes, enfin, de têtes pensantes, qui devraient engranger du contrat. Non, aujourd'hui, nous sommes Septembre, comme dit l’autre, et je vous vois, vous êtes vieux, vous n‘avez pas rendez-vous, vous changez d’endroit parce que la retraite vous le permet, vous l’impose peut-être, parce que l’ennui vous y contraint. Alors, pourquoi vous impatienter d’arriver à un endroit où vous n’aurez pas plus de raison de vivre qu’à celui que vous venez de quitter.
Point d’interrogation.
Et puis personne ne vous attend. Personne ne vous attend nulle part.
«Occupez-vous donc d’être moins impatients», j’ai envie de leur crier.
Pendant le trajet, j’ai fait ma petite affaire de sentimentale nomade.
J’ai pensé à des choses auxquelles je ne pense jamais. J’ai été contente du retard, ce qui m’arrive rarement. J’ai apprécié l’odeur des fauteuils du train. J'ai compati avec ceux qui s'étaient retrouvés en salle de réunion pour décider du motif qui ornerait les sièges. J'ai aimé les motifs des sièges, et les sièges. J’ai même descendu la tablette pour y installer mon ordinateur et raconter tout ça.
Pendant que ça pestait partout, je n’avais qu’une envie, me rappeler à quel point je suis ok avec le mouvement, quitte à ce qu’il stagne. Alors il fallait que je l’écrive.
Et puis, non, au bout de quelques minutes, genre 14, 15, -ce qui est beaucoup, en termes de secondes, ou de retard par exemple- j’ai remonté la tablette et abandonné l’idée de raconter puisque le vrai événement c’est qu’il était beaucoup plus excitant de penser des trucs, des machins, des bribes d’idées et des avortons de concept, que de les immortaliser, noir sur blanc. Quitte à les oublier.
Il y a ceux qui ont un foyer qu’ils aiment et qu’ils veulent retrouver au plus vite. Il y a ceux qui supportent une vie de merde et qui sont heureux d’y échapper. Il y en a d’autres pour qui tout va bien, qui partent d’un foyer adorable pour retrouver une double vie adorée. Il y a la belle famille, contrainte de se rendre à la maison d’un père qui vient de mourir. Il y a l’antiquaire qui, sans parler de foyer ou de vie, ni de ce qu’il aime ou de ceux qui meurent, doit prendre le train, et prend le train, tous les jours que dieu fait, et puis.
C’est vrai que l’espace entre la marche et le quai est costaud, au moins autant que mes talons, il a fallu que je m'agrippe à la rambarde, enfin, ah non, à une épaule d’homme, manifestement, oups.
-Ah pardon. Je croyais attraper la rambarde.
-Je vous en prie.
Il dit ça sans vraiment me considérer. J’aime bien ça, qu’il m’aide, sans me considérer. C’est l’idée que je me fais de l’élégance.
-Merci.
-Je vous en prie.
Bon. Quelques minutes passent, ça arrive dans la vie.
«En raison d’un problème de signalisation, nous sommes dans l’obligation de stationner en gare.»
-Ca, ils nous l’ont déjà dit.
Il s’adresse à moi. Ou au vide, je ne sais pas.
-Oui, c’est vrai.
Je m’adresse et à lui et au vide, pour pas prendre de risques mais rester polie envers les deux.
J’ai pas envie de parler de ça. Et pourquoi pas la pluie et le beau temps, tant qu’on y est. S’il avait écouté ce que j’ai dit plus haut, il saurait que j’ai pas envie de parler du tout. Que sa politesse élégante est parfaite, qu’il faut s’en tenir là et arrêter de croire que, parce que nous sommes les passagers d’un même train, nous serions les esclaves des mêmes phobies. Et qu’en prime, nous aimerions tous les partager dans une partouze de plaintes et de revendications. Non. Non non et non.
-Moi j’ai un car à prendre. Et là, je sais pas si je l’aurai.
-Mmmmh.
Je peux pas m’empêcher de me demander si ce car ne serait pas l’équivalent de mon train. Peut-être que ce train n’était pour lui qu’un métro. Peut-être est-ce dans ce car qu’il compte rêvasser par la fenêtre, peut-être a-t-il un rendez-vous qu’il veut imaginer sur le décor, peut-être...
-A tous les coups, je l’aurai pas.
-Y’en a sûrement régulièrement.
J’y vais doucement.
-Au pire... toutes les heures, je rajoute.
Je prends mes précautions.
-Je sais pas, j’ai les horaires quelque part.
Il fouille dans sa poche, le con. Moi je veux qu’il me dise qu’il attend d’être sur un siège pas trop devant, pas trop derrière, ni non plus près des toilettes pour retrouver quelque chose de fou. Ou bien qu’il se taise à jamais.
-Regardez, y’en a un toutes les heures.
-Alors vous l’aurez.
-Comment?
-Bin... D’une façon ou d’une autre, vous l’aurez. A une heure, ou celle d’après. Mais vous l’aurez.
-Oui. Oui, bien sur. C’est vrai.
-Bon.
-Mais je ne sais pas lequel j’aurai.
Qu’il la crache sa valda bordel. Qu’est ce qu’il est si empressé de retrouver, je veux savoir.
«En raison d’un problème de signalisation, nous sommes dans l’obligation de stationner en gare pour une durée indéfinie.»
-Ca se précise!
Je fais de l’humour, un peu.
D’autres minutes passent. Ca vous arrivera aussi que les minutes passent, vous verrez.
-N’empêche, ça va se compliquer si je peux pas arriver pour le dîner. Vous allez voir votre famille?
Moi qui voulais savoir sa vie, voilà qu’il m’interroge sur la mienne.
-Je...
J’ai pas du tout envie de parler de ma vie, j’ai envie de fumer.
-Vous avez du feu?
J’aime bien demander aux gens qui fument s’ils ont du feu. J’attends d’ailleurs qu’on me réponde un jour «non» depuis le temps que je pose la question.
Il sort son briquet.
-Ma mère déteste les retards.
-Existe-t-il seulement une mère qui aime passionnément ça?
Je fais de l’absurde, un peu, pour voir. La fumée chatouille ma gorge, je suis bien.
-Comment?
-Imaginez: une mère, un rendez vous pour dîner, un fils qui arrive avec 3 heures de retard, et la mère qui lance, quand elle lui ouvre la porte: «mon fils chéri, tu as toujours du retard, c’est ce que j’aime chez toi, on peut jamais savoir quand mettre le rôti au four, on est suspendu à ta fantaisie, mon fils chéri!». Imaginez un peu.
-Vous n’êtes pas très pressée, vous, hein?
-Je n’ai pas le temps pour ça, non.
«Le train Xtrucbidule9 à destination de là bas va partir.»
-Enfin!
-Bon, bin, bon courage pour votre car. Enfin, bonne chance quoi.
-Oui, enfin, dîner chez sa mère, vous savez, ça ne demande ni du courage ni de la chance... Juste une capacité d’évasion, à table, pendant qu’elle me racontera que son four marche mal et que le monde tourne pas rond.
Je suis déjà à peu près remontée pendant qu’il me dit ça, raison pour laquelle je ne lui réponds pas qu’il n’a pas le droit de parler «capacité d’évasion». Oh non. Ca lui est tout bonnement interdit. Ce serait comme un raciste du dernier degré qui réclamerait de la tolérance. Sa capacité d’évasion, il n’avait qu’à lui faire faire de l’exercice là, dans le train, parce qu’elle manque cruellement de souplesse. Et qu’il est au moins aussi rigide que sa mère qui, si ça se trouve, elle, prend le temps de ne serait-ce que critiquer la saleté d’une gare où on l’oblige à stationner en attendant que le train reparte. Mais qui ne passe pas son temps à réclamer qu’il file encore plus vite. Le temps.
J’étais à peu près remontée pendant qu’il m’avait dit ça.
J’ai repris place dans mon siège, déjà froid de mon corps. J’étais impatiente de voir un poteau, deux poteaux, 3 poteaux, une vache, un poteau, 3 vaches défiler. Quelle que soit la vitesse. Je voulais que ça défile. J’étais triste pour le type qui avait failli rentrer dans ma liste des «hommes élégants gratuitement». Failli, c’est le cas de le dire.
On ne pourra jamais trouver une once d’élégance chez un homme pressé de s’ennuyer et incapable de profiter du répit que lui offre la croisière de l’un à l’autre.
http://www.deezer.com/listen-7005970
On devrait tous passer notre vie en transit. Et ne pas le savoir, être convaincus qu’une gare nous attend, sinon, pourquoi cette valise et ces souvenirs achetés pour la famille? Il faudrait qu’on ne se rende pas compte que ça dure toujours. Il faudrait que ça dure toujours.
-maispastrop-
Je crois au pouvoir magique des trains, des avions et des bus. Je ne parle même pas des gros et grands bateaux qui font des randonnées de plusieurs jours.
J'émets cependant une certaine réserve concernant les taxis, comme tout bon parisien, et ce n’est pas à vous que j’expliquerai pourquoi. -Si vous ne voyez pas ce à quoi je fais référence, estimez-vous chanceux, tout simplement.-
Mais, les transports, les vrais, ceux dont on ne voit pas le conducteur, ceux où les passagers inconnus nous côtoient, nous frôlent, parfois; ceux où le paysage défile tantôt minuscule et lointain, tantôt grandeur nature, juste là, et campagnard peut-être, .... ceux-là abritent mes espoirs de bonheur pour l’humanité. L’humanité entière. Rien que ça. Oui, oui. J’y crois dur comme fer.
D’ailleurs, et pour y avoir réfléchi un chouia, il n’y a rien d’autre que j’estime plus à même de rendre l’homme heureux que le voyage. Non pas la destination, mais le trajet d’un point à un autre, et la magie avec laquelle cet espace-temps de tous les possibles s’empare de notre cortex et notre matière grise -ou ce qu’il en reste- pour nous ramener à ce qui nous anime et qui, étrangement, n’a pas sa place dans nos pensées et rêveries quotidiennes.
Peut-être parce que, au jour le jour, la rêverie et la pensée n’ont pas réellement leur place. Tout simplement, peut-être. Peut-être.
Souvent, la perspective de m’installer dans un TGV vers des vacances en Provence pour un mois m'enthousiasme bien plus que celle de me rendre en Provence pour le mois. Je n’ai pas honte de le dire. Ca ne signifie aucunement que le mois provençal à venir ne me fait pas envie, ça souligne simplement l’impatience de ressentir la rareté des émotions qui me remplissent lorsque je m’installe à une place précise dans une ville et qu’à la même place, quelques heures plus tard, je suis ailleurs. Dans une autre ville. Ailleurs où on ne parle parfois pas la même langue, ou bien, pas avec le même accent, et où je suis moi-même encore en train de traduire ce que je ressens alors qu’il faut déjà, paraît-il, prendre garde de n’avoir rien oublié et faire attention à la distance entre la marche et le quai.
J’oublierai tout, pourtant. Et la distance entre la marche et le quai n'arrête jamais, jamais, jamais de grandir. Elle est absolument affamée d’être plus grande qu’immense, cette distance. C’en est éreintant. Et fascinant à la fois.
Et toutes ces choses auxquelles j’aurais pensé pendant le trajet resteront comme suspendues, pour toujours, parce qu’elles ne sont pas productives, ou concrètes, mais enfouies quelque part et toujours furibondes. Pas du genre à se laisser attraper ou à se fixer quelque part.
Ce serait, si je voulais les imager, comme des animaux dans moi qui ne sortent le museau que lorsque leur niche avance à + de 50 km/h. Ca veut dire que je suis leur niche, pour ceux qui ne suivent qu’à moitié. Les ours hibernent l’hiver, et bien, eux, mes animaux furibonds, ils fleurissent en période de mouvement.
J’aimerais que mon bureau soit une cabine SNCF.
J’aimerais vraiment ça.
N’en déplaise à la table parisienne sur laquelle je couche beaucoup de paperasses et d’idées, aussi, quelquefois.
J’aimerais que ma jolie table parisienne, une fois que je m’y installe, se télétransporte dans un train qui n’aurait pas de destination sinon celle qui saurait que, quand je n’aurai plus rien à dire, ce sera ok, on pourra rentrer à la maison.
Et, il se trouve qu’on n’a jamais plus rien à dire.
Ou alors on est mort.
Ce train là est passé par mal de péripéties. Le genre d’emmerdements qui saupoudre encore un peu plus de miettes de honte sur les agents SNCF. Et sur les fonctionnaires en général, j’imagine.
D’abord, et bien, ce sera en retard que vous prendrez votre train.
Et, d’ailleurs, on ne sait pas de combien de minutes sera le retard.
Mais régulièrement, ça, très régulièrement, quelque chose comme toutes les 5 minutes, on vous assurera que le retard est effectif et que notre incompétence est pire.
Et puis, on vous fera monter dans le train, oui, mais on aura un problème de signalisation; un problème qui fait que, à un des stop, on marquera finalement une sorte d’arrêt. Un arrêt dont on ne peut pas dire s’il est définitif ou non.
Quand le train finira par repartir, on vous annoncera qu’à cause des problèmes sus-cités, on roulera à vitesse réduite. Mais on ne sait pas pour combien de temps. Ni vraiment à quelle vitesse, d’ailleurs.
On vous annonce le retard qu’on a déjà mais on ne peut pas s’exprimer sur celui qu’on aura au final, en gare, au terminus, là où tout le monde semble impatient d’arriver.
Alors les langues se délient.
Et ce n’est pas tout à fait ce que j’aime, dans le concept du voyage, l’imprévu qui fait que n’importe qui trouve normal de faire part de ses états d’âme n’importe comment. L’idée initiale était de laisser mes états d’âme tranquilles et libres de s’amuser, au fait, j’aurais du le leur dire. Et zut. Note pour plus tard: le leur dire. Le leur dire avant, au départ.
Je vois qu’ils n’aiment pas ça, la perspective de passer une heure de plus ici, alors j’en conclue avec ce que j’ai de sens de la déduction qu’ils envisagent ce train comme un simple train.
Ca me fait de la peine pour le train en question, le train qui abrite mes animaux furibonds et rares. J’ai envie de m’excuser auprès de ce train. Et auprès de mes animaux furibonds.
Il faut que j’arrête de croire tout le temps que tout a une âme. Non mais sérieusement, quand vous vous retrouverez dans la situation où, honteuse, vous réfléchissez à la meilleure façon de vous excuser de vos brusques et rustres congénères auprès d’une machine, vous comprendrez mon malheur, vous direz vous aussi qu’il faut que j’arrête de croire tout le temps que tout a une âme.
Je suis exaspérée par la vulgarité des passagers, la banalité avec laquelle ils accueillent la nouvelle, le costume évident du client en rogne qu’ils revêtent à la vitesse lumière, je me prends à réaliser qu’ils ne sont pas, eux, ici pour apprécier le trajet, mais pour aller d’un endroit à un autre. Point.
«On va toujours tous d’un endroit à un autre», j’me dis. «Qu’ils se calment un peu, là», je pense. Ca me rend folle qu’ils ne respectent pas davantage ce lieu précis où toutes les imaginations et tous les souvenirs peuvent grossir. Ca me rend folle.
Et puis, c’est pas comme si on était sur un Paris/New-York remplis de personnes, enfin, de têtes pensantes, qui devraient engranger du contrat. Non, aujourd'hui, nous sommes Septembre, comme dit l’autre, et je vous vois, vous êtes vieux, vous n‘avez pas rendez-vous, vous changez d’endroit parce que la retraite vous le permet, vous l’impose peut-être, parce que l’ennui vous y contraint. Alors, pourquoi vous impatienter d’arriver à un endroit où vous n’aurez pas plus de raison de vivre qu’à celui que vous venez de quitter.
Point d’interrogation.
Et puis personne ne vous attend. Personne ne vous attend nulle part.
«Occupez-vous donc d’être moins impatients», j’ai envie de leur crier.
Pendant le trajet, j’ai fait ma petite affaire de sentimentale nomade.
J’ai pensé à des choses auxquelles je ne pense jamais. J’ai été contente du retard, ce qui m’arrive rarement. J’ai apprécié l’odeur des fauteuils du train. J'ai compati avec ceux qui s'étaient retrouvés en salle de réunion pour décider du motif qui ornerait les sièges. J'ai aimé les motifs des sièges, et les sièges. J’ai même descendu la tablette pour y installer mon ordinateur et raconter tout ça.
Pendant que ça pestait partout, je n’avais qu’une envie, me rappeler à quel point je suis ok avec le mouvement, quitte à ce qu’il stagne. Alors il fallait que je l’écrive.
Et puis, non, au bout de quelques minutes, genre 14, 15, -ce qui est beaucoup, en termes de secondes, ou de retard par exemple- j’ai remonté la tablette et abandonné l’idée de raconter puisque le vrai événement c’est qu’il était beaucoup plus excitant de penser des trucs, des machins, des bribes d’idées et des avortons de concept, que de les immortaliser, noir sur blanc. Quitte à les oublier.
Il y a ceux qui ont un foyer qu’ils aiment et qu’ils veulent retrouver au plus vite. Il y a ceux qui supportent une vie de merde et qui sont heureux d’y échapper. Il y en a d’autres pour qui tout va bien, qui partent d’un foyer adorable pour retrouver une double vie adorée. Il y a la belle famille, contrainte de se rendre à la maison d’un père qui vient de mourir. Il y a l’antiquaire qui, sans parler de foyer ou de vie, ni de ce qu’il aime ou de ceux qui meurent, doit prendre le train, et prend le train, tous les jours que dieu fait, et puis.
C’est vrai que l’espace entre la marche et le quai est costaud, au moins autant que mes talons, il a fallu que je m'agrippe à la rambarde, enfin, ah non, à une épaule d’homme, manifestement, oups.
-Ah pardon. Je croyais attraper la rambarde.
-Je vous en prie.
Il dit ça sans vraiment me considérer. J’aime bien ça, qu’il m’aide, sans me considérer. C’est l’idée que je me fais de l’élégance.
-Merci.
-Je vous en prie.
Bon. Quelques minutes passent, ça arrive dans la vie.
«En raison d’un problème de signalisation, nous sommes dans l’obligation de stationner en gare.»
-Ca, ils nous l’ont déjà dit.
Il s’adresse à moi. Ou au vide, je ne sais pas.
-Oui, c’est vrai.
Je m’adresse et à lui et au vide, pour pas prendre de risques mais rester polie envers les deux.
J’ai pas envie de parler de ça. Et pourquoi pas la pluie et le beau temps, tant qu’on y est. S’il avait écouté ce que j’ai dit plus haut, il saurait que j’ai pas envie de parler du tout. Que sa politesse élégante est parfaite, qu’il faut s’en tenir là et arrêter de croire que, parce que nous sommes les passagers d’un même train, nous serions les esclaves des mêmes phobies. Et qu’en prime, nous aimerions tous les partager dans une partouze de plaintes et de revendications. Non. Non non et non.
-Moi j’ai un car à prendre. Et là, je sais pas si je l’aurai.
-Mmmmh.
Je peux pas m’empêcher de me demander si ce car ne serait pas l’équivalent de mon train. Peut-être que ce train n’était pour lui qu’un métro. Peut-être est-ce dans ce car qu’il compte rêvasser par la fenêtre, peut-être a-t-il un rendez-vous qu’il veut imaginer sur le décor, peut-être...
-A tous les coups, je l’aurai pas.
-Y’en a sûrement régulièrement.
J’y vais doucement.
-Au pire... toutes les heures, je rajoute.
Je prends mes précautions.
-Je sais pas, j’ai les horaires quelque part.
Il fouille dans sa poche, le con. Moi je veux qu’il me dise qu’il attend d’être sur un siège pas trop devant, pas trop derrière, ni non plus près des toilettes pour retrouver quelque chose de fou. Ou bien qu’il se taise à jamais.
-Regardez, y’en a un toutes les heures.
-Alors vous l’aurez.
-Comment?
-Bin... D’une façon ou d’une autre, vous l’aurez. A une heure, ou celle d’après. Mais vous l’aurez.
-Oui. Oui, bien sur. C’est vrai.
-Bon.
-Mais je ne sais pas lequel j’aurai.
Qu’il la crache sa valda bordel. Qu’est ce qu’il est si empressé de retrouver, je veux savoir.
«En raison d’un problème de signalisation, nous sommes dans l’obligation de stationner en gare pour une durée indéfinie.»
-Ca se précise!
Je fais de l’humour, un peu.
D’autres minutes passent. Ca vous arrivera aussi que les minutes passent, vous verrez.
-N’empêche, ça va se compliquer si je peux pas arriver pour le dîner. Vous allez voir votre famille?
Moi qui voulais savoir sa vie, voilà qu’il m’interroge sur la mienne.
-Je...
J’ai pas du tout envie de parler de ma vie, j’ai envie de fumer.
-Vous avez du feu?
J’aime bien demander aux gens qui fument s’ils ont du feu. J’attends d’ailleurs qu’on me réponde un jour «non» depuis le temps que je pose la question.
Il sort son briquet.
-Ma mère déteste les retards.
-Existe-t-il seulement une mère qui aime passionnément ça?
Je fais de l’absurde, un peu, pour voir. La fumée chatouille ma gorge, je suis bien.
-Comment?
-Imaginez: une mère, un rendez vous pour dîner, un fils qui arrive avec 3 heures de retard, et la mère qui lance, quand elle lui ouvre la porte: «mon fils chéri, tu as toujours du retard, c’est ce que j’aime chez toi, on peut jamais savoir quand mettre le rôti au four, on est suspendu à ta fantaisie, mon fils chéri!». Imaginez un peu.
-Vous n’êtes pas très pressée, vous, hein?
-Je n’ai pas le temps pour ça, non.
«Le train Xtrucbidule9 à destination de là bas va partir.»
-Enfin!
-Bon, bin, bon courage pour votre car. Enfin, bonne chance quoi.
-Oui, enfin, dîner chez sa mère, vous savez, ça ne demande ni du courage ni de la chance... Juste une capacité d’évasion, à table, pendant qu’elle me racontera que son four marche mal et que le monde tourne pas rond.
Je suis déjà à peu près remontée pendant qu’il me dit ça, raison pour laquelle je ne lui réponds pas qu’il n’a pas le droit de parler «capacité d’évasion». Oh non. Ca lui est tout bonnement interdit. Ce serait comme un raciste du dernier degré qui réclamerait de la tolérance. Sa capacité d’évasion, il n’avait qu’à lui faire faire de l’exercice là, dans le train, parce qu’elle manque cruellement de souplesse. Et qu’il est au moins aussi rigide que sa mère qui, si ça se trouve, elle, prend le temps de ne serait-ce que critiquer la saleté d’une gare où on l’oblige à stationner en attendant que le train reparte. Mais qui ne passe pas son temps à réclamer qu’il file encore plus vite. Le temps.
J’étais à peu près remontée pendant qu’il m’avait dit ça.
J’ai repris place dans mon siège, déjà froid de mon corps. J’étais impatiente de voir un poteau, deux poteaux, 3 poteaux, une vache, un poteau, 3 vaches défiler. Quelle que soit la vitesse. Je voulais que ça défile. J’étais triste pour le type qui avait failli rentrer dans ma liste des «hommes élégants gratuitement». Failli, c’est le cas de le dire.
On ne pourra jamais trouver une once d’élégance chez un homme pressé de s’ennuyer et incapable de profiter du répit que lui offre la croisière de l’un à l’autre.
http://www.deezer.com/listen-7005970
On devrait tous passer notre vie en transit. Et ne pas le savoir, être convaincus qu’une gare nous attend, sinon, pourquoi cette valise et ces souvenirs achetés pour la famille? Il faudrait qu’on ne se rende pas compte que ça dure toujours. Il faudrait que ça dure toujours.
-maispastrop-
J'ai deux humeurs: la mauvaise, et Paris.
Le retour à Paris dont tout le monde se plaint me ravit.
La fin Août, que d’aucuns consacrent à dilapider en enjambements de vergetures sur des plages embouteillées, m’offre un horizon dégagé sur le bitume, une température modérée et une faune triée sur le volet.
Il s’avère de plus en plus difficile d’apprécier cette satanée cité tant elle se laisse envahir par des mécréants, aussi je ne vais pas cracher sur les quelques semaines de répit qu’elle se paye et que je m’offre. Je pestais, avant, contre la fermeture des tabacs et l’invasion des amerloques, mais, j’ai appris, depuis, à garder mon rythme de vie estivalier en plein Belleville. Il suffit presque de penser «vacances» pour s’y sentir comme tel; ne pas trouver mon buraliste en bas de mon chez moi ouvert et devoir pousser le pas 150 mètres plus loin est un acte, si l’en est, qui ne diffère en rien des habitudes de plagistes que les parisiens adoptent si facilement, et avec un si grand sourire béat. Considérer le dimanche comme un jour mort, consacré au seigneur et au dieu Alka Seltzer, est supportable ici aussi. Puisque là bas j’achetais mon poisson le samedi, en prévision du jour super fermé sans Hyper U, pourquoi ne pas anticiper ma boîte de nuggets 48 heures à l’avance ici aussi. ? Quant aux citoyens américains, je sais maintenant que grâce à eux, et à leurs dollars dépensés n'importe comment, les musées de ma ville ont des murs propres. Donc bon.
J’arrête de pester contre cette ville, c’est outre décidé.
Ca ne m'amuse plus, cette horde sauvage toujours prête à couler ma cité.
Je l’aime parce qu’elle mérite d’être aimée.
Je ne laisserai plus personne dire le contraire.
Et puis, l’été, c'est pas trop ma came, faut dire.
C’est pas pour faire ma snob, mais quand même.
Ca n’a jamais été de nature à m’émoustiller, la perspective d’avoir à côtoyer du gras double torse nu au rayon Pastis de Carrefour. Ca me fait pas bander davantage, l’obligation de devoir partager mon lopin de sable avec les 3 petits derniers qui n’ont pour unique amusement que d’envoyer du sable sur mon bouquin et dans mes yeux. J’ai rarement trouvé alléchante la vue des cartes de restaurants qui augmentaient de 3 € pendant 2 mois leurs plats traduits en mauvais anglais.
Vous me direz, si j’avais ma maison à moi, dans les terres un peu, isolée en quelques sortes, avec une piscine et un petit jardin, tout ça, ce serait un autre son de cloche. J’aimerais l’été, par conséquent.
Que nenni.
D’une, si j’avais ma maison à moi, dans les terres un peu, isolée en quelques sortes, avec une piscine et un petit jardin, j’aimerais à peu près toutes les saisons, et la vie en général, et les gens, par dessus le marché.
De deux, j’y passerais alors certainement le plus clair de mon temps, à ne pas confondre avec "le plus chaud de mon temps", et je garderai le privilège des V(raies) I(solées) P(ersonnes) du mois d'Août à Paris. Paris serait ma résidence secondaire. Absolument.
Mais je n’ai pas ma maison à moi. Et les geignards rentrent au bercail.
Ils reviennent avec des tshirts I♥NY, Singapour, Calvi, Maubeuge.
Mon dieu.
Ils disent que Paris est sale, que Paris est chère, que Paris est snob. Ils disent ça à plusieurs, ils tombent tous d’accord pour une fois, ils souillent Paris dans un bar sale, cher, et snob. Un bar dans lequel ils vont tous les jours. Savent-ils seulement que rien de rien ne se fait ici bas si on doit construire sur du dénigrement passif? Imaginent-ils une seconde que les mondes dont ils rêvent sont remplis de personnes qui, le matin, ne prennent pas leur café pour supporter leur journée mais pour la rendre unique? Voudraient-ils qu'en plus de ce que le monde se plaît à dire, à raison, sur l'hygiène, le racisme, la prétention et le sentiment de supériorité des parisiens... le monde y rajoute le fait que, d'ailleurs, les incriminés sont incapables de s'en défendre et s'en sortir puisqu'ils sont partisans du rien...? Le voudraient-ils?
J'aime l'ironie, l'insolence et l'alcoolisme des parisiens, j'aime leur magnifique toupet, et leur incommensurable inconscience. C'est pourquoi, d'après moi, ceux d'entre eux qui se plaignent de Paris d'Août à Octobre ne sont que des petits pélerins perdus qui doivent trouver leur mecque et s'y faire les genoux ou panser de mille Compeed les ampoules qui les mèneront à leur saint jack de daniel.
Il y a quelques temps de ça, je m’étais renseignée sur le prix que coûterait la confection d’un tshirt sur lequel serait écrit «Et bin retournes-y, glandin». Je me disais que ceux qui devaient me comprendre me comprendraient. J'aimais bien l'idée qu'on se croise, eux et leur tshirt, et moi et le mien. ...Il aurait fallu que j’enlève «glandin» pour que la plaisanterie ne soit pas au-dessus de mes moyens...

J’en ai marre, marre marre marre de les entendre se plaindre, au retour des vacances. De supporter leurs regrets de ne pas être resté, d’être rentré, de "quand est ce qu'on repart?" et "il fait trop moche, quoi!". Sans même parler de l'accent nonchalant avec lequel ils larmoient les yeux secs, l'âme vide. Un accent qu'ils ont pris, "là bas".
Là bas où on se foutait bien de leur gueule/accent/ville.
Le pire, le pire du pire, c'est qu'en les écoutant, en décidant de, pourquoi pas, leur donner la chance d'exprimer peut-être une véritable pensée, on réalise qu'ils ne font que regretter un endroit où ils ont passé 2 mois avec des parisiens pour des parisiens. C'est fou. C'est complétement fou, en fait. En vrai, non mais, attendez, si on réfléchit 2 secondes, c'est tellement fou. Ca veut dire que:
Salut, je suis parisien, je m'en vais en vacances, je suis trop joisse.
Salut je suis parisien, je rentre de vacances, je suis trop down.
-Ah merde. Mais pourquoi?
-Bin, tu vois, là bas, c'était... Pfiouh.
-Mmmmh. Ouais. Mais encore?
-Pfiouh.
-"Pfiouh" ne veut rien dire, ok? "Pfiouh" peut être assimilé de plein de manières différentes. Par exemple, moi, là, je me dis que "pfiouh, tu t'es fait chier quoi!"
-Non mais t'es folle!
Le parisien réagit super vite quand on a pas compris sa crâne. Super, super vite.
-Alors "pfiouh" quoi?
-Pfiouh, le festival, les concerts, les potes...
-Mmmmh.
-Non mais même les backstages quoi.
-Les backstages aussi étaient "pfiouh"?
-Les backstages étaient ûber Pfiouh.
-En gros, ce qui était Pfiouh, c'était de vivre à Paris au bord de la mer?
-Quoi?
-Pffff.........
De la colonie de vacances à la colonisation de vacanciers, il y a une légère frontière que le rustre ne manque jamais de dépasser.
Ils reviennent, qu'à cela ne tienne, je m'en vais. Vraiment, leur bronzage exagéré me fait pâlir de nausée. Sans compter qu'il dissimule trop mal leur tristesse, il me rappelle les fonds de teint trop épais sur les femmes fatales vieillissantes.
Il y a des trains tous les jours, certains d'entre eux se dirigent même vers des endroits où les parisiens ne sont plus.
Salut la compagnie.
Je reviendrai quand mes congénères -et dans "congénères", il a y "génères"- auront fabriqué du projet, du futur et de l'effervescence au lieu de se croire nostalgiques et de ne pourtant faire écho à aucun passé, aucune histoire, seulement de l'ennui. Je reviendrai parce que très vite, bien plus vite que prévu, Paris me manquera. Paris manquera à ma vie. A mon quotidien. Quand je pourrai à nouveau supporter qu'elle vaille plus que ses lâches disciples et ses nombreux traîtres.
C’est le seul problème de Paris: elle est infestée de Parisiens. De Parisiens qui ne l’apprécient pas à sa juste valeur. Non, parce que oui, Paris a une valeur, n’en déplaise aux sceptiques.
Comme je les déteste. Je les déteste allégrement. Je les conchie, même, pour être tout à fait honnête. Je ne veux pas être des leurs. Plutôt crever.
A mon retour, revigorée par l'iode et rassasiée de calme, je leur rappellerai qu'ils oublient régulièrement un détail, ces parisiens qui n'aiment rien, c'est qu'en retour, personne ne les aime davantage. C'est bien fait pour eux.
Je ne suis pas loin de rouspéter contre tout et tout le monde, il semblerait.
C'est que je suis parisienne, oui monsieur.
Et que j'aime ça.
-maispastrop-
Quand j'étais petite, je n'étais pas grande.
L’été est terminé, à ce qu’il paraît.
A-t-il seulement commencé un jour?, objecterez-vous.
Parce que je ne suis pas miss météo, je ne vous répondrai pas. Je parlais de l’été, comme ça, pour faire joli, pour commencer mon texte; tout ce qui est technique, ensuite, ça me passe au dessus de la tête et par delà les nuages.
Et puis l’été, j’m’en fous pas mal.
La météo de manière générale, d’ailleurs, ça me fait ni chaud ni froid. Je m’estime chanceuse de ne pas être de ceux qui, au réveil, savent tout de suite que leur journée sera belle ou pas selon que le thermomètre est haut ou non.
M’enfin, c’est comme ça, Septembre arrive et ses pleurnichards avec. Ce que d’aucuns nomment «la reprise» me paraît précisément être une période de raccords et de rafistolages, de la basse couture consistant à faire tenir un bouton hésitant sur un manteau, ou à cacher un trou dans une veste, grâce à un vieux tissu, gardé, là, dans le tiroir rempli de bidules qu’on croyait inutiles.
Ca reprise sec, donc.
On reprend contact avec ceux qu’on n’a pas vus depuis 3 mois, on replonge la tête dans les boulots qu’on avait survolés, on repousse le pastis à 20h, au lieu des 17h adoptées depuis la mi-juin.Et puis on finira par le remplacer complétement pour ne le retrouver que l'année prochaine, comme un amour de vacances.
On fait comme on peut avec ce qu’on a, on encaisse comme on peut ce qu’on n’aura plus, on tente d’accepter ce avec quoi on va devoir vivre, là, à l’année, en traînant un peu des pieds. On raccommode et on s’en accommode.
Dans ma résidence secondaire -qui est un appartement sans jardin ni piscine mais mérite l’appellation tout autant que vos mas de Provence- j’ai rangé mes souvenirs d’enfance. Dans ma résidence secondaire, j’ai rangé mes souvenirs d’enfance. Dit comme ça, on dirait du Delerm, ça me dégoûte, je me dégoûte.
D’autant que «Souvenirs d’enfance» est ici une appellation complètement inappropriée puisque, voilà, il a bien fallu m’y résoudre: aucune des peluches, aucun des puzzles, des livres, des dessins, des lettres ... ne me rappelaient quoique ce soit de cette période désordonnée, gesticulante et pisseuse qu’est la sacro-sainte Enfance.
Enfin, bon.
Il y avait bien une sorte de mammifère informe, proche du félin, du lionceau même, qui me projetait en arrière et m’envoyait des images de moi, ridiculement petite, amoureusement accrochée à cette masse de matière synthétique. Du genre à piquer des crises si, par malheur, quelqu’un de sensé décidait de le laver et, par là même, de le soustraire à ma nuit. Nuit qui devenait par conséquent insupportable et, surtout, absolument blanche, sans sa présence, son odeur, sa forme, bref, vous voyez qu’est ce que je veux dire.
Ca oui, lui, ça m’a parlé, de le sortir de la malle. Je l’ai même respiré. J’ai fait ce geste inconsidéré: je l’ai respiré. Bien entendu, tout ce que ça sentait, c’était la vieille paille et l'ouate enfermées depuis 10 ans. Mais je l’ai fait. Alors je n’étais plus en position de nier que j’avais un jour été petite. Gesticulante, désordonnée, pisseuse et affreusement attachée à une peluche aux yeux faits d'une matière dont je jurerais qu’elle est aujourd’hui interdite.
Il y avait aussi un livre. Un truc à la con, mais bien pensé, hein. Tous les Walt Disney mis par écrit accompagnés des vraies images des dessins animés. Quand je l’ai ouvert, et dieu sait que j’aurais voulu l’éviter, j’ai ressenti non pas la mémoire de l’émotion d’alors, mais l’émotion pure.
Voilà que je me disais «Wahou, comment c’est magique, j’ai l'image en dessin, là, pour moi!»; et que je passais ma main dessus; et que je tournais frénétiquement les pages; et que je décidais qui de Blanche Neige ou de Cendrillon était la plus jolie.
Blanche Neige a toujours été la plus jolie, on est tous d’accord. N’empêche, le livre, il permet de faire la comparaison en direct. Avec les VHS, c’était pas si facile.
Et que je me demandais si j’avais toujours les VHS.
...
J’ai décidé de jeter les poupées. La plupart sont affreusement terrifiantes. Sans rire, si je voulais faire peur à un gosse, c’est précisément comme ça que je les ferais, ces poupées de malheur.
La pire, c’était celle dont les yeux s’ouvraient ou se fermaient selon qu’on la couchait ou qu’on la tenait debout. J’en ai frissonné, à 28 ans. Non, vraiment, c’était pas de mon âge.
Pourtant, à y regarder de plus près, je voyais qu’ici, j’avais maquillé machine, que là, j’avais coupé les cheveux à trucmuche. Et, mais oui: j’avais carrément mis ma robe de bébé à cette pouffe de boucle d’or!
J’avais donc vécu avec elles, je les avais aimées; si ça se trouve, je leur avais peut-être même donné des prénoms et tout le bordel.
Je voulais les jeter, elles. J’ai juste gardé leurs têtes. Je jugeais qu’il y aurait forcément quelque chose à faire de toutes ces têtes. Comme... je sais pas, moi, les mettre dans un carton et les envoyer à quelqu’un qu’on aime pas. Par exemple. En séparant les têtes des corps, j’agissais en adulte; mes préoccupations étaient tout à fait pragmatiques: comment ne pas abîmer le cou?, et si c’est rempli de produits toxiques?, est ce que cette tête tiendrait attachée à un fil de fer dans mes toilettes? tout ça, tout ça. Des trucs d’adultes, vous dis-je. Et puis, bim. C’est arrivé comme ça, mes mains ont refusé d’en disséquer une. Ma tête, aussi sec, rappelle son autorité. Ma tête est supposée être celle qui décide de ce que fera chacun des membres du corps, c’est la règle, on s’est mis d’accord, sinon, où va le monde. Mais rien n’y faisait. Mes mains restaient comme ça, interdites, genre rebelles qui font la grève et tout. Ca rendait ma tête folle. Tout moi, exceptées mes mains, était furax devant ce refus de coopérer.
Le meilleur truc à faire, dans ces cas-là, c’est de fumer une cigarette. Mes mains étaient ok pour fumer une cigarette. Et tout mon corps n’attendait que ça.
Je fumais une cigarette devant la poupée, pour relativiser, pour comprendre peut-être. Pour fumer, principalement.
Quelques minutes plus tard, j’arrivais à séparer la tête du corps. C’était foutu comme sur les barbies: le cou finissait en un petit rond sur lequel le trou de la tête venait se lover. C’était pas si difficile à enlever, et, m’est avis que c’était pensé aussi pour que ça puisse se remettre. Etrangement, j’ai eu l’impression que je faisais quelque chose de mal, qu'il fallait pas qu'on me voie. C’était le pompon: moi qui m’évertuais à donner un sens à tout ce néant, voilà que je me sentais presque coupable.
La vie, parfois, j’vous jure...
Toutes ces têtes plus tard, j’admirais le vide que j’avais fait dans l'obscénité consumériste que représente une vie d’enfant. Qu’est ce que j’en avais à faire, à l’époque, de la façon dont ça avait été fait, tous ces jouets? Et par qui? Et où? Et de leur impact écologique? Rien de rien, j’en avais rien à faire. J’en avais rien à faire de rien. C’est ce que j’aime pas trop chez les enfants, cette nonchalance pure et innocente avec laquelle ils se promènent dans une vie tout juste bonne à être recyclée. Cet acharnement avec lequel ils exigent qu’on remplace un jouet pas utilisé par autre jouet qu’ils n’ouvriront pas. Jamais je serai cap’ d’affronter cette bêtise entêtée, jamais je ne tolérerai qu’elle sorte de mon vagin en tout cas.
J’ouvrais la porte au voisin qui, chacun sa vie, avait décidé d’avoir 7 enfants. Oui, 7. Sept comme les jours de la semaine, qui ne devaient d’ailleurs certainement pas suffire à les combler. Comme les 7 nains, aussi, qui ne les amusaient sûrement pas vu qu’on est en 2010 et que la Playstation existe. Comme les 7 merveilles du monde, également. Quoiqu’ici, la comparaison me fait un peu mal au coeur: un coup de rein, et hop: un mioche. En revanche, les palais suspendus de Babylone, c’était une autre paire de manche comme dirait quelqu’un d’un peu vieux, d’un peu réac et avec qui je serais absolument d’accord au point de dire que j’allais le dire.
Bref, le pondeur sonnait.
Je l’accompagnais dans le salon où l’équivalent de 14 kilos de jouet l’attendaient.
-Tout ça ! Mais... Vous ne gardez rien?
-Non, si. Enfin. Bon.
-Vous ne gardez rien?
Le type devait avoir l’habitude de répéter les choses, à force, j’imagine.
-N.O.N. S.I. E.N.F.I.N. B.O.N.
Il commençait à ouvrir les sacs quand j’ai senti que la question que je voulais m’interdire de lui poser allait quand même sortir de ma bouche. Il devenait urgent de discipliner certaines parties de mon corps, manifestement.
-Vous avez vraiment 7 enfants?
-Les poupées... elles... heu... il n’y a pas de corps?
Puisqu’il ne s’était pas gêné, j’allais pas me gêner:
-Je disais: vous avez vraiment 7 enfants?
-Les 7 merveilles du monde, oui! Vous les adoreriez. Il faut absolument que vous veniez les voir. Surtout après tous ces cadeaux !
Arf, l’air me manquait, j’essayais donc de me dépatouiller:
-Oui, non, j’ai enlevé les têtes. Mais les enfants s’en branlent de toute façon, non?
-Oui, non, enfin, sans tête, quand même...je sais pas trop.
-Ah. Vous devriez commencer à avoir de l’expérience pourtant.
J’ai souri, quand même.
Il a souri, du coup.
Le sourire, c’est un truc assez contagieux. Comme le bâillement. J’aurais pu bailler au lieu de sourire. Rapport au fait que je m’étais pas ennuyée à ce point depuis à peu près mon bac philo, mais j’ai jugé le sourire plus sociable. On a souri, quoi.
Les puzzles l’avaient ravi. Ce que je peux aisément comprendre. Ces puzzles étaient maboulement cool. Mais, honnêtement, les garder aurait impliqué que je les fasse, et quelqu’un qui n’a pas envoyé ses feuilles de soins depuis 3 ans peut-il vraiment se permettre de faire un puzzle de 375 pièces des espèces en voie de disparition? Sans compter que les espèces avaient à 75% véritablement disparu, depuis.
Je l’accompagnais à la porte, en l’aidant à transporter tout ce ramassis de connerie quand un corps s’est échappé du sac des cadavres de poupées.
-Laissez, je vais le ramasser.
Et, il allait pour le ramasser.
Bim, encore, ça m’a repris. Mes mains ont lâché tout ce que je portais et ma bouche a dit, hurlé peut-être, «Mathilde!»
Bien entendu, mon voisin ne s'appelait pas Mathilde. J’imagine qu’il y a des parents qui vont déclarer les prénoms de leurs enfants à l’Etat Civil en état d'ébriété, mais pas au point de confondre le sexe. C’est la raison pour laquelle il n’a pas pensé que je l'appelais lui mais que j'appelais la poupée. Pas bête, le voisin.
-Elle s’appelle Mathilde?
Voilà qu’après mes mains et ma bouche, c’était mes joues qui décidaient de n’en faire qu’à leur tête et rougissaient, rougissaient, rougissaient jusqu’à ce que j’ai trop chaud et honte pour affronter devant un inconnu des années de souvenirs qu’on me renvoyait en vrac.
Je partais à la cuisine pour ne pas avoir à lui parler en face, finalement c’était presque un inconnu. La dernière personne avec qui je voulais partager ça. Ou peut-être la seule, remarque.
Depuis l’évier où je m’aspergeais le visage autant que possible, je lâchais, d'un ton que je voulais tout à fait neutre:
-Oui, elle s’appelle Mathilde. Je vous laisse ramener les affaires, je me sens patraque. Vous laisserez le corps de Mathilde ici en partant, s’il vous plaît. Le bonjour à vos merveilles et tout ça, bref, bonsoir.
Il avait rien dit. Il était habitué, il en avait 7. Oui, Sept.
Quand j’ai entendu la porte se fermer, je me suis précipitée vers l’entrée où gisait tout ce qu’il y avait de moins spirituel chez Mathilde. Et puis, juste après je me suis jetée sur le sac où j’avais rangé les intellect. La tête était là. Elle n’attendait que moi, quasi.
Je me suis assise en tailleur et j’ai remis Mathilde du haut sur Mathilde du bas. Il est possible que je me sois excusée, mais, même si c’était le cas, je ne l’avouerai pas.
Mathilde était entière, droite dans ses bottes, la tête sur les épaules, et ce petit regard inquisiteur de celle qui vous en veut d’avoir oublié qu’elle avait été votre confidente pendant des années.
Ca m’était revenu, à la dernière minute, comme l’huile d’olive qu’on a oubliée alors qu’on est déjà à la caisse. J’avais tout raconté à Mathilde. Personne me connaissait mieux. Je lui avais menti aussi; des histoires abracadabrantesques, je lui en avais servi sur divers plateaux. C’est ce que j’aime bien chez les enfants, qu’ils racontent des trucs impossibles à des poupées en plastique fabriquées en Chine. C’est pour ça que ce sont des enfants après tout, j’imagine, et qu’un jour, puisqu'ils grandissent, ils se séparent de certaines poupées.
C’était début Septembre, bientôt la reprise, et avant de fermer mon sac pour Paris, je m’assurais de ne pas froisser encore Mathilde de peur que son cou finisse par rompre complètement. Et puis, je savais pas coudre. Au pire, je demanderai à môman de faire un petit point de rafistolage.
-maispastrop-
A-t-il seulement commencé un jour?, objecterez-vous.
Parce que je ne suis pas miss météo, je ne vous répondrai pas. Je parlais de l’été, comme ça, pour faire joli, pour commencer mon texte; tout ce qui est technique, ensuite, ça me passe au dessus de la tête et par delà les nuages.
Et puis l’été, j’m’en fous pas mal.
La météo de manière générale, d’ailleurs, ça me fait ni chaud ni froid. Je m’estime chanceuse de ne pas être de ceux qui, au réveil, savent tout de suite que leur journée sera belle ou pas selon que le thermomètre est haut ou non.
M’enfin, c’est comme ça, Septembre arrive et ses pleurnichards avec. Ce que d’aucuns nomment «la reprise» me paraît précisément être une période de raccords et de rafistolages, de la basse couture consistant à faire tenir un bouton hésitant sur un manteau, ou à cacher un trou dans une veste, grâce à un vieux tissu, gardé, là, dans le tiroir rempli de bidules qu’on croyait inutiles.
Ca reprise sec, donc.
On reprend contact avec ceux qu’on n’a pas vus depuis 3 mois, on replonge la tête dans les boulots qu’on avait survolés, on repousse le pastis à 20h, au lieu des 17h adoptées depuis la mi-juin.Et puis on finira par le remplacer complétement pour ne le retrouver que l'année prochaine, comme un amour de vacances.
On fait comme on peut avec ce qu’on a, on encaisse comme on peut ce qu’on n’aura plus, on tente d’accepter ce avec quoi on va devoir vivre, là, à l’année, en traînant un peu des pieds. On raccommode et on s’en accommode.
Dans ma résidence secondaire -qui est un appartement sans jardin ni piscine mais mérite l’appellation tout autant que vos mas de Provence- j’ai rangé mes souvenirs d’enfance. Dans ma résidence secondaire, j’ai rangé mes souvenirs d’enfance. Dit comme ça, on dirait du Delerm, ça me dégoûte, je me dégoûte.
D’autant que «Souvenirs d’enfance» est ici une appellation complètement inappropriée puisque, voilà, il a bien fallu m’y résoudre: aucune des peluches, aucun des puzzles, des livres, des dessins, des lettres ... ne me rappelaient quoique ce soit de cette période désordonnée, gesticulante et pisseuse qu’est la sacro-sainte Enfance.
Enfin, bon.
Il y avait bien une sorte de mammifère informe, proche du félin, du lionceau même, qui me projetait en arrière et m’envoyait des images de moi, ridiculement petite, amoureusement accrochée à cette masse de matière synthétique. Du genre à piquer des crises si, par malheur, quelqu’un de sensé décidait de le laver et, par là même, de le soustraire à ma nuit. Nuit qui devenait par conséquent insupportable et, surtout, absolument blanche, sans sa présence, son odeur, sa forme, bref, vous voyez qu’est ce que je veux dire.
Ca oui, lui, ça m’a parlé, de le sortir de la malle. Je l’ai même respiré. J’ai fait ce geste inconsidéré: je l’ai respiré. Bien entendu, tout ce que ça sentait, c’était la vieille paille et l'ouate enfermées depuis 10 ans. Mais je l’ai fait. Alors je n’étais plus en position de nier que j’avais un jour été petite. Gesticulante, désordonnée, pisseuse et affreusement attachée à une peluche aux yeux faits d'une matière dont je jurerais qu’elle est aujourd’hui interdite.
Il y avait aussi un livre. Un truc à la con, mais bien pensé, hein. Tous les Walt Disney mis par écrit accompagnés des vraies images des dessins animés. Quand je l’ai ouvert, et dieu sait que j’aurais voulu l’éviter, j’ai ressenti non pas la mémoire de l’émotion d’alors, mais l’émotion pure.
Voilà que je me disais «Wahou, comment c’est magique, j’ai l'image en dessin, là, pour moi!»; et que je passais ma main dessus; et que je tournais frénétiquement les pages; et que je décidais qui de Blanche Neige ou de Cendrillon était la plus jolie.
Blanche Neige a toujours été la plus jolie, on est tous d’accord. N’empêche, le livre, il permet de faire la comparaison en direct. Avec les VHS, c’était pas si facile.
Et que je me demandais si j’avais toujours les VHS.
...
J’ai décidé de jeter les poupées. La plupart sont affreusement terrifiantes. Sans rire, si je voulais faire peur à un gosse, c’est précisément comme ça que je les ferais, ces poupées de malheur.
La pire, c’était celle dont les yeux s’ouvraient ou se fermaient selon qu’on la couchait ou qu’on la tenait debout. J’en ai frissonné, à 28 ans. Non, vraiment, c’était pas de mon âge.
Pourtant, à y regarder de plus près, je voyais qu’ici, j’avais maquillé machine, que là, j’avais coupé les cheveux à trucmuche. Et, mais oui: j’avais carrément mis ma robe de bébé à cette pouffe de boucle d’or!
J’avais donc vécu avec elles, je les avais aimées; si ça se trouve, je leur avais peut-être même donné des prénoms et tout le bordel.
Je voulais les jeter, elles. J’ai juste gardé leurs têtes. Je jugeais qu’il y aurait forcément quelque chose à faire de toutes ces têtes. Comme... je sais pas, moi, les mettre dans un carton et les envoyer à quelqu’un qu’on aime pas. Par exemple. En séparant les têtes des corps, j’agissais en adulte; mes préoccupations étaient tout à fait pragmatiques: comment ne pas abîmer le cou?, et si c’est rempli de produits toxiques?, est ce que cette tête tiendrait attachée à un fil de fer dans mes toilettes? tout ça, tout ça. Des trucs d’adultes, vous dis-je. Et puis, bim. C’est arrivé comme ça, mes mains ont refusé d’en disséquer une. Ma tête, aussi sec, rappelle son autorité. Ma tête est supposée être celle qui décide de ce que fera chacun des membres du corps, c’est la règle, on s’est mis d’accord, sinon, où va le monde. Mais rien n’y faisait. Mes mains restaient comme ça, interdites, genre rebelles qui font la grève et tout. Ca rendait ma tête folle. Tout moi, exceptées mes mains, était furax devant ce refus de coopérer.
Le meilleur truc à faire, dans ces cas-là, c’est de fumer une cigarette. Mes mains étaient ok pour fumer une cigarette. Et tout mon corps n’attendait que ça.
Je fumais une cigarette devant la poupée, pour relativiser, pour comprendre peut-être. Pour fumer, principalement.
Quelques minutes plus tard, j’arrivais à séparer la tête du corps. C’était foutu comme sur les barbies: le cou finissait en un petit rond sur lequel le trou de la tête venait se lover. C’était pas si difficile à enlever, et, m’est avis que c’était pensé aussi pour que ça puisse se remettre. Etrangement, j’ai eu l’impression que je faisais quelque chose de mal, qu'il fallait pas qu'on me voie. C’était le pompon: moi qui m’évertuais à donner un sens à tout ce néant, voilà que je me sentais presque coupable.
La vie, parfois, j’vous jure...
Toutes ces têtes plus tard, j’admirais le vide que j’avais fait dans l'obscénité consumériste que représente une vie d’enfant. Qu’est ce que j’en avais à faire, à l’époque, de la façon dont ça avait été fait, tous ces jouets? Et par qui? Et où? Et de leur impact écologique? Rien de rien, j’en avais rien à faire. J’en avais rien à faire de rien. C’est ce que j’aime pas trop chez les enfants, cette nonchalance pure et innocente avec laquelle ils se promènent dans une vie tout juste bonne à être recyclée. Cet acharnement avec lequel ils exigent qu’on remplace un jouet pas utilisé par autre jouet qu’ils n’ouvriront pas. Jamais je serai cap’ d’affronter cette bêtise entêtée, jamais je ne tolérerai qu’elle sorte de mon vagin en tout cas.
J’ouvrais la porte au voisin qui, chacun sa vie, avait décidé d’avoir 7 enfants. Oui, 7. Sept comme les jours de la semaine, qui ne devaient d’ailleurs certainement pas suffire à les combler. Comme les 7 nains, aussi, qui ne les amusaient sûrement pas vu qu’on est en 2010 et que la Playstation existe. Comme les 7 merveilles du monde, également. Quoiqu’ici, la comparaison me fait un peu mal au coeur: un coup de rein, et hop: un mioche. En revanche, les palais suspendus de Babylone, c’était une autre paire de manche comme dirait quelqu’un d’un peu vieux, d’un peu réac et avec qui je serais absolument d’accord au point de dire que j’allais le dire.
Bref, le pondeur sonnait.
Je l’accompagnais dans le salon où l’équivalent de 14 kilos de jouet l’attendaient.
-Tout ça ! Mais... Vous ne gardez rien?
-Non, si. Enfin. Bon.
-Vous ne gardez rien?
Le type devait avoir l’habitude de répéter les choses, à force, j’imagine.
-N.O.N. S.I. E.N.F.I.N. B.O.N.
Il commençait à ouvrir les sacs quand j’ai senti que la question que je voulais m’interdire de lui poser allait quand même sortir de ma bouche. Il devenait urgent de discipliner certaines parties de mon corps, manifestement.
-Vous avez vraiment 7 enfants?
-Les poupées... elles... heu... il n’y a pas de corps?
Puisqu’il ne s’était pas gêné, j’allais pas me gêner:
-Je disais: vous avez vraiment 7 enfants?
-Les 7 merveilles du monde, oui! Vous les adoreriez. Il faut absolument que vous veniez les voir. Surtout après tous ces cadeaux !
Arf, l’air me manquait, j’essayais donc de me dépatouiller:
-Oui, non, j’ai enlevé les têtes. Mais les enfants s’en branlent de toute façon, non?
-Oui, non, enfin, sans tête, quand même...je sais pas trop.
-Ah. Vous devriez commencer à avoir de l’expérience pourtant.
J’ai souri, quand même.
Il a souri, du coup.
Le sourire, c’est un truc assez contagieux. Comme le bâillement. J’aurais pu bailler au lieu de sourire. Rapport au fait que je m’étais pas ennuyée à ce point depuis à peu près mon bac philo, mais j’ai jugé le sourire plus sociable. On a souri, quoi.
Les puzzles l’avaient ravi. Ce que je peux aisément comprendre. Ces puzzles étaient maboulement cool. Mais, honnêtement, les garder aurait impliqué que je les fasse, et quelqu’un qui n’a pas envoyé ses feuilles de soins depuis 3 ans peut-il vraiment se permettre de faire un puzzle de 375 pièces des espèces en voie de disparition? Sans compter que les espèces avaient à 75% véritablement disparu, depuis.
Je l’accompagnais à la porte, en l’aidant à transporter tout ce ramassis de connerie quand un corps s’est échappé du sac des cadavres de poupées.
-Laissez, je vais le ramasser.
Et, il allait pour le ramasser.
Bim, encore, ça m’a repris. Mes mains ont lâché tout ce que je portais et ma bouche a dit, hurlé peut-être, «Mathilde!»
Bien entendu, mon voisin ne s'appelait pas Mathilde. J’imagine qu’il y a des parents qui vont déclarer les prénoms de leurs enfants à l’Etat Civil en état d'ébriété, mais pas au point de confondre le sexe. C’est la raison pour laquelle il n’a pas pensé que je l'appelais lui mais que j'appelais la poupée. Pas bête, le voisin.
-Elle s’appelle Mathilde?
Voilà qu’après mes mains et ma bouche, c’était mes joues qui décidaient de n’en faire qu’à leur tête et rougissaient, rougissaient, rougissaient jusqu’à ce que j’ai trop chaud et honte pour affronter devant un inconnu des années de souvenirs qu’on me renvoyait en vrac.
Je partais à la cuisine pour ne pas avoir à lui parler en face, finalement c’était presque un inconnu. La dernière personne avec qui je voulais partager ça. Ou peut-être la seule, remarque.
Depuis l’évier où je m’aspergeais le visage autant que possible, je lâchais, d'un ton que je voulais tout à fait neutre:
-Oui, elle s’appelle Mathilde. Je vous laisse ramener les affaires, je me sens patraque. Vous laisserez le corps de Mathilde ici en partant, s’il vous plaît. Le bonjour à vos merveilles et tout ça, bref, bonsoir.
Il avait rien dit. Il était habitué, il en avait 7. Oui, Sept.
Quand j’ai entendu la porte se fermer, je me suis précipitée vers l’entrée où gisait tout ce qu’il y avait de moins spirituel chez Mathilde. Et puis, juste après je me suis jetée sur le sac où j’avais rangé les intellect. La tête était là. Elle n’attendait que moi, quasi.
Je me suis assise en tailleur et j’ai remis Mathilde du haut sur Mathilde du bas. Il est possible que je me sois excusée, mais, même si c’était le cas, je ne l’avouerai pas.
Mathilde était entière, droite dans ses bottes, la tête sur les épaules, et ce petit regard inquisiteur de celle qui vous en veut d’avoir oublié qu’elle avait été votre confidente pendant des années.
Ca m’était revenu, à la dernière minute, comme l’huile d’olive qu’on a oubliée alors qu’on est déjà à la caisse. J’avais tout raconté à Mathilde. Personne me connaissait mieux. Je lui avais menti aussi; des histoires abracadabrantesques, je lui en avais servi sur divers plateaux. C’est ce que j’aime bien chez les enfants, qu’ils racontent des trucs impossibles à des poupées en plastique fabriquées en Chine. C’est pour ça que ce sont des enfants après tout, j’imagine, et qu’un jour, puisqu'ils grandissent, ils se séparent de certaines poupées.
C’était début Septembre, bientôt la reprise, et avant de fermer mon sac pour Paris, je m’assurais de ne pas froisser encore Mathilde de peur que son cou finisse par rompre complètement. Et puis, je savais pas coudre. Au pire, je demanderai à môman de faire un petit point de rafistolage.
-maispastrop-
Rosa, rosa, rosam ; rosae, rosae, rosas...
Les vacances scolaires arrivent,
je me replonge donc logiquement dans l’ambiance estudiantine. Agenda, devoirs et mercredi après-midi aérés seront, cet été encore, mes meilleurs ennemis.
Non pas que je veuille faire absolument mon originale à l’encontre de la norme et des calendriers communément adoptés, mais j’ai toujours été archi d’accord avec Michmich’: «Qu’il est doux de ne rien faire quand tout s’agite autour de nous», ah ça oui; et, dans le même ordre d’idée, j’ajoute: Quand plus personne n’en fout une, j’ai comme envie de me secouer les puces.
Voilà, j’ai des devoirs qui m’attendent.
Au delà de l'incommensurable effort que ça va me demander niveau paperasse et relations familiales -pour ne citer que les taches les plus sexy- il va me falloir user de subterfuges, aussi, pour me coller à mes exercices.
Des exercices donc, non pas de gymnastique, quelle idée! mais d’écriture.
Ah, vous pouvez rire autant qu’il vous plaira. Il me plaira aussi que vous riiez, j’aime ça, que les gens se la fendent. N’empêche, y’a pas à chipoter, les exercices, ça fait son homme. Quand je faisais du piano, je la voyais, la différence, après 2h30 passées à refaire une trille infernale qui tirait sur les ligaments de la main. Et je vous raconte pas pour la danse. Pointes, pointes, un coupé pour soit disant respirer, et pointes encore, et toujours, pointes-pointes-pointes. Tant qu’on n'a pas saigné des pieds, tant qu’on n’a pas le poignet en steak tartare, tant qu’on ne connaît pas toutes les conjonctions de coordination...on n’y est pas, on n’y sera jamais.
Des exercices, disais-je. Pour m’aventurer dans ces couloirs de ma tête où j’ai la flemme de me rendre spontanément; pour m’y égarer, si le plan fonctionne; pour, surtout, sauver des muscles à la limite de l’atrophie. -Déjà qu’un muscle qui se nécrose c’est pas beau à voir, imaginez donc ça, dans le décor du cerveau, qui en soi n’est pas de nature à émoustiller les sens: c’est la cata.- Trouver un second souffle, enfin. Et repartir de plus belle, courbatue mais vaillante.
Y’a pas que les chevaliers qui font des exploits, attends. Et, je mets ma main à couper que nombre d’explorateurs connaissaient mieux certaines îles que leur propre lobe temporal.
Si je mets «ma main à couper» là, c’est notamment parce que les explorateurs dignes de ce nom sont morts, aujourd’hui, et qu’ils ne pourront donc pas me contredire. Et que je n’ai aucune envie de me passer de ma main. Ma main me sera utile. Pour la danse, pour le piano, pour l’écriture, pour la masturbation. De moi, des autres. J’y tiens. Un peu comme à la prunelle de mes yeux. Elle a d’ailleurs servi à l’instant même à expliquer combien elle me servirait encore.
Je le ferai seule, cet exercice, il paraît.
Alors que, d’habitude, on s’appelle entre copinous pour les rédactions, on se retrouve au café pour les exposés et on fait appel à des coachs, à ce qu’il paraît, pour surveiller notre rythme cardiaque et nous motiver pendant les abdos-fessiers. Seule, c’est moins facile d’être assidue. Bontempi.
Et c’est pas faute d’avoir proposé l'entraînement à 2,3 connaissances, mais il semblerait que plus personne, ici bas, n’ait envie de s’émoustiller le cortex. Ca remet à plus tard. Ca préfère l’entertainment à l'entraînement. Moi la première, hein. Mais, ça suffit cette hâte consacrée à ne rien-faire, et puis freiner des 4 fers, ensuite, quand il s’agit de se sortir ce qu’on sait de là où on pense.
Des exercices, dans ma vie, j’en ai pas fait beaucoup, j’ai même consacré le plus clair de ma scolarité à les éviter. Mais, y’en avait un qui avait trouvé grâce à mes yeux, et dont je m’étais même inspirée: tomber sur 3 mots dans le dictionnaire et, au mieux: en faire un sujet, au pire: les caser dans un texte sans grand rapport.
Une fois dans ma vie, j’y avais joué avec un ami, dans un bar. A cet exercice. J’me rappelle: c’était jadis. Il m’arrivait de me rendre en cours, et un de ces jours inhabituels, confite dans mot pot d’ennui, j’avais confié mon envie de jouer avec les mots à un collègue d’avant-dernier rang. Ca l’avait motivé et pas qu’un peu. On aurait dit que je lui avais proposé, je sais pas, un tour de l’argentine en moto et que j’avais à disposition ET la moto ET les billets d’avion ET des contacts là-bas, ET des très gros seins. On avait 18 ans, je précise. Si l’expression «sauter au plafond» devait prendre forme humaine, il en aurait été la pure incarnation. Il en aurait eu des bosses en haut de la tête.
-Oui, mais oui, quelle riche idée, c’est génial, GE-NIAL.
-Non mais, t’emballe pas, c’est un truc basique, genre ateliers d’écriture et écrivains à la petite semaine.
-Mais GENIAL. On n’est ni l’un ni l’autre, tu vois?
-Ben. Oui, je vois oui.
-Et qu’est ce qu’on est?
-...Chais pas. Des cancres?
Comme si elle avait été branchée sur mouchard, la prof de je sais plus quoi, -une sorte de matière hybride qui ne m’a jamais servie depuis- quelque chose comme «les maths» je crois, à moins que ce ne soit «les mathématiques»? Bref, nous l’appellerons la digne représentante du Ministère de l’Education Nationale, avait pas moult apprécié notre conversation sans grand rapport avec les examens. Elle avait pesté à notre égard et nous avait qualifiés, sinon traités, de «vauriens».
-... Bon, ben... Des vauriens alors, manifestement.
J’ai toujours éprouvé, depuis, un plaisir à chuchoter, même si je reste convaincue que les «S», les «CH» et les rires sous capes se remarquent davantage dès lors qu’on veut les étouffer.
-Tatata, on n’est pas des vauriens, et on va le prouver !
-A qui?
-A tout le monde, pardi!
-Genre tu dis «pardi».
Rire étouffé-bruyant / regard assassin de la prof inutile / avertissement qui frétille.
-Chut, ris pas. Si je dis «pardi» c’est parce qu’on est dans le délire «mot chelou à caser dans un texte».
Là, ça faisait beaucoup de «CH» et de «S». Comme il ne parlait qu’avec le souffle, sa voix intervenait accidentellement ça et là, son chuchotement devenait hilarant, d’une manière déraisonnablement perturbante. Et, pour un prof comme cette Jesaisplusqui, prendre le risque de perdre le peu d’élèves concentrés qu’elle avait à cause de 2 cancres slash vauriens irrécupérables qui ont, de surcroît, le culot de prétendre faire l’effort de ne déranger personne, c’était trop. Trop c’est trop, c’est le genre de phrases qu’elle pouvait se dire, "Trop c’est trop".
-Machine, machin, vous sortez. Bureau du proviseur. Vous lui expliquez la situation et vous revenez avec un mot de sa sanction.
-...
-...
On faisait moins les malins.
-Ca fait moins les malins, là hein.
Au moins un point sur lequel on était d’accord.
-C’est exactement ce que je me disais.
-Eh bien parfait: au moins un point sur lequel nous sommes d’accord.
-Ca aussi, je me le disais ! Ca nous fait deux points ! Dingue ! Si ça se trouve on va finir par devenir potes à force d’être toujours d’accord !
-Votre carnet de correspondance. Maintenant. Cette insolence va vous coûter cher.
-J’ai été insolente?
-Vous continuez?
-Je continue?
-Dehors!
Non mais. J’en revenais pas. Qu’est ce que quoi. J’avais à peu près rien fait, faut pas déconner, des élèves qui chuchotent, y’a que ça, mais des élèves qui disent à voix haute , devant les camarades, qu’ils pourraient presque s’entendre avec la prof pouilleuse du lycée... y’en a un peu moins. Merde quoi. J’ai pas dit «merde quoi» à voix haute, mais, c’était tout comme.
«Comment elle me juge trop pas à ma juste valeur, putain.» que je disais, sans chuchoter, à mon acolyte.
-Vous dîtes?
-Je dis que : vous ne me jugez pas à ma juste valeur. C’est ça que je dis. Putain aussi. Merde quoi, d’ailleurs.
-Sortez.
-Vous savez que j’ai dit, y’a de ça 3, peut-être 4 minutes, -je sais pas, c’est vous l’adulte qui surveillez tout- que si ça se trouve «on pourrait même devenir potes» ?
-Je le sais, raison pour laquelle vous allez immédiatement me donner votre carnet de correspondance et sortir de cette pièce.
-Vous savez qu’en disant ça, j’ai pris un risque.
-L’exclusion, en effet.
-Vous ne croyez pas si bien dire: déclarer à un bouffon qu’on a peut-être des atomes crochus, c’est le risque de ne plus avoir d’amis. Je vous ai dit, à vous, qui êtes l’incarnation même de la prof bouffonne, que si ça se trouve, on pourrait être amies. A ce moment même, les petits péteux que vous voyez aux 4° et 5° rangs parce qu’ils n’ont ni les couilles d’être premiers de la classe ni le culot de faire la connerie que je fais en ce moment... ces péteux là, ils se sont dit «han, la honte» en m’entendant. Et, je le savais, en vous le disant. Qu’ils diraient de moi Han-La-Honte. Ce qui, je suis désolée de vous l’apprendre, est dramatique, à mon âge.
-Sortez ou j’appelle le conseiller qui s’en chargera lui-même.
-Comment vous comprenez trop rien à rien, ca m’fait pitié. Si vous êtes un si mauvais prof, je devrais avoir le droit d’être un mauvais élève aussi. Y’a pas de raison.
Acolyte, qui me surprenait toujours pas sa fraîcheur et sa spontanéité, avait objecté:
-Si, quand même, on peut pas dire: elle touche sa bille en maths.
Ok, on était donc en cours de maths.
Je jugeais opportun de ranger mes livres d'histoire tiret géo avant de dire le reste des tréfonds de ma pensée.
-Ok, vous y comprenez quelque chose en maths, super, mais si vous comprenez rien à ceux à qui vous devez les expliquer... Ce serait-i-pas ce qu’on appelle «un putain de prof raté»?
-Comment osez-vous?
Elle devenait rouge, principalement sur le cou. Je suis pas experte, mais je suis sûre que c’était pas un signe de bonheur.
-Et vous? Comment osez-vous faire de moi une potentielle allergique à tout ce qui est angles droits, sinus, et.... bon, tout le reste là. C’est pas pro. C’est pas pro. Je le dis deux fois même. Moi je suis pas payée pour la sanction que je vais avoir. Et vous, vous êtes payée pour celle que vous n’aurez pas.
Elle n’avait pas eu besoin de rajouter quoique ce soit. J’allais pour sortir, ok, j’y allais, c’est bon, oui ok. Acolyte, derrière, avait la tête de celui qui est fier tout en s’excusant. Ca fait une mimique bizarre, autant vous le dire, distordue. Comme si son côté droit se battait avec son côté gauche, comme si ces deux côtés étaient ravis de se battre, comme si c’était bizarre quoi, comme je disais.
Je le savais, la tête qu’il avait, je l’avais attendu à la porte, le temps qu’il arrive, au moins pour la claquer derrière lui. J’étais sûre qu’il n’y penserait même pas.
Enfin, bon. Beaucoup d’émotions quoi. On partait dans les couloirs, sans bousculades, pour une fois, sans rien du tout d’ailleurs, on avait même pris le temps de constater la qualité du plancher et aussi l’odeur près de la cantine, et des toilettes, dont on savait déjà qu’elle nous manquerait plus tard. C’est pas sexy, mais c’est comme ça. Elle nous manquerait, un jour, sans qu’on arrive même à la définir. On était ok sur ce genre d’émotions, sans se le dire, c’est vous dire combien on était connectés niveau amitié, Acolyte et moi.
Absolument convaincue que l’injustice régnait sur le monde comme Lafontaine sur les fables, je partais avec Acolyte, sachant, sans avoir à le lui demander, qu’il comptait lui aussi éviter la case «bureau du proviseur» pour se rendre directement à l’étape «pmu d’en face».
J’espérais simplement que le jeu qui nous attendait n'allait pas nous faire pas tomber sur le mot «école» ou «justice» ou «adulte». Ah oui et «jeune adolescente inculte» aussi.
Mais, en grande intellectuelle que j’étais, je me faisais remarquer à moi-même que ça n'existait pas «jeune adolescente inculte» dans le dictionnaire.
Et je commençais à le regretter, rapport au fait que, du coup, personne ne nous comprendrait jamais et qu’on serait amenés à vivre toujours incompris, nous, les jeunes adolescents incultes. C’était sur, je me disais, les adultes et nous, on avait de longues années de guerre à l’horizon. Au moins, ça nous faisait un horizon. J’me disais tout ça.
Quand, pile poil, Acolyte me lança son coude dans les côtes. A 99% persuadée qu’il n’était pas mal intentionné, je grimaçais, soit, mais sans l’insulter.
-ON A PAS D’OUTIL DE TRAVAIL !
Il avait crié de tous ses poumons.
Je me souvenais d’un vague pétard, fumé 2 heures plus tôt mais je le pensais pas si tapette sur le shit. Me concernant, tout ça était de l’histoire ancienne, peut-être restait-il des preuves de mon attitude de délinquante droguée asociale dans mon sang, mais dans mon exaltation, que nenni. J’en aurais d’ailleurs bien fumé un nouveau.
-Mec, t’es encore fraca? T’as refumé? Sans moi?
-ON A PAS DE DI-CTI-ONNAI-RE !
Merde. On avait pas de dictionnaire.
Au PMU habituel, on a essayé de dégoter deux ou trois magazines, assez de texte, de signes, d’imprimés, de polices Arial ou whatever, pour pointer l’index au pif et choisir les 3 mots tant espérés. Tout ce qu’on avait trouvé, c’était des grilles de paris de courses; et encore, même pas vierges, mais jetées sur le sol, inutiles, perdantes.
Or «mise», «tiercé» et «cochez» réduisaient l’inspiration de beaucoup. Je crois même qu’un de nous deux avait dit que «c’était pas notre dada». Blague générationnelle quoi. Dont personne ne peut vraiment être fier. Raison pour laquelle je préférerais mourir plutôt que d’avouer que c’était de moi. Bon. André, notre André chéri, ne savait plus comment rendre nos cafés plus gratuits que d’habitude, tout désolé qu’il était de ne pas être utile.
On avait 4 cafés, 4 grilles de PMU, et pas mal de rien d’autre. On se sentait comme des manchots à une partie de poker.
-C’est là que je pourrais dire de toi que t’es mon compagnon d’infortune. Tu trouves pas?
Il trouvait pas trop-trop, apparemment.
Alors j’avais fait comme d’hab’, comme ce qu’on faisait toujours, j’avais commencé à faire le tour de ma main sur le set de table avec un stylo bille. Le tour de ma main gauche, avec ma main droite. Un bic noir. Je le précise parce que, d’une: ma main droite est celle dont j’ai déjà dit que je ne pourrai jamais me passer et que, que vous le vouliez ou non, je viens encore de le prouver d’une façon qui n’accepte pas de contradicteur: elle faisait le tour de ma main gauche, ok? Faut pas déconner. On se passe pas de ce genre d’outil de nos jours. De deux, parce que, je suis une fille, et, même si ça me désole de répondre aux critères des magazines, il s’avère que, oui, de temps à autres, je dis ouvertement qu’il y a des choses que je n’aime pas chez moi. Pas pour m’entendre dire que j’ai tort, non, là, je serais vraiment ce que j’appelle une sous-femme. Moi, c’était sans raison, finalement. Ce qui est encore plus stupide que ce qui amène les sous-femmes à s’exprimer. Là, j’allais dire que je n’aimais pas le contour, la silhouette, l’allure de ma main gauche. J’allais dire que je la trouvais mal roulée. Je dis ça parce que, ce qui est intéressant, c’est que, ma main gauche, c’est précisément celle que j’utilise le moins. Enfin, je l’utilise pour le piano, ok, pour l’écriture, et encore, pour la danse, quoi que. Pas pour la masturbation, ça c’est sur. Ni pour la cuisine, ou, je sais pas... le maquillage. Par exemple, pendant que je me maquille, pendant que je cuisine, pendant que... mettons, je sais pas, je lave les vitres... Ok, donc : pendant que je suis une putain de femme au foyer des années 50 aux Etats unis, et bien, pendant tout ce temps là, c’est ma main droite qui bosse. Ouais, ma main droite, c’est un peu l’homme de la maison. Ma main gauche, pendant ce temps, il semblerait qu’elle trouve passionnant de traîner le long de mon corps, ou de s’appuyer ça et là. Sans que ça n’ait vraiment d'intérêt ces «ça» et «là». Ni que ça serve à quoi que ce soit de «s’appuyer». M’enfin, les femmes, vous savez... On comprend jamais trop.
Donc, bon, tout ça pour dire que ma main gauche était la plus fine des deux puisque la moins utilisée. Les phalanges étaient plutôt esthétiques, la courbe des muscles: discrète, mais présente. Les ongles, vernis: et pas trop écaillés. Mais quand bien même, là, à 9h45, alors qu’on jouait soit disant notre avenir, qu’on avait bu trop de café, qu’on avait plus de pétard, qu’on avait pas de dictionnaire et que tout ça, je disais à Acolyte que je trouvais que j’étais grosse. Que je trouvais que Beurk.
-Beurk, comment chuis grosse! Haaan! T’as vu?
-Quoi?
-Regarde cette main!
Je tendais le set de table imprimé de l’erreur que dieu-maman-génétique avaient faite.
-Quel rapport avec le cul? avait-il dit en repoussant le set.
-Quoi? Le cul? Quel rapport en effet, je te le demande.
-Regarde.
Il avait sorti une photo de sa p.e.t.i.t.e.c.o.p.i.n.e. de son p.o.r.t.e.f.e.u.i.l.l.e.
Malgré le fait que je voulais en savoir plus sur ma grosseur des mains et son histoire de cul, je ne pouvais m’empêcher de pouffer rapport à la photo dans le larfeuille, merde, quoi, ho.
-Tu t’es cru aux States?
-Quoi?
-Mec! T’as la photo de ta meuf dans ton portefeuille! Allô?
Là, je le regardais fort fort fort avec mes yeux grands grands grands ouverts ouverts verts.
-Non mais, c’est pour te montrer, ce qui est gros, ce qui ne l’est pas, tout ça. ... Me Mets pas mal à l’aise comme ça.
Et voilà qu’il rangeait la photo dans son portefeuille. Again.
-Je disais donc: TU T’ES CRU AUX STATES?
-ELLE s’y est crue, oui.
Bon alors je prenais le portefeuille, sortais la photo, avec ma main droite, hein, celle qui fait tout bien et qu’est pas si moche et je regardais, mais pour le coup, de mes 2 yeux, la donzelle.
«Sexy lady» j’aurais du dire. J’entends: si j’avais été une bonne amie, avec une anatomie normale et deux mains équilibrées. Au lieu de quoi j’ai dit «Wahou, mais...»
Il faut savoir que ces trois points de suspensions ont duré bien plus de temps qu’il n’en faut pour les lire. Pour preuve, pour lire trois points de suspension, il faut quelque chose comme, je sais pas, je vais pas faire appel à un spécialiste mais.
Il y’a des spécialistes pour ça? Disons un centième de seconde. Mes 3 points de suspension du dessus avaient duré comme les 3 minutes qu'il avait mises à oser me montrer la photo. Ce que je réalisais trop tard. Je réalisais ça ET le fait que la vie soit pas cool. Parce que si j’avais réalisé avant qu’il avait mis autant de temps à me montrer la photo, j’aurais sûrement même pas parlé de mes mains, j’veux dire, ou alors, quand il m’aurait montré la photo, j’aurais senti tout ce que ça impliquait pour lui et j’aurais tenté un saut au plafond comme il savait si bien le faire, pour lui montrer, que, wahou, la vue de sa donzelle me remplissait de joie, que, mec, avec une plante pareille sur la terre, l’humanité n’avait plus aucun souci à se faire, j’aurais même peut-être dit, en mentant sûrement, mais pour lui faire plaisir, que je comprenais, maintenant, pourquoi il la gardait dans son protefeuille comme un américain.
Acolyte, là, me sort de ma tête:
-Wahou, mais quoi?
-Ben, wahou, mais, mec, vous devez être nombreux pour vous occuper de son cas, hein, non?
Ah, là, tout de suite, en le disant, pile poil, à peine j’avais terminé ma phrase que je savais. Comme on dit en maths: hésitation+sarcasme=pas bien.
-T’es assez nulle quand tu veux être une amie, tu sais. Elle a un gros cul ok, mais je montrais ça pour t'expliquer que ta main était parfaite, qu'elle allait avec le reste et que même si tu te trouvais grosse, -ce qui est insultant pour pas mal de jeunes qui vivent dans des pays en voie de développement- y'aurait toujours quelqu'un pour trouver ça beau, et je te le prouvais en te montrant que j'aimais une fille aux formes gargantuesques.
Et voilà qu'il rangeait à nouveau la photo dans le portefeuille.
-Non mais, attends, ce que je veux dire c’est que...
Bon, là, Acolyte avait utilisé sa main gauche pour la mettre sur ma main droite Peut-etre parce qu’il voulait que ma main droite à moi ne fasse rien et que la sienne puisse faire ça:
-Je me suis pas cru aux States, Baby. (Acolyte est drôle); j’ai aussi une photo de toi dans mon portefeuille.
Ma main tremblait un peu sous la sienne. Tout ça parce que j’ai une tendance à me laisser envahir par l’émotion, ce qui est très mal pour quelqu’un qui ne croit en rien, je sais, je bosse dessus.
Il sortait la photo.
-Quoi? Mais d’où t’as cette photo! Rends la moi.
Il la tenait à distance, comme dans les films, quand y’a justement un mec qui a une photo qu’une fille ne veut pas qu’il aie et que la fille veut la récupérer et que la nauture a fait les choses de telle sorte que les mecs sont assez grands pour tenir les photos qu’on veut récupérer sous notre nez mais hors de portée. Grand = 1m82, pour info.
-Arrête ça tout de suite.
-Ca fait moins la malineuh.
-Ca parle comme une prof de matheuuuuu.
-Ca te rendra pas ta photo-heu.
-Super. André?
André arrive toujours comme s’il attendait, là, juste derrière, qu’on l’appelle. A peine on a fini de prononcer le «dré» d’André que le mec dit:
-Oui mon abricot?
André donne des noms de fruits aux clients qu’il aime bien.
-(Soupir)
-Qu’est ce que tu veux mon abricot, un jus de fruit?
-Bwarf, on n’a pas d’argent, on est des nuls, c’est nul, chuis désolée.
André avait compris ce que je voulais vraiment de lui et il avait attrapé la photo qu’Acolyte tenait encore derrière son dos, me l’avait donnée et m’avait dit:
-4 café ou 6, un jus de fruit ou 2, tu sais... Abricot... Ca changera pas la face du monde.
André était généreux.
En prenant la photo, je le regardai, fier de son petit tour de passe-passe et lui demandai:
-Parce qu’il y a quelque chose qui changera la face du monde, tu crois, un jour?
-A part toi, non, rien, ça c’est sûr.
Et il était reparti près du percolateur.
Pfioulala, André était généreux, à tendance «petits noms» et papa en herbe de surcroît.
Ca faisait beaucoup pour un seul homme, et ça me faisait beaucoup d’effet à moi, la moitié d'une femme.
Acolyte, qui sentait mon enthousiasme baisser à vue d’oeil, avait décidé d’outre passer les règles, d’inventer notre propre loi: il déciderait des mots, j’écrirai. Soit. Pourquoi pas. Allons-y.
Entre-temps, on avait fumé le pétard dont j’avais eu envie plus haut et, alors, j’étais à peu près cap de tout faire. Ou alors non, j’étais à peu près cap d’en n’avoir rien à foutre de rien. Un truc dans ce genre là, quoi.
-Mais tu me fais pas le coup de mots comme «pardi» hein.
-Ben, je fais tous les coups que je veux.
-Non mais «pardi», «sapristi», «mazette» et «damoiseau», ça va nous faire un conte de château, c’est chiant.
-Bon, Albuquerque.
-Non, alors, je t’arrête tout de suite, excuse moi, mais puisqu’on va se la jouer vocabulaire, autant te le dire tout de suite, on dit «abdique» dans la vie et pas ... «albriqueque» ou je sais trop ce que tu viens de prononcer.
-Al-bu-quer-que.
-Ah. Ok. Ben. Heu. C’est pas un mot.
-Tatata, mot, nom propre, adjectif, peu importe. Albuquerque, j'te dis!
Je notais «Albuquerque», me voyant déjà faire circuler un personnage sombre et solitaire à la frontière de l’Uruguay et...
-C’est bien en Uruguay, Albuquerque, hein?
-Tu sais quel cours va commencer, là?
-Elle dit qu’elle voit pas le rapport avec sa question.
-Le cours d’Histoire géo.
Pffff, il avait oublié de dire «tiret» entre Histoire et Géo, l’inculte.
-Ok, et?
-Et, puisque tu ne vas pas y aller, tu ne sauras jamais où se trouve Albuquerque.
-Non mais attends... je sais très bien où est Albuquerque, c’est pas en Uruguay, je disais ça comme ça, c’est, ... t’sais, pas loin de...
-"Polissonne".
-Si tu veux m'entendre dire que Polissonne est un pays, un de ceux qui auraient une frontière commune avec le Nouveau Mexique et le désert de Chihuahua, tu oublies que le pétard me redonne la mémoire ET l’envie de te taquiner, raison pour laquelle, pendant que tu réalises que, oui, Albuquerque est bien au Nouveau Mexique à côté, tout près du désert de Chihuahua, et que tu te demandes comment ça m’est revenu, et bien, pendant tout ce temps, je vais me contenter de te chatouiller là où je sais que c’est tellement insupportable pour toi que tu peux te pisser dessus. Mais je vois que tu es encore en train de comprendre ma phrase quand tu devrais déjà t’enfuir, donc, d’une: le pétard ne fait pas le même effet à tout le monde, de deux: donne moi ta côte.
Le con avait soulevé son tshirt. Comme un gros con. Le con. J’te jure. Les garçons, parfois, ça me fait pitié.
-Ca te dérange pas si je te traite d’attardé pendant que je te chatouille, hein?
Pendant qu’Acolyte se tordait et rampait et enfin reprenait son souffle je disais:
-Polissonne, donc? je vous vraiment pas ce que ça veut pouvoir dire.
Je la fermais et notais «polissonne». En voyant Albuquerque et Polissonne côte à côte, j'ai eu l’impression qu’il choisissait ses mots d’après un critère phonétique, l’idée n’était pas pour me déplaire.
-"Ammoniaque", "Mangrove".
Qu’est ce que quelqu’un irait faire au Nouveau Mexique pour sniffer de l’ammoniaque et sauver la mangrove? Tomber amoureux d’une polissonne? Ca s’annonçait pas super-super cohérent tout ça.
-"Farandole».
-Bon, ça fait pas 3 mais 5 là. On arrête.
A vrai dire, Farandole me sauvait. Tout ce monde là allait bien s’entendre, c’était outre-décidé.
J’ai fait mon exercice dès que j'ai pu en me disant que, voilà, il suffisait de concerner un élève pour le voir se passionner et obéir, que c'était tout de même pas sorcier, nom de nom. J'avais même cherché d'autres mots qui sonnaient joliment. J'étais dedans, en somme. Le lendemain, il était sur son bureau. Un bureau qui ressemblait étrangement à un top case de scooter. La semaine d'après, je l'avais adressé à mon proviseur et ma prof de cette matière hybride dont j'ai déjà oublié le nom, pour les remercier de m'avoir donné 3 jours pour m'amuser. Ma prof de Français était dans le coup, bien sûr, les profs de Français ont toujours été dans mes coups. L'exercice, il vaut ce qu’il vaut, il a, quoiqu’on en dise, le mérite d’exister.
Il est là, d'ailleurs:
http://beaucoupbeaucoup.blogspot.com/2008/03/en-pmoison.html
L'énergie que ça m'avait donné, ce petit jeu à la noix, l'envie d'être à la hauteur du challenge et le plaisir de jouer avec des consonances et des sens que ça m'avait procuré, c'est autant de raisons pour que je m'y colle à nouveau. Ben, oui, les exercices dont je parlais. Et aujourd'hui, grande bourgeoise que je suis, j’ai un dictionnaire, que je peux feuilleter, et qui décidera donc que les mots clés seront:
(inquiète mais impatiente, je prends un dictionnaire, je pointe, et j’arrive)
Supsense et roulements de tambour, merci de votre intervention, je n'ai plus besoin de vous pour rendre le verdict.
-"Egérie"
-"Coupable"
et
-"Liaison"
seront les héros de ma composition.
Et que ça saute.
-maispastrop-
je me replonge donc logiquement dans l’ambiance estudiantine. Agenda, devoirs et mercredi après-midi aérés seront, cet été encore, mes meilleurs ennemis.
Non pas que je veuille faire absolument mon originale à l’encontre de la norme et des calendriers communément adoptés, mais j’ai toujours été archi d’accord avec Michmich’: «Qu’il est doux de ne rien faire quand tout s’agite autour de nous», ah ça oui; et, dans le même ordre d’idée, j’ajoute: Quand plus personne n’en fout une, j’ai comme envie de me secouer les puces.
Voilà, j’ai des devoirs qui m’attendent.
Au delà de l'incommensurable effort que ça va me demander niveau paperasse et relations familiales -pour ne citer que les taches les plus sexy- il va me falloir user de subterfuges, aussi, pour me coller à mes exercices.
Des exercices donc, non pas de gymnastique, quelle idée! mais d’écriture.
Ah, vous pouvez rire autant qu’il vous plaira. Il me plaira aussi que vous riiez, j’aime ça, que les gens se la fendent. N’empêche, y’a pas à chipoter, les exercices, ça fait son homme. Quand je faisais du piano, je la voyais, la différence, après 2h30 passées à refaire une trille infernale qui tirait sur les ligaments de la main. Et je vous raconte pas pour la danse. Pointes, pointes, un coupé pour soit disant respirer, et pointes encore, et toujours, pointes-pointes-pointes. Tant qu’on n'a pas saigné des pieds, tant qu’on n’a pas le poignet en steak tartare, tant qu’on ne connaît pas toutes les conjonctions de coordination...on n’y est pas, on n’y sera jamais.
Des exercices, disais-je. Pour m’aventurer dans ces couloirs de ma tête où j’ai la flemme de me rendre spontanément; pour m’y égarer, si le plan fonctionne; pour, surtout, sauver des muscles à la limite de l’atrophie. -Déjà qu’un muscle qui se nécrose c’est pas beau à voir, imaginez donc ça, dans le décor du cerveau, qui en soi n’est pas de nature à émoustiller les sens: c’est la cata.- Trouver un second souffle, enfin. Et repartir de plus belle, courbatue mais vaillante.
Y’a pas que les chevaliers qui font des exploits, attends. Et, je mets ma main à couper que nombre d’explorateurs connaissaient mieux certaines îles que leur propre lobe temporal.
Si je mets «ma main à couper» là, c’est notamment parce que les explorateurs dignes de ce nom sont morts, aujourd’hui, et qu’ils ne pourront donc pas me contredire. Et que je n’ai aucune envie de me passer de ma main. Ma main me sera utile. Pour la danse, pour le piano, pour l’écriture, pour la masturbation. De moi, des autres. J’y tiens. Un peu comme à la prunelle de mes yeux. Elle a d’ailleurs servi à l’instant même à expliquer combien elle me servirait encore.
Je le ferai seule, cet exercice, il paraît.
Alors que, d’habitude, on s’appelle entre copinous pour les rédactions, on se retrouve au café pour les exposés et on fait appel à des coachs, à ce qu’il paraît, pour surveiller notre rythme cardiaque et nous motiver pendant les abdos-fessiers. Seule, c’est moins facile d’être assidue. Bontempi.
Et c’est pas faute d’avoir proposé l'entraînement à 2,3 connaissances, mais il semblerait que plus personne, ici bas, n’ait envie de s’émoustiller le cortex. Ca remet à plus tard. Ca préfère l’entertainment à l'entraînement. Moi la première, hein. Mais, ça suffit cette hâte consacrée à ne rien-faire, et puis freiner des 4 fers, ensuite, quand il s’agit de se sortir ce qu’on sait de là où on pense.
Des exercices, dans ma vie, j’en ai pas fait beaucoup, j’ai même consacré le plus clair de ma scolarité à les éviter. Mais, y’en avait un qui avait trouvé grâce à mes yeux, et dont je m’étais même inspirée: tomber sur 3 mots dans le dictionnaire et, au mieux: en faire un sujet, au pire: les caser dans un texte sans grand rapport.
Une fois dans ma vie, j’y avais joué avec un ami, dans un bar. A cet exercice. J’me rappelle: c’était jadis. Il m’arrivait de me rendre en cours, et un de ces jours inhabituels, confite dans mot pot d’ennui, j’avais confié mon envie de jouer avec les mots à un collègue d’avant-dernier rang. Ca l’avait motivé et pas qu’un peu. On aurait dit que je lui avais proposé, je sais pas, un tour de l’argentine en moto et que j’avais à disposition ET la moto ET les billets d’avion ET des contacts là-bas, ET des très gros seins. On avait 18 ans, je précise. Si l’expression «sauter au plafond» devait prendre forme humaine, il en aurait été la pure incarnation. Il en aurait eu des bosses en haut de la tête.
-Oui, mais oui, quelle riche idée, c’est génial, GE-NIAL.
-Non mais, t’emballe pas, c’est un truc basique, genre ateliers d’écriture et écrivains à la petite semaine.
-Mais GENIAL. On n’est ni l’un ni l’autre, tu vois?
-Ben. Oui, je vois oui.
-Et qu’est ce qu’on est?
-...Chais pas. Des cancres?
Comme si elle avait été branchée sur mouchard, la prof de je sais plus quoi, -une sorte de matière hybride qui ne m’a jamais servie depuis- quelque chose comme «les maths» je crois, à moins que ce ne soit «les mathématiques»? Bref, nous l’appellerons la digne représentante du Ministère de l’Education Nationale, avait pas moult apprécié notre conversation sans grand rapport avec les examens. Elle avait pesté à notre égard et nous avait qualifiés, sinon traités, de «vauriens».
-... Bon, ben... Des vauriens alors, manifestement.
J’ai toujours éprouvé, depuis, un plaisir à chuchoter, même si je reste convaincue que les «S», les «CH» et les rires sous capes se remarquent davantage dès lors qu’on veut les étouffer.
-Tatata, on n’est pas des vauriens, et on va le prouver !
-A qui?
-A tout le monde, pardi!
-Genre tu dis «pardi».
Rire étouffé-bruyant / regard assassin de la prof inutile / avertissement qui frétille.
-Chut, ris pas. Si je dis «pardi» c’est parce qu’on est dans le délire «mot chelou à caser dans un texte».
Là, ça faisait beaucoup de «CH» et de «S». Comme il ne parlait qu’avec le souffle, sa voix intervenait accidentellement ça et là, son chuchotement devenait hilarant, d’une manière déraisonnablement perturbante. Et, pour un prof comme cette Jesaisplusqui, prendre le risque de perdre le peu d’élèves concentrés qu’elle avait à cause de 2 cancres slash vauriens irrécupérables qui ont, de surcroît, le culot de prétendre faire l’effort de ne déranger personne, c’était trop. Trop c’est trop, c’est le genre de phrases qu’elle pouvait se dire, "Trop c’est trop".
-Machine, machin, vous sortez. Bureau du proviseur. Vous lui expliquez la situation et vous revenez avec un mot de sa sanction.
-...
-...
On faisait moins les malins.
-Ca fait moins les malins, là hein.
Au moins un point sur lequel on était d’accord.
-C’est exactement ce que je me disais.
-Eh bien parfait: au moins un point sur lequel nous sommes d’accord.
-Ca aussi, je me le disais ! Ca nous fait deux points ! Dingue ! Si ça se trouve on va finir par devenir potes à force d’être toujours d’accord !
-Votre carnet de correspondance. Maintenant. Cette insolence va vous coûter cher.
-J’ai été insolente?
-Vous continuez?
-Je continue?
-Dehors!
Non mais. J’en revenais pas. Qu’est ce que quoi. J’avais à peu près rien fait, faut pas déconner, des élèves qui chuchotent, y’a que ça, mais des élèves qui disent à voix haute , devant les camarades, qu’ils pourraient presque s’entendre avec la prof pouilleuse du lycée... y’en a un peu moins. Merde quoi. J’ai pas dit «merde quoi» à voix haute, mais, c’était tout comme.
«Comment elle me juge trop pas à ma juste valeur, putain.» que je disais, sans chuchoter, à mon acolyte.
-Vous dîtes?
-Je dis que : vous ne me jugez pas à ma juste valeur. C’est ça que je dis. Putain aussi. Merde quoi, d’ailleurs.
-Sortez.
-Vous savez que j’ai dit, y’a de ça 3, peut-être 4 minutes, -je sais pas, c’est vous l’adulte qui surveillez tout- que si ça se trouve «on pourrait même devenir potes» ?
-Je le sais, raison pour laquelle vous allez immédiatement me donner votre carnet de correspondance et sortir de cette pièce.
-Vous savez qu’en disant ça, j’ai pris un risque.
-L’exclusion, en effet.
-Vous ne croyez pas si bien dire: déclarer à un bouffon qu’on a peut-être des atomes crochus, c’est le risque de ne plus avoir d’amis. Je vous ai dit, à vous, qui êtes l’incarnation même de la prof bouffonne, que si ça se trouve, on pourrait être amies. A ce moment même, les petits péteux que vous voyez aux 4° et 5° rangs parce qu’ils n’ont ni les couilles d’être premiers de la classe ni le culot de faire la connerie que je fais en ce moment... ces péteux là, ils se sont dit «han, la honte» en m’entendant. Et, je le savais, en vous le disant. Qu’ils diraient de moi Han-La-Honte. Ce qui, je suis désolée de vous l’apprendre, est dramatique, à mon âge.
-Sortez ou j’appelle le conseiller qui s’en chargera lui-même.
-Comment vous comprenez trop rien à rien, ca m’fait pitié. Si vous êtes un si mauvais prof, je devrais avoir le droit d’être un mauvais élève aussi. Y’a pas de raison.
Acolyte, qui me surprenait toujours pas sa fraîcheur et sa spontanéité, avait objecté:
-Si, quand même, on peut pas dire: elle touche sa bille en maths.
Ok, on était donc en cours de maths.
Je jugeais opportun de ranger mes livres d'histoire tiret géo avant de dire le reste des tréfonds de ma pensée.
-Ok, vous y comprenez quelque chose en maths, super, mais si vous comprenez rien à ceux à qui vous devez les expliquer... Ce serait-i-pas ce qu’on appelle «un putain de prof raté»?
-Comment osez-vous?
Elle devenait rouge, principalement sur le cou. Je suis pas experte, mais je suis sûre que c’était pas un signe de bonheur.
-Et vous? Comment osez-vous faire de moi une potentielle allergique à tout ce qui est angles droits, sinus, et.... bon, tout le reste là. C’est pas pro. C’est pas pro. Je le dis deux fois même. Moi je suis pas payée pour la sanction que je vais avoir. Et vous, vous êtes payée pour celle que vous n’aurez pas.
Elle n’avait pas eu besoin de rajouter quoique ce soit. J’allais pour sortir, ok, j’y allais, c’est bon, oui ok. Acolyte, derrière, avait la tête de celui qui est fier tout en s’excusant. Ca fait une mimique bizarre, autant vous le dire, distordue. Comme si son côté droit se battait avec son côté gauche, comme si ces deux côtés étaient ravis de se battre, comme si c’était bizarre quoi, comme je disais.
Je le savais, la tête qu’il avait, je l’avais attendu à la porte, le temps qu’il arrive, au moins pour la claquer derrière lui. J’étais sûre qu’il n’y penserait même pas.
Enfin, bon. Beaucoup d’émotions quoi. On partait dans les couloirs, sans bousculades, pour une fois, sans rien du tout d’ailleurs, on avait même pris le temps de constater la qualité du plancher et aussi l’odeur près de la cantine, et des toilettes, dont on savait déjà qu’elle nous manquerait plus tard. C’est pas sexy, mais c’est comme ça. Elle nous manquerait, un jour, sans qu’on arrive même à la définir. On était ok sur ce genre d’émotions, sans se le dire, c’est vous dire combien on était connectés niveau amitié, Acolyte et moi.
Absolument convaincue que l’injustice régnait sur le monde comme Lafontaine sur les fables, je partais avec Acolyte, sachant, sans avoir à le lui demander, qu’il comptait lui aussi éviter la case «bureau du proviseur» pour se rendre directement à l’étape «pmu d’en face».
J’espérais simplement que le jeu qui nous attendait n'allait pas nous faire pas tomber sur le mot «école» ou «justice» ou «adulte». Ah oui et «jeune adolescente inculte» aussi.
Mais, en grande intellectuelle que j’étais, je me faisais remarquer à moi-même que ça n'existait pas «jeune adolescente inculte» dans le dictionnaire.
Et je commençais à le regretter, rapport au fait que, du coup, personne ne nous comprendrait jamais et qu’on serait amenés à vivre toujours incompris, nous, les jeunes adolescents incultes. C’était sur, je me disais, les adultes et nous, on avait de longues années de guerre à l’horizon. Au moins, ça nous faisait un horizon. J’me disais tout ça.
Quand, pile poil, Acolyte me lança son coude dans les côtes. A 99% persuadée qu’il n’était pas mal intentionné, je grimaçais, soit, mais sans l’insulter.
-ON A PAS D’OUTIL DE TRAVAIL !
Il avait crié de tous ses poumons.
Je me souvenais d’un vague pétard, fumé 2 heures plus tôt mais je le pensais pas si tapette sur le shit. Me concernant, tout ça était de l’histoire ancienne, peut-être restait-il des preuves de mon attitude de délinquante droguée asociale dans mon sang, mais dans mon exaltation, que nenni. J’en aurais d’ailleurs bien fumé un nouveau.
-Mec, t’es encore fraca? T’as refumé? Sans moi?
-ON A PAS DE DI-CTI-ONNAI-RE !
Merde. On avait pas de dictionnaire.
Au PMU habituel, on a essayé de dégoter deux ou trois magazines, assez de texte, de signes, d’imprimés, de polices Arial ou whatever, pour pointer l’index au pif et choisir les 3 mots tant espérés. Tout ce qu’on avait trouvé, c’était des grilles de paris de courses; et encore, même pas vierges, mais jetées sur le sol, inutiles, perdantes.
Or «mise», «tiercé» et «cochez» réduisaient l’inspiration de beaucoup. Je crois même qu’un de nous deux avait dit que «c’était pas notre dada». Blague générationnelle quoi. Dont personne ne peut vraiment être fier. Raison pour laquelle je préférerais mourir plutôt que d’avouer que c’était de moi. Bon. André, notre André chéri, ne savait plus comment rendre nos cafés plus gratuits que d’habitude, tout désolé qu’il était de ne pas être utile.
On avait 4 cafés, 4 grilles de PMU, et pas mal de rien d’autre. On se sentait comme des manchots à une partie de poker.
-C’est là que je pourrais dire de toi que t’es mon compagnon d’infortune. Tu trouves pas?
Il trouvait pas trop-trop, apparemment.
Alors j’avais fait comme d’hab’, comme ce qu’on faisait toujours, j’avais commencé à faire le tour de ma main sur le set de table avec un stylo bille. Le tour de ma main gauche, avec ma main droite. Un bic noir. Je le précise parce que, d’une: ma main droite est celle dont j’ai déjà dit que je ne pourrai jamais me passer et que, que vous le vouliez ou non, je viens encore de le prouver d’une façon qui n’accepte pas de contradicteur: elle faisait le tour de ma main gauche, ok? Faut pas déconner. On se passe pas de ce genre d’outil de nos jours. De deux, parce que, je suis une fille, et, même si ça me désole de répondre aux critères des magazines, il s’avère que, oui, de temps à autres, je dis ouvertement qu’il y a des choses que je n’aime pas chez moi. Pas pour m’entendre dire que j’ai tort, non, là, je serais vraiment ce que j’appelle une sous-femme. Moi, c’était sans raison, finalement. Ce qui est encore plus stupide que ce qui amène les sous-femmes à s’exprimer. Là, j’allais dire que je n’aimais pas le contour, la silhouette, l’allure de ma main gauche. J’allais dire que je la trouvais mal roulée. Je dis ça parce que, ce qui est intéressant, c’est que, ma main gauche, c’est précisément celle que j’utilise le moins. Enfin, je l’utilise pour le piano, ok, pour l’écriture, et encore, pour la danse, quoi que. Pas pour la masturbation, ça c’est sur. Ni pour la cuisine, ou, je sais pas... le maquillage. Par exemple, pendant que je me maquille, pendant que je cuisine, pendant que... mettons, je sais pas, je lave les vitres... Ok, donc : pendant que je suis une putain de femme au foyer des années 50 aux Etats unis, et bien, pendant tout ce temps là, c’est ma main droite qui bosse. Ouais, ma main droite, c’est un peu l’homme de la maison. Ma main gauche, pendant ce temps, il semblerait qu’elle trouve passionnant de traîner le long de mon corps, ou de s’appuyer ça et là. Sans que ça n’ait vraiment d'intérêt ces «ça» et «là». Ni que ça serve à quoi que ce soit de «s’appuyer». M’enfin, les femmes, vous savez... On comprend jamais trop.
Donc, bon, tout ça pour dire que ma main gauche était la plus fine des deux puisque la moins utilisée. Les phalanges étaient plutôt esthétiques, la courbe des muscles: discrète, mais présente. Les ongles, vernis: et pas trop écaillés. Mais quand bien même, là, à 9h45, alors qu’on jouait soit disant notre avenir, qu’on avait bu trop de café, qu’on avait plus de pétard, qu’on avait pas de dictionnaire et que tout ça, je disais à Acolyte que je trouvais que j’étais grosse. Que je trouvais que Beurk.
-Beurk, comment chuis grosse! Haaan! T’as vu?
-Quoi?
-Regarde cette main!
Je tendais le set de table imprimé de l’erreur que dieu-maman-génétique avaient faite.
-Quel rapport avec le cul? avait-il dit en repoussant le set.
-Quoi? Le cul? Quel rapport en effet, je te le demande.
-Regarde.
Il avait sorti une photo de sa p.e.t.i.t.e.c.o.p.i.n.e. de son p.o.r.t.e.f.e.u.i.l.l.e.
Malgré le fait que je voulais en savoir plus sur ma grosseur des mains et son histoire de cul, je ne pouvais m’empêcher de pouffer rapport à la photo dans le larfeuille, merde, quoi, ho.
-Tu t’es cru aux States?
-Quoi?
-Mec! T’as la photo de ta meuf dans ton portefeuille! Allô?
Là, je le regardais fort fort fort avec mes yeux grands grands grands ouverts ouverts verts.
-Non mais, c’est pour te montrer, ce qui est gros, ce qui ne l’est pas, tout ça. ... Me Mets pas mal à l’aise comme ça.
Et voilà qu’il rangeait la photo dans son portefeuille. Again.
-Je disais donc: TU T’ES CRU AUX STATES?
-ELLE s’y est crue, oui.
Bon alors je prenais le portefeuille, sortais la photo, avec ma main droite, hein, celle qui fait tout bien et qu’est pas si moche et je regardais, mais pour le coup, de mes 2 yeux, la donzelle.
«Sexy lady» j’aurais du dire. J’entends: si j’avais été une bonne amie, avec une anatomie normale et deux mains équilibrées. Au lieu de quoi j’ai dit «Wahou, mais...»
Il faut savoir que ces trois points de suspensions ont duré bien plus de temps qu’il n’en faut pour les lire. Pour preuve, pour lire trois points de suspension, il faut quelque chose comme, je sais pas, je vais pas faire appel à un spécialiste mais.
Il y’a des spécialistes pour ça? Disons un centième de seconde. Mes 3 points de suspension du dessus avaient duré comme les 3 minutes qu'il avait mises à oser me montrer la photo. Ce que je réalisais trop tard. Je réalisais ça ET le fait que la vie soit pas cool. Parce que si j’avais réalisé avant qu’il avait mis autant de temps à me montrer la photo, j’aurais sûrement même pas parlé de mes mains, j’veux dire, ou alors, quand il m’aurait montré la photo, j’aurais senti tout ce que ça impliquait pour lui et j’aurais tenté un saut au plafond comme il savait si bien le faire, pour lui montrer, que, wahou, la vue de sa donzelle me remplissait de joie, que, mec, avec une plante pareille sur la terre, l’humanité n’avait plus aucun souci à se faire, j’aurais même peut-être dit, en mentant sûrement, mais pour lui faire plaisir, que je comprenais, maintenant, pourquoi il la gardait dans son protefeuille comme un américain.
Acolyte, là, me sort de ma tête:
-Wahou, mais quoi?
-Ben, wahou, mais, mec, vous devez être nombreux pour vous occuper de son cas, hein, non?
Ah, là, tout de suite, en le disant, pile poil, à peine j’avais terminé ma phrase que je savais. Comme on dit en maths: hésitation+sarcasme=pas bien.
-T’es assez nulle quand tu veux être une amie, tu sais. Elle a un gros cul ok, mais je montrais ça pour t'expliquer que ta main était parfaite, qu'elle allait avec le reste et que même si tu te trouvais grosse, -ce qui est insultant pour pas mal de jeunes qui vivent dans des pays en voie de développement- y'aurait toujours quelqu'un pour trouver ça beau, et je te le prouvais en te montrant que j'aimais une fille aux formes gargantuesques.
Et voilà qu'il rangeait à nouveau la photo dans le portefeuille.
-Non mais, attends, ce que je veux dire c’est que...
Bon, là, Acolyte avait utilisé sa main gauche pour la mettre sur ma main droite Peut-etre parce qu’il voulait que ma main droite à moi ne fasse rien et que la sienne puisse faire ça:
-Je me suis pas cru aux States, Baby. (Acolyte est drôle); j’ai aussi une photo de toi dans mon portefeuille.
Ma main tremblait un peu sous la sienne. Tout ça parce que j’ai une tendance à me laisser envahir par l’émotion, ce qui est très mal pour quelqu’un qui ne croit en rien, je sais, je bosse dessus.
Il sortait la photo.
-Quoi? Mais d’où t’as cette photo! Rends la moi.
Il la tenait à distance, comme dans les films, quand y’a justement un mec qui a une photo qu’une fille ne veut pas qu’il aie et que la fille veut la récupérer et que la nauture a fait les choses de telle sorte que les mecs sont assez grands pour tenir les photos qu’on veut récupérer sous notre nez mais hors de portée. Grand = 1m82, pour info.
-Arrête ça tout de suite.
-Ca fait moins la malineuh.
-Ca parle comme une prof de matheuuuuu.
-Ca te rendra pas ta photo-heu.
-Super. André?
André arrive toujours comme s’il attendait, là, juste derrière, qu’on l’appelle. A peine on a fini de prononcer le «dré» d’André que le mec dit:
-Oui mon abricot?
André donne des noms de fruits aux clients qu’il aime bien.
-(Soupir)
-Qu’est ce que tu veux mon abricot, un jus de fruit?
-Bwarf, on n’a pas d’argent, on est des nuls, c’est nul, chuis désolée.
André avait compris ce que je voulais vraiment de lui et il avait attrapé la photo qu’Acolyte tenait encore derrière son dos, me l’avait donnée et m’avait dit:
-4 café ou 6, un jus de fruit ou 2, tu sais... Abricot... Ca changera pas la face du monde.
André était généreux.
En prenant la photo, je le regardai, fier de son petit tour de passe-passe et lui demandai:
-Parce qu’il y a quelque chose qui changera la face du monde, tu crois, un jour?
-A part toi, non, rien, ça c’est sûr.
Et il était reparti près du percolateur.
Pfioulala, André était généreux, à tendance «petits noms» et papa en herbe de surcroît.
Ca faisait beaucoup pour un seul homme, et ça me faisait beaucoup d’effet à moi, la moitié d'une femme.
Acolyte, qui sentait mon enthousiasme baisser à vue d’oeil, avait décidé d’outre passer les règles, d’inventer notre propre loi: il déciderait des mots, j’écrirai. Soit. Pourquoi pas. Allons-y.
Entre-temps, on avait fumé le pétard dont j’avais eu envie plus haut et, alors, j’étais à peu près cap de tout faire. Ou alors non, j’étais à peu près cap d’en n’avoir rien à foutre de rien. Un truc dans ce genre là, quoi.
-Mais tu me fais pas le coup de mots comme «pardi» hein.
-Ben, je fais tous les coups que je veux.
-Non mais «pardi», «sapristi», «mazette» et «damoiseau», ça va nous faire un conte de château, c’est chiant.
-Bon, Albuquerque.
-Non, alors, je t’arrête tout de suite, excuse moi, mais puisqu’on va se la jouer vocabulaire, autant te le dire tout de suite, on dit «abdique» dans la vie et pas ... «albriqueque» ou je sais trop ce que tu viens de prononcer.
-Al-bu-quer-que.
-Ah. Ok. Ben. Heu. C’est pas un mot.
-Tatata, mot, nom propre, adjectif, peu importe. Albuquerque, j'te dis!
Je notais «Albuquerque», me voyant déjà faire circuler un personnage sombre et solitaire à la frontière de l’Uruguay et...
-C’est bien en Uruguay, Albuquerque, hein?
-Tu sais quel cours va commencer, là?
-Elle dit qu’elle voit pas le rapport avec sa question.
-Le cours d’Histoire géo.
Pffff, il avait oublié de dire «tiret» entre Histoire et Géo, l’inculte.
-Ok, et?
-Et, puisque tu ne vas pas y aller, tu ne sauras jamais où se trouve Albuquerque.
-Non mais attends... je sais très bien où est Albuquerque, c’est pas en Uruguay, je disais ça comme ça, c’est, ... t’sais, pas loin de...
-"Polissonne".
-Si tu veux m'entendre dire que Polissonne est un pays, un de ceux qui auraient une frontière commune avec le Nouveau Mexique et le désert de Chihuahua, tu oublies que le pétard me redonne la mémoire ET l’envie de te taquiner, raison pour laquelle, pendant que tu réalises que, oui, Albuquerque est bien au Nouveau Mexique à côté, tout près du désert de Chihuahua, et que tu te demandes comment ça m’est revenu, et bien, pendant tout ce temps, je vais me contenter de te chatouiller là où je sais que c’est tellement insupportable pour toi que tu peux te pisser dessus. Mais je vois que tu es encore en train de comprendre ma phrase quand tu devrais déjà t’enfuir, donc, d’une: le pétard ne fait pas le même effet à tout le monde, de deux: donne moi ta côte.
Le con avait soulevé son tshirt. Comme un gros con. Le con. J’te jure. Les garçons, parfois, ça me fait pitié.
-Ca te dérange pas si je te traite d’attardé pendant que je te chatouille, hein?
Pendant qu’Acolyte se tordait et rampait et enfin reprenait son souffle je disais:
-Polissonne, donc? je vous vraiment pas ce que ça veut pouvoir dire.
Je la fermais et notais «polissonne». En voyant Albuquerque et Polissonne côte à côte, j'ai eu l’impression qu’il choisissait ses mots d’après un critère phonétique, l’idée n’était pas pour me déplaire.
-"Ammoniaque", "Mangrove".
Qu’est ce que quelqu’un irait faire au Nouveau Mexique pour sniffer de l’ammoniaque et sauver la mangrove? Tomber amoureux d’une polissonne? Ca s’annonçait pas super-super cohérent tout ça.
-"Farandole».
-Bon, ça fait pas 3 mais 5 là. On arrête.
A vrai dire, Farandole me sauvait. Tout ce monde là allait bien s’entendre, c’était outre-décidé.
J’ai fait mon exercice dès que j'ai pu en me disant que, voilà, il suffisait de concerner un élève pour le voir se passionner et obéir, que c'était tout de même pas sorcier, nom de nom. J'avais même cherché d'autres mots qui sonnaient joliment. J'étais dedans, en somme. Le lendemain, il était sur son bureau. Un bureau qui ressemblait étrangement à un top case de scooter. La semaine d'après, je l'avais adressé à mon proviseur et ma prof de cette matière hybride dont j'ai déjà oublié le nom, pour les remercier de m'avoir donné 3 jours pour m'amuser. Ma prof de Français était dans le coup, bien sûr, les profs de Français ont toujours été dans mes coups. L'exercice, il vaut ce qu’il vaut, il a, quoiqu’on en dise, le mérite d’exister.
Il est là, d'ailleurs:
http://beaucoupbeaucoup.blogspot.com/2008/03/en-pmoison.html
L'énergie que ça m'avait donné, ce petit jeu à la noix, l'envie d'être à la hauteur du challenge et le plaisir de jouer avec des consonances et des sens que ça m'avait procuré, c'est autant de raisons pour que je m'y colle à nouveau. Ben, oui, les exercices dont je parlais. Et aujourd'hui, grande bourgeoise que je suis, j’ai un dictionnaire, que je peux feuilleter, et qui décidera donc que les mots clés seront:
(inquiète mais impatiente, je prends un dictionnaire, je pointe, et j’arrive)
Supsense et roulements de tambour, merci de votre intervention, je n'ai plus besoin de vous pour rendre le verdict.
-"Egérie"
-"Coupable"
et
-"Liaison"
seront les héros de ma composition.
Et que ça saute.
-maispastrop-
(et pour ceux qui douteraient de ma franchise et qui me voient déjà décider des mots sans aucun dictionnaire, je suis au regret de vous annoncer que vous vous mettez le doigt dans l'oeil jusque là, et que d'ailleurs: J'AI UNE PREUVE vidéo. hé ouais. j'ai assez triché dans ma vie pour m'attendre à ce qu'on ne croie plus alors j'anticipe. et bim.)
Inscription à :
Articles (Atom)