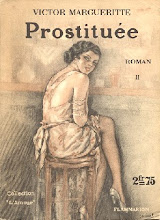Bonjour bonjour les hirondelles.
On me demande parfois si je suis heureuse.
Ca ne m’arrive pas à la boulangerie, après avoir commandé ma baguette, bien entendu.
Je n’achète pas de pain. Je sauce avec la langue. Et puis je me lève trop tard pour un vrai petit déjeuner tartine beurrée, ricoré des familles. On me demande aussi assez régulièrement si j’ai pas une cigarette, mais je ne crois pas que ça ait un quelconque rapport avec la felicidad.
Je trouve la question étonnante, à chaque fois, toute persuadée que je suis de respirer le bonheur; cependant, je mets toujours un peu de temps à répondre. Je devrais crier un «oui» tonitruant, mais je n’aime pas crier, et puis, non, je ne suis pas irrévocablement heureuse et pour toujours. Pas au point de crier, non. Ca pourrait réveiller ceux qui ont enfin arrêté de pleurer pour trouver le sommeil, on sait jamais.
Je suis heureuse par nature, je crois, c’est une chance, je ne sais d’ailleurs pas vraiment qui je dois remercier pour ça, même si mon petit doigt me dit que c’est moi; je suis heureuse par nature et quand il faut être triste je suis le best of de ça, la tristesse, je vous fais des compil si vous voulez. Et je pleure et pleure et pleure encore, comme si ça me lavait, sans me préoccuper de mes yeux, 12 heures plus tard, que je ne pourrai pas ouvrir parce qu'ils auront emmagasiné toute la dureté du monde et toute la mienne, surtout, ce qui est pire, bien sûr. Bien sûr.
Mais je suis heureuse, spontanément. Je suis heureuse d’un concert qui me remplit pendant une semaine, quand j’y repense alors que de la musique au caca sort des enceintes d’un taxi qui m’arnaque; je suis heureuse d’un livre aux dernières pages maintes fois relues et embrassées même si la personne à qui je l’ai prêté ne me l’a jamais rendu; heureuse d’un chèque qui arrive alors qu’on ne l’attendait plus et qui va combler le tiers d’un découvert obscène et alimenter le sarcasme d’un banquier trop bien payé; heureuse d’une nouvelle émission sur France 5 la nuit, même si elle nous raconte comment les tigres disparaissent à vue d’oeil - on en a tué deux depuis le début de cette phrase-; heureuse d’un vernis qui tient longtemps sur mes ongles même si je dois trop souvent faire la vaisselle et, irrémédiablement, l’écailler.
Et puis, je ne suis pas malheureuse du reste.
Mais, si on me le demande comme ça, frontalement, les yeux dans les yeux, la main dans la main si ça se trouve, mes pupilles s’embrument. Ca rate jamais; à tous les coups, ça me noie.
Qu’est ce qui me fait de la peine? Mais absolument tout, mon p’tit gars.
Qu’on me demande si je suis heureuse alors que je viens de soliloquer sur un livre pendant une heure en souriant plus que ma bouche ne s’en sentait capable. Que tout à coup, une fois la question posée, mon livre ne pèse plus que 3 crottes de mouche face à l’immensité de ma potentielle réponse. Face à l’étendue de mon hésitation. Devant la multitude de faits autrement plus importants à prendre en compte après une question pareille que mon livre, mon vernis et mon compte en banque.
Ca me fait de la peine qu’on me le demande. Que j’y réfléchisse. Que je n’aie toujours pas de réelle réponse.
Ca me fait de la peine que tu en doutes.
Ca me fait de la peine de ne pas en être sûre.
Je me dis souvent que le bonheur, s'il doit être vrai, est incroyablement égoïste et ne peut impliquer personne, et rien. J'en conclue, parfois, que le vrai bonheur ne dure que le temps d'une danse, un matin, dans un jardin, sans se préoccuper du soir même.
Et pourquoi pas.
Je vois souvent ma mini vie depuis une autre échelle. Certaines drogues et l’alcool m’aident à me projeter 10000 mètres au dessus de moi et à jauger mes petits agissements, même s’ils consistent à embrasser qui vous voudrez et à me casser la gueule là où je peux. Ca n’est pas, pour moi, une façon d’atteindre la sérénité -tiens donc?-, mais une possibilité d’envisager d’autres tristesses. J’aime bien et puis j’aime pas. Et c’est peut-être ce qui m’attriste le plus. Tous les gens qui pleurent et qu’ont même pas de masques à l’aloe véra pour faire dégonfler les paupières, le lendemain, au frais dans le frigo à côté du vernis. C’est vraiment dégueulasse.
Ca me fait de la peine que vous n’ayez pas compris que, selon-moi-pour-moi, le bonheur n’est pas un état, acquis comme ça, youplaboum, mais un but. Ca demande du boulot, de l'entêtement, presque; ça, j'en suis certaine genre carrément et tout.
Ca me fait de la peine que vous ne me posiez jamais la vraie question, la seule qui compte. «Veux tu être heureuse?».
A ce moment là, et grâce à ça, je le serai déjà immensément et je pourrais hurler que oui, quitte à réveiller ceux à qui on ne pose toujours pas les bonnes questions et les autres, dont les réponses n’intéressent personne, et qui pleurent, le visage enfoui dans un oreiller trempé.
A chaque jour suffit sa joie.
Le cougar a officiellement disparu de la circulation, pfuit, c’est terminé, finito Benito, ciao l’amigo. Et, c’est surement une broutille, pour vous, mais pour moi, c’est la vie qui voit l’bout. Pourtant, je suis là, et bien là; j’ai ri, joui et mangé une côte de boeuf aujourd’hui. Le tout accompagné d'un très bon Brouilly. Mon monde ne s'est pas écroulé. J'ai eu un pincement au coeur, et mon coeur en a l'habitude, il encaisse, j'imagine. Comme les vôtres, certainement. Je suis là et je suis heureuse. Je crois. Pendant quelques minutes. D’affilée.
Demain est une autre peine.
-maispastrop-
Ca ne m’arrive pas à la boulangerie, après avoir commandé ma baguette, bien entendu.
Je n’achète pas de pain. Je sauce avec la langue. Et puis je me lève trop tard pour un vrai petit déjeuner tartine beurrée, ricoré des familles. On me demande aussi assez régulièrement si j’ai pas une cigarette, mais je ne crois pas que ça ait un quelconque rapport avec la felicidad.
Je trouve la question étonnante, à chaque fois, toute persuadée que je suis de respirer le bonheur; cependant, je mets toujours un peu de temps à répondre. Je devrais crier un «oui» tonitruant, mais je n’aime pas crier, et puis, non, je ne suis pas irrévocablement heureuse et pour toujours. Pas au point de crier, non. Ca pourrait réveiller ceux qui ont enfin arrêté de pleurer pour trouver le sommeil, on sait jamais.
Je suis heureuse par nature, je crois, c’est une chance, je ne sais d’ailleurs pas vraiment qui je dois remercier pour ça, même si mon petit doigt me dit que c’est moi; je suis heureuse par nature et quand il faut être triste je suis le best of de ça, la tristesse, je vous fais des compil si vous voulez. Et je pleure et pleure et pleure encore, comme si ça me lavait, sans me préoccuper de mes yeux, 12 heures plus tard, que je ne pourrai pas ouvrir parce qu'ils auront emmagasiné toute la dureté du monde et toute la mienne, surtout, ce qui est pire, bien sûr. Bien sûr.
Mais je suis heureuse, spontanément. Je suis heureuse d’un concert qui me remplit pendant une semaine, quand j’y repense alors que de la musique au caca sort des enceintes d’un taxi qui m’arnaque; je suis heureuse d’un livre aux dernières pages maintes fois relues et embrassées même si la personne à qui je l’ai prêté ne me l’a jamais rendu; heureuse d’un chèque qui arrive alors qu’on ne l’attendait plus et qui va combler le tiers d’un découvert obscène et alimenter le sarcasme d’un banquier trop bien payé; heureuse d’une nouvelle émission sur France 5 la nuit, même si elle nous raconte comment les tigres disparaissent à vue d’oeil - on en a tué deux depuis le début de cette phrase-; heureuse d’un vernis qui tient longtemps sur mes ongles même si je dois trop souvent faire la vaisselle et, irrémédiablement, l’écailler.
Et puis, je ne suis pas malheureuse du reste.
Mais, si on me le demande comme ça, frontalement, les yeux dans les yeux, la main dans la main si ça se trouve, mes pupilles s’embrument. Ca rate jamais; à tous les coups, ça me noie.
Qu’est ce qui me fait de la peine? Mais absolument tout, mon p’tit gars.
Qu’on me demande si je suis heureuse alors que je viens de soliloquer sur un livre pendant une heure en souriant plus que ma bouche ne s’en sentait capable. Que tout à coup, une fois la question posée, mon livre ne pèse plus que 3 crottes de mouche face à l’immensité de ma potentielle réponse. Face à l’étendue de mon hésitation. Devant la multitude de faits autrement plus importants à prendre en compte après une question pareille que mon livre, mon vernis et mon compte en banque.
Ca me fait de la peine qu’on me le demande. Que j’y réfléchisse. Que je n’aie toujours pas de réelle réponse.
Ca me fait de la peine que tu en doutes.
Ca me fait de la peine de ne pas en être sûre.
Je me dis souvent que le bonheur, s'il doit être vrai, est incroyablement égoïste et ne peut impliquer personne, et rien. J'en conclue, parfois, que le vrai bonheur ne dure que le temps d'une danse, un matin, dans un jardin, sans se préoccuper du soir même.
Et pourquoi pas.
Je vois souvent ma mini vie depuis une autre échelle. Certaines drogues et l’alcool m’aident à me projeter 10000 mètres au dessus de moi et à jauger mes petits agissements, même s’ils consistent à embrasser qui vous voudrez et à me casser la gueule là où je peux. Ca n’est pas, pour moi, une façon d’atteindre la sérénité -tiens donc?-, mais une possibilité d’envisager d’autres tristesses. J’aime bien et puis j’aime pas. Et c’est peut-être ce qui m’attriste le plus. Tous les gens qui pleurent et qu’ont même pas de masques à l’aloe véra pour faire dégonfler les paupières, le lendemain, au frais dans le frigo à côté du vernis. C’est vraiment dégueulasse.
Ca me fait de la peine que vous n’ayez pas compris que, selon-moi-pour-moi, le bonheur n’est pas un état, acquis comme ça, youplaboum, mais un but. Ca demande du boulot, de l'entêtement, presque; ça, j'en suis certaine genre carrément et tout.
Ca me fait de la peine que vous ne me posiez jamais la vraie question, la seule qui compte. «Veux tu être heureuse?».
A ce moment là, et grâce à ça, je le serai déjà immensément et je pourrais hurler que oui, quitte à réveiller ceux à qui on ne pose toujours pas les bonnes questions et les autres, dont les réponses n’intéressent personne, et qui pleurent, le visage enfoui dans un oreiller trempé.
A chaque jour suffit sa joie.
Le cougar a officiellement disparu de la circulation, pfuit, c’est terminé, finito Benito, ciao l’amigo. Et, c’est surement une broutille, pour vous, mais pour moi, c’est la vie qui voit l’bout. Pourtant, je suis là, et bien là; j’ai ri, joui et mangé une côte de boeuf aujourd’hui. Le tout accompagné d'un très bon Brouilly. Mon monde ne s'est pas écroulé. J'ai eu un pincement au coeur, et mon coeur en a l'habitude, il encaisse, j'imagine. Comme les vôtres, certainement. Je suis là et je suis heureuse. Je crois. Pendant quelques minutes. D’affilée.
Demain est une autre peine.
-maispastrop-
L'ennui et le jour.
Je me plains pas.
J’ai à manger. Même s’il arrive que j'attende de trembler d'hypoglycémie pour me nourrir. De la même façon qu’il m’arrive d’aller faire pipi à la tou-tou-toute dernière minute. Je sais pas pourquoi.
Mais j’ai des toilettes.
Me faites pas le coup des petits africains qui souffrent de malnutrition. S’il vous please.
Je vole mon carpaccio, régulièrement. Je paie mon parmesan, parfois. On m'offre des câpres des Pouilles. Ma colocataire a un bon plan Mozzarella. Je fais super bien le hachis au canard. Et le café. Sans que je m’en rende compte, ma mère gave mon sac de graines de sésame et autres potions magiques quand je passe chez elle. Quand j'accepte enfin son invitation, mon père m'invite à la pizzeria ou à l'Hippopotamus, comme tous les padre. Léon de Bruxelles, aussi. Le Bistro Romain, bien entendu. Où je n'ai pas à voler le carpaccio, où on m'en ressert même jusqu'à ce que je puisse plus bouger, coufle-bourre.
J’ai un Franprix ouvert jusqu’à 22 heures en bas de mon immeuble, pile poil, et ouais.
Et un appétit d'ogre. Manger, c'est mon doudou.
Je me plains pas.
J’ai aussi. Heu.
Un toit.
Et un toit sur mon toit, rapport au dernier étage où j'ai élu domicile. Un toit où y rien au dessus et sur lequel je peux aller. Et quand j’y vais, généralement, c’est pour fumer des pétards et boire de la gnole avec des affreux.
J’ai des affreux, donc.
J’ai aussi d’autres trucs.
Un sexe. Par exemple.
Avec lequel je fais tout comme ce que vous faites avec le vôtre. Mais en mieux.
M’avez vous déjà vue faire pipi? Bon. Alors.
Un ordinateur.
Sur qui il m’arrive de passer ma main pour caresser l’écran.
Je l’aime. Je lui ai donné un prénom. Il a des soucis de santé et ça m'inquiète.
J'ai de l'inquiétude.
Et un buraliste chinois. J’ai ça, aussi. C’est à dire un buraliste ouvert tout le temps. Même quand c'est le 1° janvier ou pendant le ramadan.
J’ai manifestement une connexion internet, dix doigts et un blog. Je suis une PRIVILEGIEE. Je suis comme vous, on est d’accord, ok.
Je me plains pas.
Je suis pas du genre à me plaindre.
J’aime pas les geignards.
Là n’est pas la question.
Il n’est d’ailleurs pas dit qu’il y ait une quelconque question dans les centaines de signes à venir. Si vous êtes du genre à toujours vouloir répondre à tout, passez votre chemin. Ou alors, oui, allez répondre aux réclamations de ceux qu’habitent dans des quartiers où tout ferme à 20 h. Le Franprix, le tabac, moi, le planning familial. Allez-y donc.
Et pourtant.
Je passe mes journées à attendre le lendemain, même pas vraiment impatiente, je suis d’ailleurs pas persuadée que je les attende réellement, les jours d’après; et puis après quoi? Sérieux. Le 2° bing bang, peut-être? Le renouveau? La renaissance? Mais enfin, faut bien que je nomme ça d’une façon ou d’une autre. Disons donc que j’attends.
Même un chat a plus d’activités que moi, en ce moment. Je parle de chat d’appartement, entendons nous bien; ceux qui servent de statues sur les rambardes de balcons ou les pianos fermés, à peu près. Pas ceux qui pêchent et chassent et rentrent chez les gens et s’égarent et se perdent et tombent des balcons ou des pianos et. Et tout. Même ceux qu’on abandonne, ils se bougent davantage, au moins au niveau du stress. Et des émotions qu’ils provoquent.
Non, je parle du chat bourgeois que j’ai sous la main et sur qui je pose souvent ma paume chaude et ergonomique pour entendre vrombir le torse et le goitre sous le plaisir que ce geste de rien du tout lui procure. Le chat, ce pacha, au moins, lui, il passe du canap’ au lit et du lit au fauteuil; pour pioncer, peut-être, mais il le fait. Et, régulièrement, il pisse. Sans compter le nombre de fois où il déploie tous ses charmes pour se délecter de la pâtée de cheval qu’on a abattu après qu’il se soit cassé une patte, lors d’une course à Chantilly. Ca fait de la gym, quoi. Un peu. Du mouvement. Ca sollicite 2,3 muscles et un certain pouvoir de séduction. Parfois même, ça s’étire.
Moi je reste dans le lit, j’en bouge pas d’un poil. Et je ronronne plus jamais. C’est à peine si je remets le drap dans le bon sens après l’avoir chiffonné d’une nuit blanche. Je vais pas jusqu’au fauteuil, non, je pose même pas mes yeux dessus; ça demanderait trop, beaucoup, beaucoup trop de concentration.
Tu m’diras, même avec toute la volonté du monde, je tiendrai pas dans le fauteuil, là, en rond, pour y dormir. Enfin, avec beaucoup, beaucoup d’efforts et de contorsions, peut-être, d'accord. Mais on a compris que les efforts, c’est pas ma came, là, ces jours ci. Je passe un nombre incalculable d’heures à faire rien d’autre que rien faire. Je le sais, tout en le faisant. Je regarde le plafond, principalement. Il est grand. Et de type clair. Je vous dis tout. Je vous cache rien.
Même les livres, ou pire, les films, j’arrive pas. Je m’y mets 5 minutes et puis ça m’emmerde; le roman éponyme de Moravia, que j'ai acheté alors que la maladie ne m'avait pas encore complètement occupée, m'a paru incroyablement loin et haut, dans la bibliothèque. Je n'ai pas eu le courage ni l'envie de déplacer le tabouret pour atteindre la 5° et inhospitalière étagère. Et puis, qu'est ce qu'il est lourd, ce tabouret. Il a doublé de poids en 1 semaine, c'est éventuellement bizarre.
On dirait qu’il me faudrait un truc qui raconte l’histoire de ma vie pour que j’accroche.
Une meuf à poil dans un lit qui regarde un film dans lequel une fille passe son temps à poil dans son lit à regarder une femme dans un pieu qui... . Le pied, mon cul. L’enfer total. Pourtant, je suis à 75 voire 78% convaincue qu'à ça, je m’y intéresserai. Et je suis rarement convaincue de quoique ce soit à 75%. Sinon l’utilité de la viande rouge et l’inutilité du monde depuis la mort de Marilyn Monroe.
Limite, je supporterais Isabelle Huppert démaquillée dans un film sans dialogues. Quoique, la télé est dans le salon. Et le salon est au moins, je dis bien au moins, à 4 mètres de ma chambre, c'est à dire 8 pas. 8 pas de trop, donc.
Oui, non, je suis pas seulement flemmarde, je suis petite, aussi. Minus. Riquiqui.
D’un autre côté, on peut pas dire que je m’ennuie au sens propre du terme. Je m'ennuie pas comme mes amis s'ennuient quand ils disent "je m'ennuiiiie" en traînant sur le I comme pour remplir le temps au moins 3 secondes. Alors, ils tournent en rond, fument cigarette sur cigarette et se lavent plein de fois les cheveux, ou ce genre de choses ineptes. Non, c'est pas comme ça, dans mon monde. Mon ennui est teinté d'intérêt, en toute modestie. Je "m’ennuie" d’ailleurs généralement jamais. Notamment grâce à ma tête, ma géniale tête; on peut me planter devant un mur pendant une semaine, mettons que j’y trouve une mini fissure -y’a toujours une mini fissure- et à partir de là, j’imagine des trucs. J’ai pas besoin de grand chose, vraiment, je suis fille unique, hein, j’ai roulé ma bosse, je lui ai fait faire de l'exercice à mon imagination; la fissure fait l’affaire et me peuple ma journée; je visualise tout un tas d’histoires, marrantes, si possible, dramatiques, si vous voulez; avec un peu de chance, je finis avec des scénarios cochons. Y’a certaines des anecdotes que je me fabrique qui mériteraient presque d’être couchées sur le papier. Mais pour ça, faudrait encore que je me lève, que je me véhicule jusqu'au bureau et que j’allume Grace Jones, mon ordi. Bwarf, rien que d’y penser, je suis crevée. D’ailleurs, là, ça y est, j’en ai marre de dire que je suis crevée, ça me fatigue.
A cet égard, j’en arrive à me demander s’il ne faudrait pas que j'envisage de vivre le jour, un jour. Peut-être. Peut-être.
L'ennui porte conseil. Voyons voir.
-maispastrop-
J’ai à manger. Même s’il arrive que j'attende de trembler d'hypoglycémie pour me nourrir. De la même façon qu’il m’arrive d’aller faire pipi à la tou-tou-toute dernière minute. Je sais pas pourquoi.
Mais j’ai des toilettes.
Me faites pas le coup des petits africains qui souffrent de malnutrition. S’il vous please.
Je vole mon carpaccio, régulièrement. Je paie mon parmesan, parfois. On m'offre des câpres des Pouilles. Ma colocataire a un bon plan Mozzarella. Je fais super bien le hachis au canard. Et le café. Sans que je m’en rende compte, ma mère gave mon sac de graines de sésame et autres potions magiques quand je passe chez elle. Quand j'accepte enfin son invitation, mon père m'invite à la pizzeria ou à l'Hippopotamus, comme tous les padre. Léon de Bruxelles, aussi. Le Bistro Romain, bien entendu. Où je n'ai pas à voler le carpaccio, où on m'en ressert même jusqu'à ce que je puisse plus bouger, coufle-bourre.
J’ai un Franprix ouvert jusqu’à 22 heures en bas de mon immeuble, pile poil, et ouais.
Et un appétit d'ogre. Manger, c'est mon doudou.
Je me plains pas.
J’ai aussi. Heu.
Un toit.
Et un toit sur mon toit, rapport au dernier étage où j'ai élu domicile. Un toit où y rien au dessus et sur lequel je peux aller. Et quand j’y vais, généralement, c’est pour fumer des pétards et boire de la gnole avec des affreux.
J’ai des affreux, donc.
J’ai aussi d’autres trucs.
Un sexe. Par exemple.
Avec lequel je fais tout comme ce que vous faites avec le vôtre. Mais en mieux.
M’avez vous déjà vue faire pipi? Bon. Alors.
Un ordinateur.
Sur qui il m’arrive de passer ma main pour caresser l’écran.
Je l’aime. Je lui ai donné un prénom. Il a des soucis de santé et ça m'inquiète.
J'ai de l'inquiétude.
Et un buraliste chinois. J’ai ça, aussi. C’est à dire un buraliste ouvert tout le temps. Même quand c'est le 1° janvier ou pendant le ramadan.
J’ai manifestement une connexion internet, dix doigts et un blog. Je suis une PRIVILEGIEE. Je suis comme vous, on est d’accord, ok.
Je me plains pas.
Je suis pas du genre à me plaindre.
J’aime pas les geignards.
Là n’est pas la question.
Il n’est d’ailleurs pas dit qu’il y ait une quelconque question dans les centaines de signes à venir. Si vous êtes du genre à toujours vouloir répondre à tout, passez votre chemin. Ou alors, oui, allez répondre aux réclamations de ceux qu’habitent dans des quartiers où tout ferme à 20 h. Le Franprix, le tabac, moi, le planning familial. Allez-y donc.
Et pourtant.
Je passe mes journées à attendre le lendemain, même pas vraiment impatiente, je suis d’ailleurs pas persuadée que je les attende réellement, les jours d’après; et puis après quoi? Sérieux. Le 2° bing bang, peut-être? Le renouveau? La renaissance? Mais enfin, faut bien que je nomme ça d’une façon ou d’une autre. Disons donc que j’attends.
Même un chat a plus d’activités que moi, en ce moment. Je parle de chat d’appartement, entendons nous bien; ceux qui servent de statues sur les rambardes de balcons ou les pianos fermés, à peu près. Pas ceux qui pêchent et chassent et rentrent chez les gens et s’égarent et se perdent et tombent des balcons ou des pianos et. Et tout. Même ceux qu’on abandonne, ils se bougent davantage, au moins au niveau du stress. Et des émotions qu’ils provoquent.
Non, je parle du chat bourgeois que j’ai sous la main et sur qui je pose souvent ma paume chaude et ergonomique pour entendre vrombir le torse et le goitre sous le plaisir que ce geste de rien du tout lui procure. Le chat, ce pacha, au moins, lui, il passe du canap’ au lit et du lit au fauteuil; pour pioncer, peut-être, mais il le fait. Et, régulièrement, il pisse. Sans compter le nombre de fois où il déploie tous ses charmes pour se délecter de la pâtée de cheval qu’on a abattu après qu’il se soit cassé une patte, lors d’une course à Chantilly. Ca fait de la gym, quoi. Un peu. Du mouvement. Ca sollicite 2,3 muscles et un certain pouvoir de séduction. Parfois même, ça s’étire.
Moi je reste dans le lit, j’en bouge pas d’un poil. Et je ronronne plus jamais. C’est à peine si je remets le drap dans le bon sens après l’avoir chiffonné d’une nuit blanche. Je vais pas jusqu’au fauteuil, non, je pose même pas mes yeux dessus; ça demanderait trop, beaucoup, beaucoup trop de concentration.
Tu m’diras, même avec toute la volonté du monde, je tiendrai pas dans le fauteuil, là, en rond, pour y dormir. Enfin, avec beaucoup, beaucoup d’efforts et de contorsions, peut-être, d'accord. Mais on a compris que les efforts, c’est pas ma came, là, ces jours ci. Je passe un nombre incalculable d’heures à faire rien d’autre que rien faire. Je le sais, tout en le faisant. Je regarde le plafond, principalement. Il est grand. Et de type clair. Je vous dis tout. Je vous cache rien.
Même les livres, ou pire, les films, j’arrive pas. Je m’y mets 5 minutes et puis ça m’emmerde; le roman éponyme de Moravia, que j'ai acheté alors que la maladie ne m'avait pas encore complètement occupée, m'a paru incroyablement loin et haut, dans la bibliothèque. Je n'ai pas eu le courage ni l'envie de déplacer le tabouret pour atteindre la 5° et inhospitalière étagère. Et puis, qu'est ce qu'il est lourd, ce tabouret. Il a doublé de poids en 1 semaine, c'est éventuellement bizarre.
On dirait qu’il me faudrait un truc qui raconte l’histoire de ma vie pour que j’accroche.
Une meuf à poil dans un lit qui regarde un film dans lequel une fille passe son temps à poil dans son lit à regarder une femme dans un pieu qui... . Le pied, mon cul. L’enfer total. Pourtant, je suis à 75 voire 78% convaincue qu'à ça, je m’y intéresserai. Et je suis rarement convaincue de quoique ce soit à 75%. Sinon l’utilité de la viande rouge et l’inutilité du monde depuis la mort de Marilyn Monroe.
Limite, je supporterais Isabelle Huppert démaquillée dans un film sans dialogues. Quoique, la télé est dans le salon. Et le salon est au moins, je dis bien au moins, à 4 mètres de ma chambre, c'est à dire 8 pas. 8 pas de trop, donc.
Oui, non, je suis pas seulement flemmarde, je suis petite, aussi. Minus. Riquiqui.
D’un autre côté, on peut pas dire que je m’ennuie au sens propre du terme. Je m'ennuie pas comme mes amis s'ennuient quand ils disent "je m'ennuiiiie" en traînant sur le I comme pour remplir le temps au moins 3 secondes. Alors, ils tournent en rond, fument cigarette sur cigarette et se lavent plein de fois les cheveux, ou ce genre de choses ineptes. Non, c'est pas comme ça, dans mon monde. Mon ennui est teinté d'intérêt, en toute modestie. Je "m’ennuie" d’ailleurs généralement jamais. Notamment grâce à ma tête, ma géniale tête; on peut me planter devant un mur pendant une semaine, mettons que j’y trouve une mini fissure -y’a toujours une mini fissure- et à partir de là, j’imagine des trucs. J’ai pas besoin de grand chose, vraiment, je suis fille unique, hein, j’ai roulé ma bosse, je lui ai fait faire de l'exercice à mon imagination; la fissure fait l’affaire et me peuple ma journée; je visualise tout un tas d’histoires, marrantes, si possible, dramatiques, si vous voulez; avec un peu de chance, je finis avec des scénarios cochons. Y’a certaines des anecdotes que je me fabrique qui mériteraient presque d’être couchées sur le papier. Mais pour ça, faudrait encore que je me lève, que je me véhicule jusqu'au bureau et que j’allume Grace Jones, mon ordi. Bwarf, rien que d’y penser, je suis crevée. D’ailleurs, là, ça y est, j’en ai marre de dire que je suis crevée, ça me fatigue.
A cet égard, j’en arrive à me demander s’il ne faudrait pas que j'envisage de vivre le jour, un jour. Peut-être. Peut-être.
L'ennui porte conseil. Voyons voir.
-maispastrop-
Libellés :
ennui,
ennuiement,
ennuissime,
ennuyage,
ennuyant,
ennuyé,
ennuyée,
ennuyer,
ennuyure,
zzzzzzz
Jusqu'au bout de l'incroyable extrême limite.
Je vous ai déjà parlé de Jonathan Safran Foer?
Mais si. Vous savez. Cet auteur américain d’une trentaine d’années, au physique quelconque et aux épaules légèrement tombantes, qualifié ici de prodige, là, d’ovni, et petit protégé de Joyce Carol Oates.
Je vous ai déjà parlé de Jonathan Safran Foer, oui, naturellement. Naturellement. Au moins en dormant. Ou à 6 heures de la nuit avec des problèmes d’élocution. «Jontansafrfernf», c’était lui, hein. C’est toujours lui, Jontansafrfernf.
Il y a quelques mois, pour ne pas parler d’année, j’ai commencé un roman. Enfin, pour être précise, j'avais commencé un roman. Et puis, un jour, j’ai perdu 80 et quelques pages; pages remplacées comme par magie/destin/message divin...? par une lettre adressée à mon fils de pute de banquier. Subitement, les 280000 signes que j’avais poussés et mis au monde s’étaient transformés en une seule page Word, une, une seule, et n’avaient pour toute intrigue qu’une demande d’autorisation de découvert minable et non méritée dont tout un chacun aurait su qu’elle n’aboutirait pas. Ca faisait léger, comme manuscrit, ne nous mentons pas. Sans parler du «Cordialement» à la fin. Aucun roman n’est censé être cordial. Ni signé à la dernière page.
Un -autre- jour, donc, après plusieurs mois de tentative de deuil et de jérémiades informatiques, j’avais décidé de reprendre l’Ecriture avec un grand Heu...
«Un tout autre sujet, il me faut un tout autre sujet» me disais-je sans cesse, sans cesse, sans cesse. Enfin, c’est à dire, quand j’y pensais. Disons, quand je m’y collais.
Bref, «Un tout autre sujet», que je me répétais occasionnellement, certains dimanches. Fériés. Bissextiles. Tout ça.
Les tentatives de retrouver, dans ma mémoire flapie, les meilleurs moments des pages tombées aux oubliettes, s’étaient avérées, sinon vaines, tout du moins humiliantes; certaines idées me revenaient, soit; une métaphore même, youpi; mais la façon de le dire n’était plus qu’une pale copie de l’originale. C’est à dire de mon originale à moi mienne. Déconcertant, donc, humiliant, et perdu d’avance.
«Un tout autre sujet, un nouvel angle, d’autres personnages, une ville différente, des drames incomparables, des bonheurs sans égal, un héros sans égo, un auteur moins aigri», voilà ce que je m’étais imposé.
Et ces règles s’étaient révélées assez inspirantes, dans l’imbroglio de la terreur d’un nouvel essai; elles me guidaient, à la façon du nombre de signes imposés devant l’immensité des possibles d’une interview qui s’éternise. Un peu de cadre, ça peut pas faire de mal. Y’a pas que les gens qui nous ont mis au monde qui disent ça, la preuve.
Après quelques semaines transpirantes, recluse en Normandie, n’y étant pour personne, portable coupé et partie sans chargeur, j’avais mon début de deuxième roman. Je le tenais. Sérieusement; il était là, lisible, noir sur blanc. Et bien qu’ayant pour habitude d’être sévère vis à vis de moi-même - en ce qui concerne l’écriture, hein, à part ça, je me pardonne tout-, j’avais beau le retourner de toutes les façons possibles, la vérité apparaissait comme la vérité apparaît toujours: nue, criante, éblouissante. C’est ce qu’ils disent, les mecs qui parlent de la vérité: qu’elle est nue, souvent, criante aussi, et éblouissante pour les plus illuminés. La vérité vraie, c’était que c’était parti, mon kiki.
J'avais mon bureau au grand air. La belle vie.
Je ressentais un truc d'écrivain, de vrai écrivain, qui, selon l'endroit où il écrit, crache à une vitesse plus ou moins fulgurante. J'étais Proust. Ni plus ni moins.
J’avais décidé qu’au bout de quinze jours, je devais être fixée. Quinze jours d’écriture, me direz-vous, c’est énorme. Mais, vous rétorquerais-je aussitôt grâce à ma vivacité alerte, je n’ai pas la patience des femmes de marins ni la pugnacité des épouses trompées. En revanche, le penchant nocturne et arrosé de... mettons, toutes les parisiennes un tant soit peu bien dans leurs pompes qui ne prennent rien au sérieux, ça oui. J’en déborde à ne plus savoir qu’en faire. Vous en voulez?
Aussi ne m’attelais-je à ma tâche que 3 petites heures par jour, à la dérobée, entre la promenade des bunkers de la plage jusqu’au Casino de Trouville, le bar cubain de Deauville où on m’offrait des cigares et où je volais des cendriers en remerciement, et le cognac des 4 Chats, rue des Bains, sur le chemin du retour.
Néanmoins, après 3 heures d’écriture par 24 heures sur 15 jours: au bout d‘1,875 jour d’Helvetica, donc, je tranchai.
J’étais non pas satisfaite de ce que j’avais écrit mais persuadée d’être lancée. La différence est de taille, j’étais du bon côté. J’avais même découvert cette option magique et forcément, forcément inventée par un type qui lutte pour l'émergence de nouveaux auteurs dans ce monde: l’affichage «plein écran». Sans rire, on peut se concentrer comme dans le cosmos et ça vous mystifie le truc que z’avez pas idée; ça mettrait en confiance Ribéry après 400 pages de biographie. Ecrites par lui, j’entends.
Je me disais «en voiture Simone», je me chuchotais «en route pour l’aventure» et d’autres expressions vieillottes que je préfère ne pas immortaliser ici.
J’veux dire, j’y croyais, bon sang. Ca faisait, au bas mot, un an que je n’y avais pas cru de la sorte. Et, avec la foi, revenait la douce ivresse liée à la naissance d’un projet. Mon bas ventre frétillait.
Rentrée à la maison, je considérais mon foetus sous un nouvel angle. Etrangement, à Paris, il prenait encore plus d’envergure, dans la régularité de l’agitation citadine et, qu’on le veuille ou non, capitale. Dans le silence de la nuit aussi. Capitale, tout autant. Essentielle.
Je commençais à m’y attacher, diantre; je lui voyais des débuts de bras, de prépuce, et les idées fleurissaient en jet continu. Partout, sans prévenir, facialement, même.
Comme pour mon premier roman, mort né, j’avais choisi un personnage masculin. J’ai beau aimer ça, les femmes, elles continuent d’acheter Closer, c’est à dire, payer Mondadori, c’est à dire, arroser Berlusconi, tout en se revendiquant féministes; et puis elles dépensent des fortunes dans des manucures tout en causant fin du monde, les pieds en éventail.
Ca ne m’avait pas décidée, ces faits là, ça m’avait confortée; j’ai jamais imaginé écrire autre chose que l’histoire d’un homme. Parce que j’ai jamais imaginé écrire l’histoire de quelqu’un qui lui en voulait, à l’histoire, tout en la fuyant. Point. Barre./
Un soir, soudainement, je savais que mon personnage devait se déplacer. Les transports, l’émotion du transport, le mouvement, les paysages qui défilent, là où on se pose, les mauvaises chambres d'hôtel, la fenêtre du TGV, les poteaux qu’on compte, les vaches qui nous fixent, les arrondissements qui se contredisent, et la Seine, sereine. Toute cette merde, c’était ma came et, à fortiori, la sienne. Tout du moins, il devrait faire avec.
Arnaud, mon Arnaud, mon personnage chéri, était en train de déménager. J’avais fait en sorte qu’il déménage au bon moment, dès les premières pages, pas quand on l’attendait; je trouvais Arnaud tout à fait super, alors. J’étais fière de lui, mon avorton. J’étais certaine qu’Arnaud allait aller loin malgré le destin que je lui réservais. D’après moi, Arnaud était parti pour 200 pages, voire 220. Et ne pas être trop «roman Français». Non pas que j’abhore le genre, mais, de toute évidence, dans l’éventualité d’un succès planétaire au niveau de Paris 75010, je ne réussirai jamais à véhiculer l’impolitesse requise pour répondre désagréablement aux journalistes incompétents sur les plateaux de la tv. En plus, y'avait même pas des gens connus ou mon vrai mari, dans l'histoire. Donc.
Bon.
Donc bon.
Ainsi, Arnaud bandait du futur que je lui mijotais, et moi donc. Nous formions une fine équipe. Nous nous souhaitions bonne nuit souvent. Et à n’importe quelle heure de la journée, c’est dire.
Puis. Un beau soir...
Souvent, on dit «un beau matin», mais, me concernant, faudra repasser rapport au fait que j’aime pas trop voir les gens et qu’il me faut au moins 12 heures pour me faire à l’idée de, peut-être, accepter un rendez-vous; tout ce qui aurait pu m’être annoncé un beau matin m’est finalement craché vers 21h.
Un beau soir, disais-je, on m’a offert un livre. En me l'offrant, on m'a dit "Il est pour toi, ce livre, il est fait pour toi, il a été écrit pour toi, il est pour toi." On m'a dit ça, tout de go.
J'ai pensé "nom de dieu de bordel de merde, qui es-tu, toi, pour savoir ce qui est fait ou non pour moi ou pas, mmmh?" sans oser le dire à voix haute parce que, tout de même, je recevais un cadeau, sans raison apparente, sans date anniversaire, sans événement à fêter, simplement parce que ce fameux roman était soit disant fait pour moi. Alors je me taisais et demandais simplement:
-C'est quoi?
C'était simple, comme demande.
-C'est extrêmement fort et incroyablement près.
-Cool. Enfin, j'veux dire, tu vas pas me dire, après avoir annoncé qu'il était fait "pour moi" que c'est majestueusement mou et formidablement incompréhensible. Donc, d'accord, c'est bien mais: c'est quoi?
-Non mais, c'est le titre, en fait, Extrêmement fort et incroyablement près.
Extrêmement fort et incroyablement près c’était le titre. Et chez mon éditeur préféré. Et, drôle, drôle à en crever: la couverture était incroyablement celle que j’avais imaginée pour mon mien de roman extrêmement à moi, si, un jour, peut-être, un mec sur le point d’être viré d'une maison d'édition décidait de l’éditer, comme ça, pour la blague. Ca roulait la merde*. J'étais salement de la baise**. Mon Arnaud transpirait un peu, à cette minute là, et mon roman haletait. Mon coeur battait plus vite que d’habitude, et, d’habitude, il bat déjà trop vite.
Cette couverture m'avait assommée. Littéralement. J'veux dire, j'ai ouvert le paquet cadeau et j'ai eu le tournis au point de devoir me tenir à ce type, là, avec qui je buvais beaucoup trop de vodka, et qui n'était pourtant pourtant pas la cause de mon étourdissement.
-Ca va? T'es ivre?
-Non. Oui. Non. Enfin non, je suis pas ivre. Et, oui, ça va.
-T'es sûre?
-... Non, ça va pas. En fait, ça va pas.
En fait ça n'allait pas.
-Pourquoi, qu'est ce qu'il t'arrive?
-Je voudrais être ivre.
-Ah. Alors, ça va.
-Non.
-Non?
-Non, je voudrais être ivre au point d'atteindre ce moment où je perds la mémoire et comme ça, bon, demain, je me dirai pas que la couverture que je voulais pour mon roman existe déjà, et, du coup, bin, je pourrai continuer à écrire mon roman que déjà je l'ai perdu la première fois alors bon, que je voudrais bien qu'on me foute la paix. Que merde quoi.
- Heu, quoi, donc? Tu veux un verre alors?
-Je ne sais même pas pourquoi t'es pas déjà au bar, à vrai dire.
Et, à vrai dire, j'ai dit ça en le poussant de sa chaise.
Je regardai cette couverture. Je la regardai de tous mes yeux. Chacun d'eux étaient concentrés comme jamais ils ne l'avaient été sur, même, mettons, une carte de boissons fortes à moitié prix.
-Tiens, je t'ai pris une vodka tonic, ça te va?
Après l'avoir bue d'une traite, j'avais jugé inutile de lui répondre considérant que mon débit représentait déjà une forme d'approbation. Merci.
Et je suis partie, avec le livre que je serrais sous mon bras, en le protégeant, comme s'il savait comment sauver l'humanité et tout. De tout. Et pour toujours. Alors que j'en ai rien à foutre de l'humanité. Et que j'en ai rien à foutre de rien. Jamais. Mais je le serrais, et le serrais encore, jusqu'à ce qu'une crampe à l'épaule m'empêche de continuer et que je me résigne à faire une petite pause respiration, équilibre, pulsations et espoir.
On dira ce qu'on voudra des Parisiens, ils savent repérer un moment crucial comme personne. Proportionnellement, ils sont meilleurs que tous les autres quand ils sont à moitié sympas, forcément, puisqu'ils partent du pire. Si je n'avais pas été en perdition, ma tentative de rattraper la porte cochère avant qu'elle ne se ferme derrière madame et son chien-chien aurait été assimilée à du vandalisme avant même que je sorte ma bière, mon berger allemand, mes bilboquets et mes bombes. Ce soir là, madame et son chien-chien ont compris, et ma tentative de rattraper la porte cochère avant qu'elle ne se ferme a été suivie d'un échec, d'un obscur bruit électronique de verrou automatique, oui, mais aussi d'un code tapé sous mes yeux comme par magie, juste après.
-Je vous en prie, me dit la dame.
Je l'avais même pas encore remerciée que déjà elle me remerciait de l'avoir pas encore remerciée.
-Je vous remercie, je lui réponds, du coup.
Et je pense, subitement, à la façon dont l'humanité pourrait s'aider allégrement dans ce genre de petits gestes quotidiens. Je me rappelle aussi immédiatement mon incapacité à m'y plier et mon mépris de ça, l'humanité. Et puis, si tout le monde se donnait la main, qui s'occuperait de faire à manger, sérieux.
-Vous avez l'air en retard.
-Cause que je suis préssée.
-Bonne soirée.
-Bonne soirée à vous aussi et à (je regarde le caniche rose beige poudre bizarre)...
-Cannelle.
-Sérieusement?
-Que voulez vous dire?
-Je veux dire, vous avez sérieusement appelé ce caniche rose-beige-poudre: Cannelle?
-Oui. Pourquoi?
-Parce que... et bien, c'est un peu comme appeler un labrador beige Caramel, vous voyez.
-J'ai aussi un labrador. Beige.
-Ha?
-Qui s'appelle Caramel.
-Ha!
-Oui.
-Vous aimez bien les chiens, non, dans la vie?
-Non, je me force.
-Ah zut, désolée.
-Je plaisante.
-Ah ok, désolée.
-Bonne soirée.
-Oui. Voilà. D'accord. Vous aussi. Bonsoir Cannelle. Le bonjour à Caramel hein !
Et en me retrouvant dans le hall, fleuri comme un rond point de ville jumelée à je ne sais trop quel bourg anglais, je me suis dit que c'était pas tout à fait ce qu'on pouvait appeler "un grand moment de conversation", que je venais de vivre là.
Je me suis assise sur les marches de ce que j'ai imaginé être la loge de la concierge. C'était mignon tout plein, y'avait de la faune en cage et de la flore en pot. Quelques fourmis. Deux escargots. Et le silence. J'ai ouvert le livre. Mon coeur battait plus fort encore que tout à l'heure quand il battait déjà trop fort. Je sentais le trafic sanguin dans mes tempes, j'étais un métronome d'angoisse à moi toute seule. J'ai ouvert le livre. J'ai ouvert le livre.
Je l'ai ouvert.
Dès la première page, j'ai cru mourir.
C'était mes mots. Et si c'était pas mes mots, c'était mes blagues. Et si c'était pas mes blagues, c'était l'intérieur de ma tête. J'ai tout de suite décidé de feuilleter le truc, tout en respirant l'odeur qui sortait du mouvement des pages. Et j'ai cru mourir à nouveau.
C'est là que j'ai su que j'étais pas morte, du coup. On meurt pas deux fois, hé, ça va, ça je le sais. Ca m'a soulagée un peu, l'air de rien, dans la suffocation de ma noyade. Mais je me suis aussitôt rappelé ce truc avec lequel j'avais toujours été plus ou moins d'accord, que je sais plus qui avait dit, je sais plus quand, et qui disait à peu près "mieux vaut tard que jamais". Je me suis également dit que ce dicton n'avait absolument aucun rapport avec ce que je vivais à ce moment précis, et j'ai senti comme un décalage narquois entre mon moi et mon surmoi. Je me suis aussi rappelé ne pas croire à ces trucs de moi et de sur-toi. J'étais comme on dit, en train de pédaler dans la semoule. Je continuais donc de sombrer dans le papier.
La mise en page aussi était la mienne. Des dessins pas finis, des lignes rayées, des pages entièrement noircies et des cartes de visite scannées. C'était, à n'en pas douter, une expérience extrêmement forte et incroyablement proche. C'était, sans aucun doute, fait pour moi. Je l'admets. J'aurais préféré que non. J'aurais préféré qu'aucun livre ne soit fait pour moi, je me serais satisfaite de Fante, Topor, Salinger, Vian. Je me serais satisfaite de rien s'il avait fallu. J'avais jamais demandé à tomber sur un roman "fait pour moi" presque fait par moi. Il m'aurait d'ailleurs fallu bien plus d'imagination que je n'en ai pour exiger un truc pareil.
Si Jonathan Safran Foer tenait un blog, la chose la plus belle du monde (avec la viande rouge gratuite à volonté et la résurrection de Marilyn Monroe) serait qu’un de ses billets commence par «Je vous ai déjà parlé de Manon Troppo?». Mais ça ne se fera pas. A moins d’être suivi de «C’est une connasse qui s’est prise pour moi, nom de dieu, que fait la police!» ou ce genre de mots doux.
Je sais que tout a déjà été dit, je sais que je n’écrirai jamais rien d’unique, je sais, je sais que quelqu’un a sûrement déjà dit ça aussi, oui, et, d'une plus jolie façon, certainement; pourtant, il va bien falloir que j’essaie.
-maispastrop-
Mais si. Vous savez. Cet auteur américain d’une trentaine d’années, au physique quelconque et aux épaules légèrement tombantes, qualifié ici de prodige, là, d’ovni, et petit protégé de Joyce Carol Oates.
Je vous ai déjà parlé de Jonathan Safran Foer, oui, naturellement. Naturellement. Au moins en dormant. Ou à 6 heures de la nuit avec des problèmes d’élocution. «Jontansafrfernf», c’était lui, hein. C’est toujours lui, Jontansafrfernf.
Il y a quelques mois, pour ne pas parler d’année, j’ai commencé un roman. Enfin, pour être précise, j'avais commencé un roman. Et puis, un jour, j’ai perdu 80 et quelques pages; pages remplacées comme par magie/destin/message divin...? par une lettre adressée à mon fils de pute de banquier. Subitement, les 280000 signes que j’avais poussés et mis au monde s’étaient transformés en une seule page Word, une, une seule, et n’avaient pour toute intrigue qu’une demande d’autorisation de découvert minable et non méritée dont tout un chacun aurait su qu’elle n’aboutirait pas. Ca faisait léger, comme manuscrit, ne nous mentons pas. Sans parler du «Cordialement» à la fin. Aucun roman n’est censé être cordial. Ni signé à la dernière page.
Un -autre- jour, donc, après plusieurs mois de tentative de deuil et de jérémiades informatiques, j’avais décidé de reprendre l’Ecriture avec un grand Heu...
«Un tout autre sujet, il me faut un tout autre sujet» me disais-je sans cesse, sans cesse, sans cesse. Enfin, c’est à dire, quand j’y pensais. Disons, quand je m’y collais.
Bref, «Un tout autre sujet», que je me répétais occasionnellement, certains dimanches. Fériés. Bissextiles. Tout ça.
Les tentatives de retrouver, dans ma mémoire flapie, les meilleurs moments des pages tombées aux oubliettes, s’étaient avérées, sinon vaines, tout du moins humiliantes; certaines idées me revenaient, soit; une métaphore même, youpi; mais la façon de le dire n’était plus qu’une pale copie de l’originale. C’est à dire de mon originale à moi mienne. Déconcertant, donc, humiliant, et perdu d’avance.
«Un tout autre sujet, un nouvel angle, d’autres personnages, une ville différente, des drames incomparables, des bonheurs sans égal, un héros sans égo, un auteur moins aigri», voilà ce que je m’étais imposé.
Et ces règles s’étaient révélées assez inspirantes, dans l’imbroglio de la terreur d’un nouvel essai; elles me guidaient, à la façon du nombre de signes imposés devant l’immensité des possibles d’une interview qui s’éternise. Un peu de cadre, ça peut pas faire de mal. Y’a pas que les gens qui nous ont mis au monde qui disent ça, la preuve.
Après quelques semaines transpirantes, recluse en Normandie, n’y étant pour personne, portable coupé et partie sans chargeur, j’avais mon début de deuxième roman. Je le tenais. Sérieusement; il était là, lisible, noir sur blanc. Et bien qu’ayant pour habitude d’être sévère vis à vis de moi-même - en ce qui concerne l’écriture, hein, à part ça, je me pardonne tout-, j’avais beau le retourner de toutes les façons possibles, la vérité apparaissait comme la vérité apparaît toujours: nue, criante, éblouissante. C’est ce qu’ils disent, les mecs qui parlent de la vérité: qu’elle est nue, souvent, criante aussi, et éblouissante pour les plus illuminés. La vérité vraie, c’était que c’était parti, mon kiki.
J'avais mon bureau au grand air. La belle vie.
Je ressentais un truc d'écrivain, de vrai écrivain, qui, selon l'endroit où il écrit, crache à une vitesse plus ou moins fulgurante. J'étais Proust. Ni plus ni moins.
J’avais décidé qu’au bout de quinze jours, je devais être fixée. Quinze jours d’écriture, me direz-vous, c’est énorme. Mais, vous rétorquerais-je aussitôt grâce à ma vivacité alerte, je n’ai pas la patience des femmes de marins ni la pugnacité des épouses trompées. En revanche, le penchant nocturne et arrosé de... mettons, toutes les parisiennes un tant soit peu bien dans leurs pompes qui ne prennent rien au sérieux, ça oui. J’en déborde à ne plus savoir qu’en faire. Vous en voulez?
Aussi ne m’attelais-je à ma tâche que 3 petites heures par jour, à la dérobée, entre la promenade des bunkers de la plage jusqu’au Casino de Trouville, le bar cubain de Deauville où on m’offrait des cigares et où je volais des cendriers en remerciement, et le cognac des 4 Chats, rue des Bains, sur le chemin du retour.
Néanmoins, après 3 heures d’écriture par 24 heures sur 15 jours: au bout d‘1,875 jour d’Helvetica, donc, je tranchai.
J’étais non pas satisfaite de ce que j’avais écrit mais persuadée d’être lancée. La différence est de taille, j’étais du bon côté. J’avais même découvert cette option magique et forcément, forcément inventée par un type qui lutte pour l'émergence de nouveaux auteurs dans ce monde: l’affichage «plein écran». Sans rire, on peut se concentrer comme dans le cosmos et ça vous mystifie le truc que z’avez pas idée; ça mettrait en confiance Ribéry après 400 pages de biographie. Ecrites par lui, j’entends.
Je me disais «en voiture Simone», je me chuchotais «en route pour l’aventure» et d’autres expressions vieillottes que je préfère ne pas immortaliser ici.
J’veux dire, j’y croyais, bon sang. Ca faisait, au bas mot, un an que je n’y avais pas cru de la sorte. Et, avec la foi, revenait la douce ivresse liée à la naissance d’un projet. Mon bas ventre frétillait.
Rentrée à la maison, je considérais mon foetus sous un nouvel angle. Etrangement, à Paris, il prenait encore plus d’envergure, dans la régularité de l’agitation citadine et, qu’on le veuille ou non, capitale. Dans le silence de la nuit aussi. Capitale, tout autant. Essentielle.
Je commençais à m’y attacher, diantre; je lui voyais des débuts de bras, de prépuce, et les idées fleurissaient en jet continu. Partout, sans prévenir, facialement, même.
Comme pour mon premier roman, mort né, j’avais choisi un personnage masculin. J’ai beau aimer ça, les femmes, elles continuent d’acheter Closer, c’est à dire, payer Mondadori, c’est à dire, arroser Berlusconi, tout en se revendiquant féministes; et puis elles dépensent des fortunes dans des manucures tout en causant fin du monde, les pieds en éventail.
Ca ne m’avait pas décidée, ces faits là, ça m’avait confortée; j’ai jamais imaginé écrire autre chose que l’histoire d’un homme. Parce que j’ai jamais imaginé écrire l’histoire de quelqu’un qui lui en voulait, à l’histoire, tout en la fuyant. Point. Barre./
Un soir, soudainement, je savais que mon personnage devait se déplacer. Les transports, l’émotion du transport, le mouvement, les paysages qui défilent, là où on se pose, les mauvaises chambres d'hôtel, la fenêtre du TGV, les poteaux qu’on compte, les vaches qui nous fixent, les arrondissements qui se contredisent, et la Seine, sereine. Toute cette merde, c’était ma came et, à fortiori, la sienne. Tout du moins, il devrait faire avec.
Arnaud, mon Arnaud, mon personnage chéri, était en train de déménager. J’avais fait en sorte qu’il déménage au bon moment, dès les premières pages, pas quand on l’attendait; je trouvais Arnaud tout à fait super, alors. J’étais fière de lui, mon avorton. J’étais certaine qu’Arnaud allait aller loin malgré le destin que je lui réservais. D’après moi, Arnaud était parti pour 200 pages, voire 220. Et ne pas être trop «roman Français». Non pas que j’abhore le genre, mais, de toute évidence, dans l’éventualité d’un succès planétaire au niveau de Paris 75010, je ne réussirai jamais à véhiculer l’impolitesse requise pour répondre désagréablement aux journalistes incompétents sur les plateaux de la tv. En plus, y'avait même pas des gens connus ou mon vrai mari, dans l'histoire. Donc.
Bon.
Donc bon.
Ainsi, Arnaud bandait du futur que je lui mijotais, et moi donc. Nous formions une fine équipe. Nous nous souhaitions bonne nuit souvent. Et à n’importe quelle heure de la journée, c’est dire.
Puis. Un beau soir...
Souvent, on dit «un beau matin», mais, me concernant, faudra repasser rapport au fait que j’aime pas trop voir les gens et qu’il me faut au moins 12 heures pour me faire à l’idée de, peut-être, accepter un rendez-vous; tout ce qui aurait pu m’être annoncé un beau matin m’est finalement craché vers 21h.
Un beau soir, disais-je, on m’a offert un livre. En me l'offrant, on m'a dit "Il est pour toi, ce livre, il est fait pour toi, il a été écrit pour toi, il est pour toi." On m'a dit ça, tout de go.
J'ai pensé "nom de dieu de bordel de merde, qui es-tu, toi, pour savoir ce qui est fait ou non pour moi ou pas, mmmh?" sans oser le dire à voix haute parce que, tout de même, je recevais un cadeau, sans raison apparente, sans date anniversaire, sans événement à fêter, simplement parce que ce fameux roman était soit disant fait pour moi. Alors je me taisais et demandais simplement:
-C'est quoi?
C'était simple, comme demande.
-C'est extrêmement fort et incroyablement près.
-Cool. Enfin, j'veux dire, tu vas pas me dire, après avoir annoncé qu'il était fait "pour moi" que c'est majestueusement mou et formidablement incompréhensible. Donc, d'accord, c'est bien mais: c'est quoi?
-Non mais, c'est le titre, en fait, Extrêmement fort et incroyablement près.
Extrêmement fort et incroyablement près c’était le titre. Et chez mon éditeur préféré. Et, drôle, drôle à en crever: la couverture était incroyablement celle que j’avais imaginée pour mon mien de roman extrêmement à moi, si, un jour, peut-être, un mec sur le point d’être viré d'une maison d'édition décidait de l’éditer, comme ça, pour la blague. Ca roulait la merde*. J'étais salement de la baise**. Mon Arnaud transpirait un peu, à cette minute là, et mon roman haletait. Mon coeur battait plus vite que d’habitude, et, d’habitude, il bat déjà trop vite.
Cette couverture m'avait assommée. Littéralement. J'veux dire, j'ai ouvert le paquet cadeau et j'ai eu le tournis au point de devoir me tenir à ce type, là, avec qui je buvais beaucoup trop de vodka, et qui n'était pourtant pourtant pas la cause de mon étourdissement.
-Ca va? T'es ivre?
-Non. Oui. Non. Enfin non, je suis pas ivre. Et, oui, ça va.
-T'es sûre?
-... Non, ça va pas. En fait, ça va pas.
En fait ça n'allait pas.
-Pourquoi, qu'est ce qu'il t'arrive?
-Je voudrais être ivre.
-Ah. Alors, ça va.
-Non.
-Non?
-Non, je voudrais être ivre au point d'atteindre ce moment où je perds la mémoire et comme ça, bon, demain, je me dirai pas que la couverture que je voulais pour mon roman existe déjà, et, du coup, bin, je pourrai continuer à écrire mon roman que déjà je l'ai perdu la première fois alors bon, que je voudrais bien qu'on me foute la paix. Que merde quoi.
- Heu, quoi, donc? Tu veux un verre alors?
-Je ne sais même pas pourquoi t'es pas déjà au bar, à vrai dire.
Et, à vrai dire, j'ai dit ça en le poussant de sa chaise.
Je regardai cette couverture. Je la regardai de tous mes yeux. Chacun d'eux étaient concentrés comme jamais ils ne l'avaient été sur, même, mettons, une carte de boissons fortes à moitié prix.
-Tiens, je t'ai pris une vodka tonic, ça te va?
Après l'avoir bue d'une traite, j'avais jugé inutile de lui répondre considérant que mon débit représentait déjà une forme d'approbation. Merci.
Et je suis partie, avec le livre que je serrais sous mon bras, en le protégeant, comme s'il savait comment sauver l'humanité et tout. De tout. Et pour toujours. Alors que j'en ai rien à foutre de l'humanité. Et que j'en ai rien à foutre de rien. Jamais. Mais je le serrais, et le serrais encore, jusqu'à ce qu'une crampe à l'épaule m'empêche de continuer et que je me résigne à faire une petite pause respiration, équilibre, pulsations et espoir.
On dira ce qu'on voudra des Parisiens, ils savent repérer un moment crucial comme personne. Proportionnellement, ils sont meilleurs que tous les autres quand ils sont à moitié sympas, forcément, puisqu'ils partent du pire. Si je n'avais pas été en perdition, ma tentative de rattraper la porte cochère avant qu'elle ne se ferme derrière madame et son chien-chien aurait été assimilée à du vandalisme avant même que je sorte ma bière, mon berger allemand, mes bilboquets et mes bombes. Ce soir là, madame et son chien-chien ont compris, et ma tentative de rattraper la porte cochère avant qu'elle ne se ferme a été suivie d'un échec, d'un obscur bruit électronique de verrou automatique, oui, mais aussi d'un code tapé sous mes yeux comme par magie, juste après.
-Je vous en prie, me dit la dame.
Je l'avais même pas encore remerciée que déjà elle me remerciait de l'avoir pas encore remerciée.
-Je vous remercie, je lui réponds, du coup.
Et je pense, subitement, à la façon dont l'humanité pourrait s'aider allégrement dans ce genre de petits gestes quotidiens. Je me rappelle aussi immédiatement mon incapacité à m'y plier et mon mépris de ça, l'humanité. Et puis, si tout le monde se donnait la main, qui s'occuperait de faire à manger, sérieux.
-Vous avez l'air en retard.
-Cause que je suis préssée.
-Bonne soirée.
-Bonne soirée à vous aussi et à (je regarde le caniche rose beige poudre bizarre)...
-Cannelle.
-Sérieusement?
-Que voulez vous dire?
-Je veux dire, vous avez sérieusement appelé ce caniche rose-beige-poudre: Cannelle?
-Oui. Pourquoi?
-Parce que... et bien, c'est un peu comme appeler un labrador beige Caramel, vous voyez.
-J'ai aussi un labrador. Beige.
-Ha?
-Qui s'appelle Caramel.
-Ha!
-Oui.
-Vous aimez bien les chiens, non, dans la vie?
-Non, je me force.
-Ah zut, désolée.
-Je plaisante.
-Ah ok, désolée.
-Bonne soirée.
-Oui. Voilà. D'accord. Vous aussi. Bonsoir Cannelle. Le bonjour à Caramel hein !
Et en me retrouvant dans le hall, fleuri comme un rond point de ville jumelée à je ne sais trop quel bourg anglais, je me suis dit que c'était pas tout à fait ce qu'on pouvait appeler "un grand moment de conversation", que je venais de vivre là.
Je me suis assise sur les marches de ce que j'ai imaginé être la loge de la concierge. C'était mignon tout plein, y'avait de la faune en cage et de la flore en pot. Quelques fourmis. Deux escargots. Et le silence. J'ai ouvert le livre. Mon coeur battait plus fort encore que tout à l'heure quand il battait déjà trop fort. Je sentais le trafic sanguin dans mes tempes, j'étais un métronome d'angoisse à moi toute seule. J'ai ouvert le livre. J'ai ouvert le livre.
Je l'ai ouvert.
Dès la première page, j'ai cru mourir.
C'était mes mots. Et si c'était pas mes mots, c'était mes blagues. Et si c'était pas mes blagues, c'était l'intérieur de ma tête. J'ai tout de suite décidé de feuilleter le truc, tout en respirant l'odeur qui sortait du mouvement des pages. Et j'ai cru mourir à nouveau.
C'est là que j'ai su que j'étais pas morte, du coup. On meurt pas deux fois, hé, ça va, ça je le sais. Ca m'a soulagée un peu, l'air de rien, dans la suffocation de ma noyade. Mais je me suis aussitôt rappelé ce truc avec lequel j'avais toujours été plus ou moins d'accord, que je sais plus qui avait dit, je sais plus quand, et qui disait à peu près "mieux vaut tard que jamais". Je me suis également dit que ce dicton n'avait absolument aucun rapport avec ce que je vivais à ce moment précis, et j'ai senti comme un décalage narquois entre mon moi et mon surmoi. Je me suis aussi rappelé ne pas croire à ces trucs de moi et de sur-toi. J'étais comme on dit, en train de pédaler dans la semoule. Je continuais donc de sombrer dans le papier.
La mise en page aussi était la mienne. Des dessins pas finis, des lignes rayées, des pages entièrement noircies et des cartes de visite scannées. C'était, à n'en pas douter, une expérience extrêmement forte et incroyablement proche. C'était, sans aucun doute, fait pour moi. Je l'admets. J'aurais préféré que non. J'aurais préféré qu'aucun livre ne soit fait pour moi, je me serais satisfaite de Fante, Topor, Salinger, Vian. Je me serais satisfaite de rien s'il avait fallu. J'avais jamais demandé à tomber sur un roman "fait pour moi" presque fait par moi. Il m'aurait d'ailleurs fallu bien plus d'imagination que je n'en ai pour exiger un truc pareil.
-Bonjour mon bonhomme.
-En fait, je ne suis pas votre bonhomme.
-Oui, bon. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, tu ne trouves pas? Si tu veux, on peut sortir taper un peu dans le ballon.
-Est ce que je trouve qu'il fait un temps magnifique, oui. Est ce que je veux sortir taper dans le ballon, non.
-T'es sûr?
-Le sport n'est pas passionnant.
-Qu'est ce que tu trouves passionnant?
-Quel genre de réponse cherchez-vous?
-Qu'est ce qui te fait croire que je cherche quelque chose?
-Qu'est ce qui vous fait croire que je suis le dernier des crétins?
-Je ne crois pas du tout que tu sois le dernier des crétins. Je ne te trouve pas crétin du tout.
-Merci.
-D'après toi, pourquoi es-tu ici, Oskar?
-Je suis ici, docteur, parce que ma maman est inquiète que la vie me mette devant des difficultés insurmontables.
-Est-ce qu'elle a raison de s'inquiéter?
-Pas vraiment. La vie est une difficulté insurmontable.
-Quand tu dis "difficulté insurmontable", à quoi penses-tu?
-Je suis sans arrêt victime de mes émotions.
-Tu en es victime, là, en ce moment?
-J'en suis extrêmement victime, là, en ce moment.
-Quelles sont les émotions que tu ressens?
-Toutes.
-Mais encore?
-Là, en ce moment, je ressens de la tristesse, du bonheur, de la colère, de l'amour, de la culpabilité, de la joie, de la honte, et un tout petit peu d'humour parce qu'une partie de mon cerveau se rappelle quelque chose de tordant que Dentifrice a fait un jour et dont je ne peux pas parler.
-Ca fait vraiment beaucoup.
-Il a mis du laxatif dans les pains au chocolat qu'on vendait à la fête du club de français.
-Je reconnais que c'est drôle.
-Je ressens tout.
-Cette émotionnalité, est-ce qu'elle affecte ta vie quotidienne?
-Pour répondre à votre question, je crois que ce mot n'existe pas. Emotionnalité. Mais je comprends ce que vous essayez de dire, et, oui, je pleure beaucoup, le plus souvent quand je suis tout seul. C'est extrêmement dur pour moi d'aller à l'école. Et aussi, je ne peux pas dormir chez des amis parce que je panique à l'idée d'être loin de maman. Je m'y prends mal avec les gens.
-Et d'après toi, que se passe-t-il?
-Je ressens trop de choses. Voilà ce qui se passe.
-Tu crois qu'on peut ressentir trop? Ou alors qu'on ne ressent pas comme il faudrait?
-Mes intérieurs ne collent pas avec mes extérieurs.
-Et ce n'est pas le cas de tout le monde, tu crois?
-J'en sais rien. Je ne suis que moi.
-Peut-être que c'est justement la personnalité de chacun, cette différence entre l'intérieur et l'extérieur.
-Mais pour moi, c'est pire.
-Je me demande si tout le monde n'a pas cette impression.
-Probablement. Mais pour moi, c'est vraiment pire.
Il s'est redressé sur son fauteuil et il a posé son stylo sur le bureau.
-Je peux te poser une question très personnelle?
-On est en république.
-As-tu remarqué des petits poils sur ton scrotum?
-Scrotum?
-Le scrotum est le petit sac à la base de ton pénis qui contient tes testicules.
-Mes couilles.
-C'est ça.
-Passionnant.
-Vas-y, ne te gêne pas, réfléchis une seconde. Je peux me retourner si tu veux.
-Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je n'ai pas de petits poils sur le scrotum.
Il a écrit quelque chose sur un bout de papier.
-Docteur?
-Appelle-moi Howard.
-Vous m'avez dit de vous dire quand j'étais gêné.
-Oui.
-Je suis gêné.
-Excuse-moi. Je sais que c'était une question très personnelle. Je l'ai posée seulement parce que parfois, quand notre corps change, nous éprouvons des changements spectaculaires dans notre vie émotionnelle. Je me demandais si, par hasard, une partie de ce que tu vis n'était pas due à des changements dans ton corps.
-La réponse est non. C'est dû à ce que mon père est mort de la mort la plus horrible que quiconque ait jamais pu inventer.
Il m'a regardé et je l'ai regardé. Je me suis promis que je ne serais pas le premier à détourner les yeux. Mais, comme d'habitude, j'ai été le premier.
-Un petit jeu, ça te dirait?
-Est-ce que c'est un casse-tête?
-Pas vraiment.
-J'aime bien les casse-tête.
-Moi aussi. Mais ce n'en est pas un.
-Pas de bol.
-Je vais dire un mot et je veux que tu me dises la première chose qui te viendra à l'esprit. Ca peut être un autre mot, le nom de quelqu'un, ou même un bruit. Tout ce que tu voudras. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pas de règle. Tu veux bien qu'on essaie?
-Allez-y.
Il a dit:
-Famille
J'ai dit:
-Famille.
Il a dit:
-Excuse-moi, j'ai l'impression que je n'ai pas bien expliqué. Quand je dis un mot, tu me dis la première chose qui te passe par la tête.
-Vous avez dit "famille", et la première chose qui m'est passée par la tête c'est famille.
-Bien, mais essayons de ne pas utiliser le même mot. D'accord?
-D'accord. Heu, pardon, oui.
-Famille.
-Flirt poussé.
-Flirt poussé?
-C'est quand un homme frotte le ginva d'une femme avec les doigts, c'est bien ça?
-Oui, c'est ça, d'accord. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Mais pourquoi pas sécurité?
-Pourquoi pas.
-D'accord.
-Oui.
-Nombril.
-Nombril?
-Nombril.
-Je ne peux penser à rien d'autre que nombril.
-Allons essaie. Nombril.
-Nombril ne me fait penser à rien.
-Creuse un peu.
-Mon nombril?
-Ton cerveau, Oskar.
-Heu....
-Nombril. Nombril.
-Anus de l'estomac?
-Bien.
-Mal.
-Non, j'ai dit "bien". Ta réaction est bien.
-Ma réaction est bonne.
-Bonne.
-Bonbonne.
-Fêter.
-Ouaf Ouaf!
-C'était un aboiement?
-Bref.
-D'accord. Génial.
-Oui.
-Sale.
-Nombril.
-Mal à l'aise.
-Extrêmement.
-Jaune.
-La couleur du nombril d'une personne jaune.
-Essayons de répondre par un seul mot, tu veux bien?
-Pour un jeu qui n'a pas de règles, ça fait beaucoup de règles.
-Blessé.
-Réaliste.
-Concombre.
-Formica.
-Formica?
-Concombre?
-Foyer?
-Là où on a ses affaires.
-Urgence.
-Papa.
-Ton père est la cause de l'urgence ou sa solution?
-Les deux.
-Bonheur.
-Bonheur. Heu, pardon.
-Bonheur.
-Je sais pas.
-Essaie. Bonheur.
-Chaipas.
-Bonheur. Creuse.
J'ai haussé les épaules. Bonheur, bonheur.
-Docteur?
-Howard.
-Howard?
-Oui?
-Je suis gêné.
On a passé le reste des 45 minutes à parler alors que j'avais rien à lui dire. J'avais pas envie d'être là. J'avais envie d'être nulle part sauf à chercher la serrure. Quand il a été presque l'heure que maman rentre, le Dr Frein a dit qu'il voulait qu'on fasse un projet pour que la semaine prochaine soit meilleure que la précédente.
Il a dit:
-Et si tu me disais les choses que tu penses pouvoir faire, des choses à ne pas oublier. Comme ça, la semaine prochaine, on verra si tu as réussi.
-Je vais essayer d'aller à l'école.
-Bien. Vraiment bien. Quoi encore?
-Peut-être que je vais essayer d'être plus patient avec les crétins.
-Bien. Et quoi d'autre?
-Je ne sais pas. Peut-être que je vais essayer de ne pas tout gâcher en étant si émotif.
-Autre chose?
-Je vais essayer d'être plus gentil avec maman.
-Et?
-Ca suffit pas?
-Si. Ca suffit amplement. Maintenant, il faut que je te demande comment tu penses accomplir toutes ces choses?
-Je vais enfouir mes sentiments profondément en moi.
-Comment ça, enfouir tes sentiments?
-Même si je ressens les choses très très fort, je ne laisserai rien sortir. Si je dois pleurer, je pleurerai à l'intérieur. Si je dois saigner, je me ferai un bleu. Si mon coeur commence à s'affoler, je n'en parlerai à personne au monde. Ca ne sert à rien. Ca ne fait que rendre la vie de tout le monde plus difficile.
-Mais si tu enfouis tes sentiments profondément, tu ne seras plus réellement toi, non?
-Et alors?
-Je peux te poser une dernière question?
-C'était celle-là?
-Crois-tu que quoi que ce soit de bien puisse sortir de la mort de ton père?
-De bien? Est-ce que je crois que quelque chose de bien peut sortir de la mort de mon père?
-Oui. Crois-tu que quoi que ce soit de bien puisse sortir de la mort de ton père?
J'ai renversé ma chaise d'un coup de pied, jeté tous ses papiers par terre et hurlé:
-Non! Bien sûr que non, espèce de sale con!
Ca, c'était ce que j'avais envie de faire. Au lieu de quoi, j'ai seulement haussé les épaules.
-En fait, je ne suis pas votre bonhomme.
-Oui, bon. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, tu ne trouves pas? Si tu veux, on peut sortir taper un peu dans le ballon.
-Est ce que je trouve qu'il fait un temps magnifique, oui. Est ce que je veux sortir taper dans le ballon, non.
-T'es sûr?
-Le sport n'est pas passionnant.
-Qu'est ce que tu trouves passionnant?
-Quel genre de réponse cherchez-vous?
-Qu'est ce qui te fait croire que je cherche quelque chose?
-Qu'est ce qui vous fait croire que je suis le dernier des crétins?
-Je ne crois pas du tout que tu sois le dernier des crétins. Je ne te trouve pas crétin du tout.
-Merci.
-D'après toi, pourquoi es-tu ici, Oskar?
-Je suis ici, docteur, parce que ma maman est inquiète que la vie me mette devant des difficultés insurmontables.
-Est-ce qu'elle a raison de s'inquiéter?
-Pas vraiment. La vie est une difficulté insurmontable.
-Quand tu dis "difficulté insurmontable", à quoi penses-tu?
-Je suis sans arrêt victime de mes émotions.
-Tu en es victime, là, en ce moment?
-J'en suis extrêmement victime, là, en ce moment.
-Quelles sont les émotions que tu ressens?
-Toutes.
-Mais encore?
-Là, en ce moment, je ressens de la tristesse, du bonheur, de la colère, de l'amour, de la culpabilité, de la joie, de la honte, et un tout petit peu d'humour parce qu'une partie de mon cerveau se rappelle quelque chose de tordant que Dentifrice a fait un jour et dont je ne peux pas parler.
-Ca fait vraiment beaucoup.
-Il a mis du laxatif dans les pains au chocolat qu'on vendait à la fête du club de français.
-Je reconnais que c'est drôle.
-Je ressens tout.
-Cette émotionnalité, est-ce qu'elle affecte ta vie quotidienne?
-Pour répondre à votre question, je crois que ce mot n'existe pas. Emotionnalité. Mais je comprends ce que vous essayez de dire, et, oui, je pleure beaucoup, le plus souvent quand je suis tout seul. C'est extrêmement dur pour moi d'aller à l'école. Et aussi, je ne peux pas dormir chez des amis parce que je panique à l'idée d'être loin de maman. Je m'y prends mal avec les gens.
-Et d'après toi, que se passe-t-il?
-Je ressens trop de choses. Voilà ce qui se passe.
-Tu crois qu'on peut ressentir trop? Ou alors qu'on ne ressent pas comme il faudrait?
-Mes intérieurs ne collent pas avec mes extérieurs.
-Et ce n'est pas le cas de tout le monde, tu crois?
-J'en sais rien. Je ne suis que moi.
-Peut-être que c'est justement la personnalité de chacun, cette différence entre l'intérieur et l'extérieur.
-Mais pour moi, c'est pire.
-Je me demande si tout le monde n'a pas cette impression.
-Probablement. Mais pour moi, c'est vraiment pire.
Il s'est redressé sur son fauteuil et il a posé son stylo sur le bureau.
-Je peux te poser une question très personnelle?
-On est en république.
-As-tu remarqué des petits poils sur ton scrotum?
-Scrotum?
-Le scrotum est le petit sac à la base de ton pénis qui contient tes testicules.
-Mes couilles.
-C'est ça.
-Passionnant.
-Vas-y, ne te gêne pas, réfléchis une seconde. Je peux me retourner si tu veux.
-Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je n'ai pas de petits poils sur le scrotum.
Il a écrit quelque chose sur un bout de papier.
-Docteur?
-Appelle-moi Howard.
-Vous m'avez dit de vous dire quand j'étais gêné.
-Oui.
-Je suis gêné.
-Excuse-moi. Je sais que c'était une question très personnelle. Je l'ai posée seulement parce que parfois, quand notre corps change, nous éprouvons des changements spectaculaires dans notre vie émotionnelle. Je me demandais si, par hasard, une partie de ce que tu vis n'était pas due à des changements dans ton corps.
-La réponse est non. C'est dû à ce que mon père est mort de la mort la plus horrible que quiconque ait jamais pu inventer.
Il m'a regardé et je l'ai regardé. Je me suis promis que je ne serais pas le premier à détourner les yeux. Mais, comme d'habitude, j'ai été le premier.
-Un petit jeu, ça te dirait?
-Est-ce que c'est un casse-tête?
-Pas vraiment.
-J'aime bien les casse-tête.
-Moi aussi. Mais ce n'en est pas un.
-Pas de bol.
-Je vais dire un mot et je veux que tu me dises la première chose qui te viendra à l'esprit. Ca peut être un autre mot, le nom de quelqu'un, ou même un bruit. Tout ce que tu voudras. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pas de règle. Tu veux bien qu'on essaie?
-Allez-y.
Il a dit:
-Famille
J'ai dit:
-Famille.
Il a dit:
-Excuse-moi, j'ai l'impression que je n'ai pas bien expliqué. Quand je dis un mot, tu me dis la première chose qui te passe par la tête.
-Vous avez dit "famille", et la première chose qui m'est passée par la tête c'est famille.
-Bien, mais essayons de ne pas utiliser le même mot. D'accord?
-D'accord. Heu, pardon, oui.
-Famille.
-Flirt poussé.
-Flirt poussé?
-C'est quand un homme frotte le ginva d'une femme avec les doigts, c'est bien ça?
-Oui, c'est ça, d'accord. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Mais pourquoi pas sécurité?
-Pourquoi pas.
-D'accord.
-Oui.
-Nombril.
-Nombril?
-Nombril.
-Je ne peux penser à rien d'autre que nombril.
-Allons essaie. Nombril.
-Nombril ne me fait penser à rien.
-Creuse un peu.
-Mon nombril?
-Ton cerveau, Oskar.
-Heu....
-Nombril. Nombril.
-Anus de l'estomac?
-Bien.
-Mal.
-Non, j'ai dit "bien". Ta réaction est bien.
-Ma réaction est bonne.
-Bonne.
-Bonbonne.
-Fêter.
-Ouaf Ouaf!
-C'était un aboiement?
-Bref.
-D'accord. Génial.
-Oui.
-Sale.
-Nombril.
-Mal à l'aise.
-Extrêmement.
-Jaune.
-La couleur du nombril d'une personne jaune.
-Essayons de répondre par un seul mot, tu veux bien?
-Pour un jeu qui n'a pas de règles, ça fait beaucoup de règles.
-Blessé.
-Réaliste.
-Concombre.
-Formica.
-Formica?
-Concombre?
-Foyer?
-Là où on a ses affaires.
-Urgence.
-Papa.
-Ton père est la cause de l'urgence ou sa solution?
-Les deux.
-Bonheur.
-Bonheur. Heu, pardon.
-Bonheur.
-Je sais pas.
-Essaie. Bonheur.
-Chaipas.
-Bonheur. Creuse.
J'ai haussé les épaules. Bonheur, bonheur.
-Docteur?
-Howard.
-Howard?
-Oui?
-Je suis gêné.
On a passé le reste des 45 minutes à parler alors que j'avais rien à lui dire. J'avais pas envie d'être là. J'avais envie d'être nulle part sauf à chercher la serrure. Quand il a été presque l'heure que maman rentre, le Dr Frein a dit qu'il voulait qu'on fasse un projet pour que la semaine prochaine soit meilleure que la précédente.
Il a dit:
-Et si tu me disais les choses que tu penses pouvoir faire, des choses à ne pas oublier. Comme ça, la semaine prochaine, on verra si tu as réussi.
-Je vais essayer d'aller à l'école.
-Bien. Vraiment bien. Quoi encore?
-Peut-être que je vais essayer d'être plus patient avec les crétins.
-Bien. Et quoi d'autre?
-Je ne sais pas. Peut-être que je vais essayer de ne pas tout gâcher en étant si émotif.
-Autre chose?
-Je vais essayer d'être plus gentil avec maman.
-Et?
-Ca suffit pas?
-Si. Ca suffit amplement. Maintenant, il faut que je te demande comment tu penses accomplir toutes ces choses?
-Je vais enfouir mes sentiments profondément en moi.
-Comment ça, enfouir tes sentiments?
-Même si je ressens les choses très très fort, je ne laisserai rien sortir. Si je dois pleurer, je pleurerai à l'intérieur. Si je dois saigner, je me ferai un bleu. Si mon coeur commence à s'affoler, je n'en parlerai à personne au monde. Ca ne sert à rien. Ca ne fait que rendre la vie de tout le monde plus difficile.
-Mais si tu enfouis tes sentiments profondément, tu ne seras plus réellement toi, non?
-Et alors?
-Je peux te poser une dernière question?
-C'était celle-là?
-Crois-tu que quoi que ce soit de bien puisse sortir de la mort de ton père?
-De bien? Est-ce que je crois que quelque chose de bien peut sortir de la mort de mon père?
-Oui. Crois-tu que quoi que ce soit de bien puisse sortir de la mort de ton père?
J'ai renversé ma chaise d'un coup de pied, jeté tous ses papiers par terre et hurlé:
-Non! Bien sûr que non, espèce de sale con!
Ca, c'était ce que j'avais envie de faire. Au lieu de quoi, j'ai seulement haussé les épaules.
Sur mes frêles épaules à moi, Oscar avait lu en même temps, malgré les tremblements. Il était outré. Je voulais lui jurer que je n’avais jusqu’à alors jamais eu vent de ce personnage, de cet Arnaud jeune, de cet Arnaud mieux, et je savais qu’il n’en croirait rien ou que ça ne suffirait pas à consoler l’immense peine qu’il ressentait devant la constatation la plus terrible qu’on puisse être amené à faire: sa vie existait déjà en puissance 2. Elle était reliée, elle était publiée, elle était plus forte, plus belle, mieux écrite que la sienne; et sa créatrice préférait celui qui l’incarnait à celui qu’elle avait elle-même fabriqué. J’aurais aimé pouvoir le serrer dans mes bras, mais chacun sait qu’un personnage de roman n’est pas palpable, pas humain, pas solide. Chacun le sait mais je le réalisais pour la première fois, Arnaud n'avait pas de consistance, je ne trouvais pas son corps en brassant l'air alentour. Ca m’a foutu un coup, comme on dit. Plus d’un, peut-être même. Toutes ces émotions en si peu de temps. Je me demandais tout à fait pourquoi je m’étais jetée dans cette aventure, manifestement trop musclée pour moi, et ce qui m’avait convaincue de croire être d’attaque, pour ça, «écrire un roman».
Après un fou rire inextinguible et pour le moins nerveux, je chialais un moment. Trois ou quatre secondes, par là. Histoire de faire le tour du bordel une bonne fois pour toutes et qu’on n’en parle plus.
Après un fou rire inextinguible et pour le moins nerveux, je chialais un moment. Trois ou quatre secondes, par là. Histoire de faire le tour du bordel une bonne fois pour toutes et qu’on n’en parle plus.
Si Jonathan Safran Foer tenait un blog, la chose la plus belle du monde (avec la viande rouge gratuite à volonté et la résurrection de Marilyn Monroe) serait qu’un de ses billets commence par «Je vous ai déjà parlé de Manon Troppo?». Mais ça ne se fera pas. A moins d’être suivi de «C’est une connasse qui s’est prise pour moi, nom de dieu, que fait la police!» ou ce genre de mots doux.
Je sais que tout a déjà été dit, je sais que je n’écrirai jamais rien d’unique, je sais, je sais que quelqu’un a sûrement déjà dit ça aussi, oui, et, d'une plus jolie façon, certainement; pourtant, il va bien falloir que j’essaie.
-maispastrop-
*bisou Sened.
**ça boum, le Dhab?
**ça boum, le Dhab?
C’est une triste maladie que de manquer d’imagination. La pire, peut-être. Un microbe qu’il ne faut pas laisser s’installer, jamais.
Un virus ingrat et insidieux qui s’attaque à mes faibles défenses immunitaires 3... 4 fois par an. Et pas seulement quand il fait froid. Ca se répartit équitablement, printemps, été, automne, météo, comme ça. Ca fait bien son boulot. L’hiver, peut-être, aussi, parfois; c’est plus rare; l’hiver tout le monde rêvasse sous la couette, on se raconte des histoires autour d’un chocolat chaud et on se love dans la chaleur qu’un corps sur le départ a laissée dans le lit pour se rendormir. Mais l’hiver, aussi, peut-être, lors des mauvais crus arides et des mauvaise crues débordantes, je sèche; peut-être bien, ouais.
C’est au printemps, cependant, que ma tête brasse le plus d’air. Et attrape froid, dans les courants. Ce printemps, tiens. Et tout le monde se réjouit du bientôt beau temps, tout le monde s'enthousiasme du presque grand soleil, personne parle plus de rien, je m’assèche. Et le pastis n’y changera rien.
Ca ponctue le calendrier. Quatre fois l’an, comme ils disent, y’a les visites chez le gynécologue, et ça.
Périodes pendant lesquelles tout me paraît affreusement concret puisque je suis incapable d’imaginer une danse derrière un geste, de comprendre l’homme derrière un enfant, d’entendre un orchestre derrière les embouteillages. Et l’inverse. Ou l’inverse.
Je ne vois que le geste; l’enfant. Je n’entends que les klaxons. Ca pue les pots d’échappement. Je suis affreusement terre à terre, alors.
Et il est difficile de dire à quel point la vie manque de charme quand nous n’y voyons que ce qu’il y a à y voir.
On ne peut pas lire l’intitulé de l’interrogation sur le tableau vert, ni même la date écrite en toutes lettres.
Si je veux bien croire qu’on triche toujours, je ne pensais pas qu’on utilisait encore des effaceurs, de nos jours. Enfin, de «leurs» jours. Et qu’on les faisait tourner, comme je faisais. Moi j’arrivais même à le faire tourner dans un sens et puis le faire repartir à nouveau dans l’autre. Je ne savais faire que ça, en fin de compte, au fil des cours. Mais, attention, ça m’avait demandé des années de cancre.
Je croyais que les effaceurs, c’était réservé aux mots écrits au stylo à plume. Il existe peut-être un gros malin qui a inventé un effaceur pour l’encre des bic. Ou un effaceur qui n’efface rien mais qui écrit bien alors ils achètent tous. Ce gros malin doit être riche à ne plus savoir que foutre de ses royalties à l’heure qu’il est. Si ça se trouve, il est même devenu trop-riche-trop-vite, si bien qu’après avoir acheté des résidences secondaires et des amis de substitution en veux-tu en voilà, il a commencé à devoir s’intéresser à ce qui lui donnerait l’énergie de tenir aussi longtemps que les soirées qu’il organise le lui demande. Il doit être gros et un peu dépressif. Ou dépressif et un peu gros. Ou très maigre.
Il a du vieillir d’un coup. Sa famille ne le reconnaît sûrement plus. D’ailleurs, il s’en fout, il s’est trouvé une nouvelle famille. Celle de ceux qui ont gagné trop-d’argent-trop-vite et que leur famille ne reconnaît plus.
Je me demande s’il y a dans cette classe, dans ce cours de... -si j’en crois ma bonne vue-... français, une tête pensante dans le genre. Un débrouillard trop flemmard pour apprendre ses leçons mais assez ambitieux pour observer ses camarades de classe et en tirer parti. Enfin, non, pas ses camarades: ses voisins. On dit toujours «camarades de classe» même pour définir les pires connards à qui on a rêvé de démonter la mâchoire pendant toute notre scolarité.
Il observerait ses voisins en se disant, «tiens, qu’est ce qu’il nous manque, à nous?» et, peut-être, il inventerait le concept des effaceurs qui n’effacent rien ou des soirées pour ados. J’dis ça parce qu’un jeune con a véritablement inventé le concept des soirées pour ados. Résultat, il se retrouvait aux soirées pour adultes avec des sachets d’herbe et de poudre plus grands que lui; qu’on lui chapardait, d’ailleurs, et qu’on dispersait dans des pays d’excès où il n’avait pas le droit de rentrer.
Depuis ma fenêtre, j’me demande s’il y a ce genre de personnage dans cette triste classe.
Parce qu’elle est triste, hein, cette classe.
J’y avais pas pensé jusque là, mais une salle de cours, c’est affreusement disgracieux.
A croire que tout est fait pour déprimer pour de bon les élèves. A part le hall de gare de Perpignan, je vois pas plus maussade et impersonnel que cette pièce dans laquelle ils vont pourtant passer la moitié de leur année. Et de leur vie de mioches, finalement. Même leur chambre amoureusement postérisée, ils la fréquenteront moins.
Un amas de tables et de chaises de bois pauvre, sinon d’aggloméré, cet alignement ridicule, ces rideaux, ahlala, ces rideaux rêches et épais, ces tissus aux presque-couleurs-pas-abouties toujours plus déprimantes. Une sorte de rouge brique kaki. Qui a bien pu avoir l’idée de créer des rideaux de classe rouge-brique-kaki? Combien ce type a été payé pour ça? Ce tissu granuleux. Qui a bien pu avoir l’idée de créer des rideaux de classe rouge-brique-kaki rugueux.
Et nauséabonds.
Rideaux qui cachent à peine des fenêtres mal lavées, sur lesquelles on laisse s’incruster les traces de cuirs chevelus grassement adolescents, assoupis et assommés contre la vitre par ennui ou pas manque de nuit.
Les chaises toujours bancales. Ca rate jamais: à toutes, il manque au moins 1 des 4 tampons anti-dérapants. Alors ça crisse et ça brinquebale. Comme si c’était déjà pas assez branlant là dedans sous le cuir chevelu adipeux. Et les tables, sur lesquelles on n’a même plus le droit de graver pour toujours et à la vie à la mort, qu’on aime machine, que truc est trop beau et que 1 + 1 égale toi et moi, même si c’est pas vrai ou si c’est recouvert par d’autres.
Et c’est sans parler de la plante. Y’a toujours une plante dans une salle de cours. Une sorte de bonne conscience, j’imagine. J’veux dire, ça ne peut raisonnablement pas être installé là par souci d’esthétisme ou de bien-être. Si des gens se souciaient de l’esthétisme ou du bien-être des salles d’école, ça se saurait. Ca se verrait surtout.
Ca ne peut pas non plus exister rapport à l’oxygène ou au dioxyde de carbone, ou alors les profs de bio seraient tous virés manu militari. Et d’ailleurs, en parlant d’oxygène, tout, et principalement les profs et les rideaux, serait à revoir. Et serait revu, si l’idée était de rendre l’endroit accueillant.
J’en doute, là, tout de suite, je suis pas convaincue.
Donc, une plante, comme ça, hop, bon. Une sorte de restes de la motivation du premier jour gonflé d'énergie d’un professeur optimiste. Vite décrépies. La plante. Et la motivation.
Il arrive même qu’on trouve un poisson rouge, à côté du ficus.
Le truc le plus joli qu’on trouve dans une salle de cours, exceptés la prof d’anglais stagiaire ou le pion des heures de colle, c’est certainement une carte du monde, ou de la France, mettons. Laissée là depuis toujours, on croirait; y’a même des régions dont les noms ont changé, les fleuves ont grandi, ou séché, les départements sont nés, depuis. On a peut-être même délimité les pays d’Afrique à l’équerre, entre temps.
Pour eux aussi, certainement, aujourd’hui, là, pendant que que je suis à ma fenêtre en les contemplant. Certainement.
Mais je n’ai pas d’imagination en ce moment. Alors je ne vois qu’une salle austère remplie d’insolents boutonneux. Et je referme ma fenêtre devant laquelle les pauvres, pauvres platanes peinent à bourgeonner.
Qu’ils vivent leurs vies et moi la mienne, ces mioches. Ils font tout de même partie de la génération qui donne de l’argent à Justin Bieber, je vous signale. Faudrait être l’Abbé Pierre pour trouver à ces trucs là un centimètre de raison d’être.
Il se trouve que l’Abbé Pierre est mort. Bon.
Ce que je ne sais pas, c’est qu’un insolent boutonneux m’a vue, moi, ouvrir mes fenêtres pour me pencher sur son cas le temps d’une cigarette. Et il s’est imaginé que j’étais une sorte de mondaine, qui traînait chez elle à fumer en plein milieu de l’après midi. Sa mère, à cette heure là, elle répond à 4 coups de fils en même temps et elle fait visiter autant d’appartements que ses mains peuvent ouvrir de portes. Je suis forcément une mondaine entretenue, moi, alors. En plus, je suis même pas vraiment habillée. Si ça se trouve, je suis carrément une pute, tiens. D’ailleurs, via une feuille clairefontaine A4 pliée en 8, il s’empresse d’en parler à son voisin et néanmoins camarade. Ils décident qu’ils se renseigneront sur mon cas, ils peuvent pas laisser ce mystère non élucidé. Et puis c’est toujours autant de temps qu’il n’auront pas passé à écouter cette prof au bord du suicide. C’est déjà ça.
C’est toujours au bord du suicide, les profs de Français. C’est pour ça qu’on les aime. Enfin, c’est pour ça qu’on les aime après. C’est toujours ça.
Mais je n’ai pas d’imagination en ce moment, aussi ne puis-je pas concevoir que d’autres en aient, et quand je sors acheter ma dose quotidienne de nicotine, je ne remarque pas que c’est l’heure de la fin des cours. Les queues devant les boulangeries ont beau faire le tour de la ville, je ne comprends pas non plus pourquoi 2 mioches mal habillés me suivent en pouffant.
Honnêtement, les jeunes, c’est du ridicule sur pattes quoi.
Pour eux, je suis une chose qu’ils ne comprennent pas et qu’ils vont suivre jusqu’au supermarché pour voir si elle se nourrit; et de quoi. Si elle utilise une carte bleue, ou si elle sort un billet de 20 d’une énorme liasse cachée dans un journal. Rapport à la prostitution suspectée et les séries américaines, tout ça.
Pour moi, ils sont une présence gênante, j’aimerais être tranquille maintenant. Et toujours.
Pour eux, agités devant l’éternité, derrière mon geste, il y a une danse; derrière un bruissement d’ailes, un oiseau. Derrière ma distance, un mystère. En me suivant un peu en retard, ils font freiner les voitures sur le passage piéton, et ça klaxonne. Ils sont les fanfarons de cette fanfare, ils entendent l’orchestre pendant que j’ai seulement mal à la tête.
Sérieux, les jeunes, c’est la tannée quoi.
Voilà qu’ils gambadent en me dépassant maintenant. Je ralentis. Je suis curieuse de savoir comment ils vont mener la fin de leur enquête.
Ils ralentissent aussi.
Soit.
Je m’arrête.
Ils s’arrêtent aussi.
Soit.
Je me demande si en me mettant à pisser cul nu en récitant les capitales du monde et en me curant le nez, là tout de suite dans la rue, je les verrais me singer aussi bêtement que leur âge l’impose.
Je m’arrête complètement en me disant que le peu de capitales qu’ils connaissent sont celles qu’on voit sur les t-shirts qui les <3. Et qu’ils ne savent même pas que c’est pas une capitale, New York Empire State of Mind.
Start spreading the news, dumbass, que j’me dis. Et je me fige quand même vers eux, le menton un peu relevé, l’air passablement provocatrice.
-Bon, on fait quoi maintenant?
Bien entendu, ils feignent ne pas m’avoir entendue. Ils arrêtent de parler, se regardent en écarquillant leurs globes oculaires grand comme ça, comme ça, et essaient de reprendre une conversation tout en gloussant, l’air de pas être là et de pas faire ce qu’ils font, ces trous du cul.
Ils daignent tourner la tête vers moi.
-Voilà. Bon. Donc, on fait quoi, maintenant, disais-je.
Tout répéter, convaincre, être patiente. Ca vous fait perdre un temps, ces animaux là... Un calvaire.
-Bin.
-Bin?
-Bin rien.
-Comment ça, rien?
-Chais pas, rien.
-Rien, c’est pas possible.
-...
-Je dis pas qu’on doit décider d’un resto où manger ensemble ou quoi, je préférerais mourir que de connaître vos goûts culinaires, mais on doit faire quelque chose entre continuer la filature ou l’arrêter. C’est de ça que je parle.
-La fila quoi?
-La filature.
-De quoi?
-Vous savez ce que «filature» veut dire.
-Bin.
-Bin?
-Bin nan.
-Alors pourquoi en faites vous une?
-Nous?
-Oui, vous. Allô. Youhou. Wake up. Vous me suivez = vous faites une filature.
-Ah. Aaaaah, ok.
-Oui, «ah». On devrait jamais avoir le droit de faire quelque chose dont on ne connaît même pas le nom. C’est comme la sociologie. C’est ridicule, votre vie, sérieux, ça me fait pitié. (Je dis «pitié» comme si le mot pesait plus lourd que les autres, dans ma bouche, au fait, et qu’il me fallait faire peser plus lourd chaque lettre)
-Bin au moins on sait qu’une fille à sa fenêtre en plein milieu de la journée c’est une entretenue hein.
-Mais, ça, c’est pas une action que VOUS faîtes.
-Bin.
-Bin non. Cause que vous, si vous vouliez justement être entretenus, faudrait déjà que vous soigniez cette vilaine peau, comme dit lot’, et que vous achetiez des jeans à votre taille. Sans ça, je donne pas cher de votre carrière.
-Ouais d’accord ouais. ... Quel «ot’»?
-Non mais ok, ok, je suis la vieille, vous êtes les jeunes, ok, mais y’a quoi comme action que vous faîtes dont vous connaissez le nom? Hein?
Je sors une cigarette, rapport au fait que finalement, oui, j’ai envie d’entendre absolument leurs arguments hyper cons. En fumant.
-Genre marcher ça fait la marche?
Il sort son briquet.
-Genre ça ouais, j’dis, en attendant que la nicotine rentre.
-Bin...
-Bin?
-Enculer, ça fait la sodomie.
-Super, et sucer, ça fait la fellation, d’accord. Mais à part des trucs de morveux prépubères?
-...
-Et t’as déjà enculé quelqu’un? Tu t’es déjà fait sucer? Tu parles que de trucs que tu fais pas? Tu veux qu’on cause du yoga en 69 en saut à l’élastique au Pérou peut-être?
Et j’imagine, en le disant, que ça n’existe pas, mais qu’il faudrait que j’en parle à 2,3 personnes tout de même.
Il rougit et sort un briquet, va pour l’allumer et n’y arrive pas. Il se trouve qu’il tremble. J’allume ma cigarette toute seule avec son briquet à lui, et ça m’énerve d’imaginer que je rentre là dans une scène de grande dadame face à ces petites crottes de peteux. Faut que j’arrête de fumer, sérieux. Faut qu’ils grandissent, please.
-Mais, c’est vrai que les ados ils leur faut beaucoup de temps pour comprendre qu’on a changé de sujet?
-Les entretenues, elles répondent jamais directement aux questions.
-Personne ne répond jamais directement aux questions.
-Pourquoi?
-Bin...
-Ah vous dites «bin» vous aussi?
-Non mais. Parce que sans ça, on s'ennuierait à mourir. Sans ça, je devrais vous répondre que, non, je suis pas une entretenue, et votre f.i.l.a.t.u.r.e. perdrait toute raison d’être, et alors vous vous sentiriez aussi cons que vous l ‘êtes et on n’aurait plus aucune raison de se parler alors que bon.
-Bon?
-Bin. Bon. On se parle tous toujours un peu sur des malentendus. C’est joli.
-...Ah ouais.
-Non mais attendez on n’est pas obligés de parler. C’est vous qui m’avez suivie.
J’écrase ma cigarette. Avec mon pied, même.
-Bin, oui. Mais bon.
-Parfait, je crois qu’on a atteint la fin de notre conversation. On peut maintenant se dire au revoir et retourner à nos occupations. Vous, le biactol, moi, les capotes, tout ça tout ça, quoi.
-...Vous écrasez vachement bien votre cigarette.
-...
-Un ange passe.
-(m’étouffant) Non! on dit encore «un ange passe» à votre âge? Arrêtez!
-Quoi notre âge?
-Quoi notre âge, ouais? (Là c’est le deuxième boutonneux qui parle, et pour la première fois).
-Bin, votre âge quoi. Pourquoi t’as rien dit jusqu’à maintenant, toi?
-Il aime pas parler.
-Ah je vois. T’as décidé qu’il aimait pas parler parce que toi t’aimes parler. Du coup il parle jamais et quand il parle tu dis qu’il aime pas ça comme ça, toi tu peux..
-(me coupant)N’importe quoi. N’IMPORTE QUOI.
-N’IM-POR-TEUH-QUOI (Là c’est le deuxième boutonneux qui parle pour la deuxième et finalement seconde et donc dernière fois)
Dit-il en se balançant sur ses pieds et en tripotant ses boutons. Et sa mèche.
-Ok. Cette phrase n’a absolument aucune syntaxe, mais j’vais faire comme si je l’avais comprise.
-On n’est pas des bébés. On n’est pas des demeurés.
-J’ai pas dit ça.
-Ouais mais bon.
-Ok, pas de problème.
-Non mais on a bien vu que vous nous preniez pour des bébés.
-...
-Bin, quoi? C’est pas vrai p’t’être?
- Je sais pas. J’en sais rien. Vraiment, je sais pas.
- Bin demandez nous.
-Demander quoi?
-Si on est des bébés.
Voilà que je ressors une cigarette.
-Ok. Heu.Voyons... Ah. Ok: Est-ce que vous avez déjà arraché des ailes à une mouche?
-Pfff, quel rapport?
Il ressort son briquet. L’autre est toujours à l’écart.
-Rapport au côté bébé.
-Pfff, bin ouais.
-Et Pfffff. Donne moi ton feu. Et re-Pfffff.
J'allume ma cigarette avec son bic et cette fois, oui, clairement, pas de pitié, je me le range dans ma poche à moi.
-Ok quoi? C’est quoi le problème, quel rapport?
-Le rapport c’est «Pourquoi faire?»
-Pourquoi faire quoi?
-Rhaaaaa, pourquoi faire «arracher des ailes à des mouches» Einstein!
-Bin pffff.
-Pfff, quoi?
-Pour voir si elle volait, tiens.
-Cause que tu penses que si une mouche qui passe son temps à voler, quand tu lui enlèves ses ailes, tu peux enfin réaliser qu’elle avait des ailes pour voler, c’est ça?
Je ris d’une façon qui peut être un peu méprisante, c’est vrai.
-Quoi?
-Quoi, quoi?
-Bin, la mouche trouduc.
-Bin j’voulais voir.
-Ce que tu savais déjà?
-Bin.
Ras le bol des «bin». Alors, oui, Bébés. Bébés Cadum. Rejetons. Boutonneux. Puceaux. Castra. Petites bites. Frimeurs. Baltringues. Oui.
-Non mais, j’ai juste enlevé les ailes pour voir si ... ... si ça marchait. Je sais pas.
-Tu vois toi même en le disant que c’est ridicule et que ça n’a pas de sens.
-Mais je veux pas vous vexer!
-Mais, je suis pas une mouche!
-Non mais je veux pas que vous pensiez que... tout ça.
-Je pense rien. Merci pour le briquet. A bientôt.
-Quoi?
Je pars, un peu, en essayant de me rappeler où est le supermarché et en me disant, pour plus tard, que je ne parlerai plus jamais à quelqu’un dans un quartier qui n’est pas le mien.
Pour ne pas oublier ce que je devais faire.
Que je ne parlerai plus jamais à quelqu’un qui a encore des boutons. Pour ne pas oublier qui nous sommes.
Les petits morveux me dégoûtent.
-Oui. («oui» très lassé, hein)
-Vous êtes formidable.
-Super.
-Non mais vous avez quel âge?
-Comment ça. Ho. Ca vous regarde pas. J’en sais rien.
-Vous avez 20 ans non? C’est sûr. Vous avez 20 ans. 21?
Ma tête formule des trucs, des idées, des pensées aussi, je sais jamais vraiment quel âge j’ai, dans la vie, je suis toujours à 2,3 ans d’écart de mon certificat de naissance. Mais ça, je sais que non, j’ai pas 20 ans, non. «T’as vu mon foie», j’ai envie de lui dire. Et finalement, je lui réponds:
-Non. Non, j’ai 29 ans. Ou 28. Je sais plus.
-N’importe quoi.
-Si, si, je suis née en 82.
Silence de cimetière.
-Bon, ça va, 82 de 1900 hein. Je suis pas en talc non plus, ho.
-Ouais mais 82 quand même. Je vous crois trop pas. Vous avez 24 ans! Mais oui, 24 ans.
-Comme tu voudras.
-...
-...
-Si c’est pas une réponse d’entretenue, ça.
-Oh, dégage. Et pour de bon, là. Allez. Ouste.
Mais j’ai ri quand même, soulagée d’entendre enfin quelque chose d’un peu perspicace dans sa bouche.
Il m’a suivie jusqu’au tabac. Il se cachait derrière des brindilles. Il laissait voir ses yeux malicieux. Malins? Son ami était rentré. J’ai vu son ombre avant de passer la porte. Et, il regardait à ma fenêtre pendant l’explication de texte de Flaubert le lendemain. Il était le seul à ne pas mortellement s'ennuyer.
Les heures passent trop lentement pour eux, et les années trop vite. Pour moi.
Si derrière lui, je devrais voir un homme, peut-être que derrière moi, il voit une gosse. C’est possible. Ca a tellement d’imagination, à c’t’âge là, ces imbéciles.
Il a laissé un mot, à la concierge, un jour plus tard. Ca disait «Hey Missise Robinson Ouide Like Too Now a Liteulle Beat Of You files»
J’ai un début de ride sur le front, j’ai vu ça ce matin, je sais que c’est à cause de mon étonnement perpétuel et de ma perplexité quotidiennement passagère. Je le sais. Il n' y pas d’autre explication, j'imagine.
Jamais, tu m'entends?
Un virus ingrat et insidieux qui s’attaque à mes faibles défenses immunitaires 3... 4 fois par an. Et pas seulement quand il fait froid. Ca se répartit équitablement, printemps, été, automne, météo, comme ça. Ca fait bien son boulot. L’hiver, peut-être, aussi, parfois; c’est plus rare; l’hiver tout le monde rêvasse sous la couette, on se raconte des histoires autour d’un chocolat chaud et on se love dans la chaleur qu’un corps sur le départ a laissée dans le lit pour se rendormir. Mais l’hiver, aussi, peut-être, lors des mauvais crus arides et des mauvaise crues débordantes, je sèche; peut-être bien, ouais.
C’est au printemps, cependant, que ma tête brasse le plus d’air. Et attrape froid, dans les courants. Ce printemps, tiens. Et tout le monde se réjouit du bientôt beau temps, tout le monde s'enthousiasme du presque grand soleil, personne parle plus de rien, je m’assèche. Et le pastis n’y changera rien.
Ca ponctue le calendrier. Quatre fois l’an, comme ils disent, y’a les visites chez le gynécologue, et ça.
Périodes pendant lesquelles tout me paraît affreusement concret puisque je suis incapable d’imaginer une danse derrière un geste, de comprendre l’homme derrière un enfant, d’entendre un orchestre derrière les embouteillages. Et l’inverse. Ou l’inverse.
Je ne vois que le geste; l’enfant. Je n’entends que les klaxons. Ca pue les pots d’échappement. Je suis affreusement terre à terre, alors.
Et il est difficile de dire à quel point la vie manque de charme quand nous n’y voyons que ce qu’il y a à y voir.
L’appartement où il m’arrive de rôder donne sur une école. C’est à dire que, non, ça n’est pas vraiment une école, plus tout à fait, puisque c’est un collège.
Depuis les fenêtres, au 2° étage, on peut admirer, en contre-plongée, les crânes hirsutes baissés sur les copies; parfois, on croise les regards rêveurs qui essaient d’attraper un bout de ciel; mais la plupart du temps, à cause du contre-jour, on ne peut qu’apercevoir. Apercevoir seulement les silhouettes. On ne peut même pas lire l’intitulé de l’interrogation sur le tableau noir. Vert, en fait. On dit toujours «tableau noir» pour parler d’un tableau qui n’existe plus, celui d'aujourd'hui vire au verdâtre un peu british qu’ont les plumes des canards au bois de Vincennes. Et ailleurs, si ça se trouve. On ne peut pas lire l’intitulé de l’interrogation sur le tableau vert, ni même la date écrite en toutes lettres.
Si je m’en tiens à ce que je vois, j’arrête aussitôt de regarder, ça n’a en effet pas grand intérêt; l’occupation ressemblerait même tout à fait à ce qu’on peut appeler une sacrée perte de temps. Or, le temps, c’est ce que vous savez.
Et puis, si je porte tout de même un peu plus d’attention aux détails, j’arrive à distinguer un effaceur qu’une main distraite fait tourner sur elle-même dans une chorégraphie millimétrée, grâce à la cohésion longuement travaillée du pouce et du majeur; pendant qu’un billet circule sous les tables et qu’un coude se déplace, discrètement mais régulièrement, afin de dévoiler la copie au voisin; voisin dont le regard saute des réponses au surveillant et du surveillant aux réponses avec une souplesse oculaire tout à fait juvénile.Si je veux bien croire qu’on triche toujours, je ne pensais pas qu’on utilisait encore des effaceurs, de nos jours. Enfin, de «leurs» jours. Et qu’on les faisait tourner, comme je faisais. Moi j’arrivais même à le faire tourner dans un sens et puis le faire repartir à nouveau dans l’autre. Je ne savais faire que ça, en fin de compte, au fil des cours. Mais, attention, ça m’avait demandé des années de cancre.
Je croyais que les effaceurs, c’était réservé aux mots écrits au stylo à plume. Il existe peut-être un gros malin qui a inventé un effaceur pour l’encre des bic. Ou un effaceur qui n’efface rien mais qui écrit bien alors ils achètent tous. Ce gros malin doit être riche à ne plus savoir que foutre de ses royalties à l’heure qu’il est. Si ça se trouve, il est même devenu trop-riche-trop-vite, si bien qu’après avoir acheté des résidences secondaires et des amis de substitution en veux-tu en voilà, il a commencé à devoir s’intéresser à ce qui lui donnerait l’énergie de tenir aussi longtemps que les soirées qu’il organise le lui demande. Il doit être gros et un peu dépressif. Ou dépressif et un peu gros. Ou très maigre.
Il a du vieillir d’un coup. Sa famille ne le reconnaît sûrement plus. D’ailleurs, il s’en fout, il s’est trouvé une nouvelle famille. Celle de ceux qui ont gagné trop-d’argent-trop-vite et que leur famille ne reconnaît plus.
Je me demande s’il y a dans cette classe, dans ce cours de... -si j’en crois ma bonne vue-... français, une tête pensante dans le genre. Un débrouillard trop flemmard pour apprendre ses leçons mais assez ambitieux pour observer ses camarades de classe et en tirer parti. Enfin, non, pas ses camarades: ses voisins. On dit toujours «camarades de classe» même pour définir les pires connards à qui on a rêvé de démonter la mâchoire pendant toute notre scolarité.
Il observerait ses voisins en se disant, «tiens, qu’est ce qu’il nous manque, à nous?» et, peut-être, il inventerait le concept des effaceurs qui n’effacent rien ou des soirées pour ados. J’dis ça parce qu’un jeune con a véritablement inventé le concept des soirées pour ados. Résultat, il se retrouvait aux soirées pour adultes avec des sachets d’herbe et de poudre plus grands que lui; qu’on lui chapardait, d’ailleurs, et qu’on dispersait dans des pays d’excès où il n’avait pas le droit de rentrer.
Depuis ma fenêtre, j’me demande s’il y a ce genre de personnage dans cette triste classe.
Parce qu’elle est triste, hein, cette classe.
J’y avais pas pensé jusque là, mais une salle de cours, c’est affreusement disgracieux.
A croire que tout est fait pour déprimer pour de bon les élèves. A part le hall de gare de Perpignan, je vois pas plus maussade et impersonnel que cette pièce dans laquelle ils vont pourtant passer la moitié de leur année. Et de leur vie de mioches, finalement. Même leur chambre amoureusement postérisée, ils la fréquenteront moins.
Un amas de tables et de chaises de bois pauvre, sinon d’aggloméré, cet alignement ridicule, ces rideaux, ahlala, ces rideaux rêches et épais, ces tissus aux presque-couleurs-pas-abouties toujours plus déprimantes. Une sorte de rouge brique kaki. Qui a bien pu avoir l’idée de créer des rideaux de classe rouge-brique-kaki? Combien ce type a été payé pour ça? Ce tissu granuleux. Qui a bien pu avoir l’idée de créer des rideaux de classe rouge-brique-kaki rugueux.
Et nauséabonds.
Rideaux qui cachent à peine des fenêtres mal lavées, sur lesquelles on laisse s’incruster les traces de cuirs chevelus grassement adolescents, assoupis et assommés contre la vitre par ennui ou pas manque de nuit.
Les chaises toujours bancales. Ca rate jamais: à toutes, il manque au moins 1 des 4 tampons anti-dérapants. Alors ça crisse et ça brinquebale. Comme si c’était déjà pas assez branlant là dedans sous le cuir chevelu adipeux. Et les tables, sur lesquelles on n’a même plus le droit de graver pour toujours et à la vie à la mort, qu’on aime machine, que truc est trop beau et que 1 + 1 égale toi et moi, même si c’est pas vrai ou si c’est recouvert par d’autres.
Et c’est sans parler de la plante. Y’a toujours une plante dans une salle de cours. Une sorte de bonne conscience, j’imagine. J’veux dire, ça ne peut raisonnablement pas être installé là par souci d’esthétisme ou de bien-être. Si des gens se souciaient de l’esthétisme ou du bien-être des salles d’école, ça se saurait. Ca se verrait surtout.
Ca ne peut pas non plus exister rapport à l’oxygène ou au dioxyde de carbone, ou alors les profs de bio seraient tous virés manu militari. Et d’ailleurs, en parlant d’oxygène, tout, et principalement les profs et les rideaux, serait à revoir. Et serait revu, si l’idée était de rendre l’endroit accueillant.
J’en doute, là, tout de suite, je suis pas convaincue.
Donc, une plante, comme ça, hop, bon. Une sorte de restes de la motivation du premier jour gonflé d'énergie d’un professeur optimiste. Vite décrépies. La plante. Et la motivation.
Il arrive même qu’on trouve un poisson rouge, à côté du ficus.
J’ai connu ça dans une de mes écoles. Ca avait le don de me rendre tarée à chaque fois que je rentrais dans la pièce. «Ils veulent nous faire croire à un petit coin de paradis ou c’est vraiment et uniquement du foutage de gueule?» que je me demandais. Et puis ça m’inquiétait, toute cette vie laissée à l’abandon une fois les 18 heures sonnées. La décoration vivante, j’ai jamais été pour. J’ai moi-même refusé d’en être, c’est dire.
Le truc le plus joli qu’on trouve dans une salle de cours, exceptés la prof d’anglais stagiaire ou le pion des heures de colle, c’est certainement une carte du monde, ou de la France, mettons. Laissée là depuis toujours, on croirait; y’a même des régions dont les noms ont changé, les fleuves ont grandi, ou séché, les départements sont nés, depuis. On a peut-être même délimité les pays d’Afrique à l’équerre, entre temps.
Malheureusement, le public auquel s’adresse cette fioriture n’est pas à même d’y trouver une once de beauté. Et on peut comprendre ce public pour la bonne raison que nous avons nous-même été ce public. Et que nous n’avions que faire de la vieille et authentique carte de France du fond de la classe d’un cours qu’on séchait tout le temps puisque le seul endroit qui comptait, alors, était notre nombril. Ou sa bouche. Ou sa bouche sur notre nombril. Et le café du coin.
Mais le pays qui nous offrait des rideaux parfumés à la mort tout en nous vendant l'apprentissage de la litote, c’était trop d’ironie pour nous, vraiment. Pour eux aussi, certainement, aujourd’hui, là, pendant que que je suis à ma fenêtre en les contemplant. Certainement.
Mais je n’ai pas d’imagination en ce moment. Alors je ne vois qu’une salle austère remplie d’insolents boutonneux. Et je referme ma fenêtre devant laquelle les pauvres, pauvres platanes peinent à bourgeonner.
Qu’ils vivent leurs vies et moi la mienne, ces mioches. Ils font tout de même partie de la génération qui donne de l’argent à Justin Bieber, je vous signale. Faudrait être l’Abbé Pierre pour trouver à ces trucs là un centimètre de raison d’être.
Il se trouve que l’Abbé Pierre est mort. Bon.
Ce que je ne sais pas, c’est qu’un insolent boutonneux m’a vue, moi, ouvrir mes fenêtres pour me pencher sur son cas le temps d’une cigarette. Et il s’est imaginé que j’étais une sorte de mondaine, qui traînait chez elle à fumer en plein milieu de l’après midi. Sa mère, à cette heure là, elle répond à 4 coups de fils en même temps et elle fait visiter autant d’appartements que ses mains peuvent ouvrir de portes. Je suis forcément une mondaine entretenue, moi, alors. En plus, je suis même pas vraiment habillée. Si ça se trouve, je suis carrément une pute, tiens. D’ailleurs, via une feuille clairefontaine A4 pliée en 8, il s’empresse d’en parler à son voisin et néanmoins camarade. Ils décident qu’ils se renseigneront sur mon cas, ils peuvent pas laisser ce mystère non élucidé. Et puis c’est toujours autant de temps qu’il n’auront pas passé à écouter cette prof au bord du suicide. C’est déjà ça.
C’est toujours au bord du suicide, les profs de Français. C’est pour ça qu’on les aime. Enfin, c’est pour ça qu’on les aime après. C’est toujours ça.
Mais je n’ai pas d’imagination en ce moment, aussi ne puis-je pas concevoir que d’autres en aient, et quand je sors acheter ma dose quotidienne de nicotine, je ne remarque pas que c’est l’heure de la fin des cours. Les queues devant les boulangeries ont beau faire le tour de la ville, je ne comprends pas non plus pourquoi 2 mioches mal habillés me suivent en pouffant.
Pour moi, ce ne sont que deux bébés-trucs qui, au lieu de me suivre, feraient bien de traiter leurs problèmes cutanés et vestimentaires. Et même quand ils pouffent encore, je me dis qu’il est urgent qu’ils pensent à muer, ces crevards.
Honnêtement, les jeunes, c’est du ridicule sur pattes quoi.
Pour eux, je suis une chose qu’ils ne comprennent pas et qu’ils vont suivre jusqu’au supermarché pour voir si elle se nourrit; et de quoi. Si elle utilise une carte bleue, ou si elle sort un billet de 20 d’une énorme liasse cachée dans un journal. Rapport à la prostitution suspectée et les séries américaines, tout ça.
Pour moi, ils sont une présence gênante, j’aimerais être tranquille maintenant. Et toujours.
Pour eux, agités devant l’éternité, derrière mon geste, il y a une danse; derrière un bruissement d’ailes, un oiseau. Derrière ma distance, un mystère. En me suivant un peu en retard, ils font freiner les voitures sur le passage piéton, et ça klaxonne. Ils sont les fanfarons de cette fanfare, ils entendent l’orchestre pendant que j’ai seulement mal à la tête.
Sérieux, les jeunes, c’est la tannée quoi.
Voilà qu’ils gambadent en me dépassant maintenant. Je ralentis. Je suis curieuse de savoir comment ils vont mener la fin de leur enquête.
Ils ralentissent aussi.
Soit.
Je m’arrête.
Ils s’arrêtent aussi.
Soit.
Je me demande si en me mettant à pisser cul nu en récitant les capitales du monde et en me curant le nez, là tout de suite dans la rue, je les verrais me singer aussi bêtement que leur âge l’impose.
Je m’arrête complètement en me disant que le peu de capitales qu’ils connaissent sont celles qu’on voit sur les t-shirts qui les <3. Et qu’ils ne savent même pas que c’est pas une capitale, New York Empire State of Mind.
Start spreading the news, dumbass, que j’me dis. Et je me fige quand même vers eux, le menton un peu relevé, l’air passablement provocatrice.
Le truc, c’est que moi, je suis pas en train de me gondoler avec mon meilleur super camarade d’ami de classe, mais toute seule, toute seule, et qu’immobile comme ça, je m’ennuie sur les bords et puis j’ai peur que le tabac ferme; j’ai envie de finalement m’en foutre et de repartir de plus belle. J’imagine qu’ils s’en foutront, eux aussi, j’imagine qu’ils ne savent même pas s’ils pensent vraiment quelque chose de la situation, j’imagine que ce que j’ai appris sur le cerveau des adolescents ne m’engage pas à les aimer davantage, j’imagine que mon manque d’imagination m’éloigne d’eux, de leur monde absurde de possibilités et de curiosité. J’imagine que je sais que je m’aime pas quand je me rappelle l’époque où j’étais comme eux. Où mes congénères enlevaient des ailes aux mouches pour voir si elles pouvaient toujours voler, et où les filles brisaient les garçons pour voir s’ils pouvaient.... toujours enlever les ailes des mouches.
Alors comment les aimer, eux? -Bon, on fait quoi maintenant?
Bien entendu, ils feignent ne pas m’avoir entendue. Ils arrêtent de parler, se regardent en écarquillant leurs globes oculaires grand comme ça, comme ça, et essaient de reprendre une conversation tout en gloussant, l’air de pas être là et de pas faire ce qu’ils font, ces trous du cul.
-Evidemment vous faites comme si vous ne m’aviez pas entendue. Super. Mais, arrêter de parler, rouler vachement des yeux et reprendre une conversation ayant pour sujet «heu t’sais, ouais t’as vu tu t’souviens d’ailleurs », ça trompe pas son homme, hein.
Ils daignent tourner la tête vers moi.
-Voilà. Bon. Donc, on fait quoi, maintenant, disais-je.
Tout répéter, convaincre, être patiente. Ca vous fait perdre un temps, ces animaux là... Un calvaire.
-Bin.
-Bin?
-Bin rien.
-Comment ça, rien?
-Chais pas, rien.
-Rien, c’est pas possible.
-...
-Je dis pas qu’on doit décider d’un resto où manger ensemble ou quoi, je préférerais mourir que de connaître vos goûts culinaires, mais on doit faire quelque chose entre continuer la filature ou l’arrêter. C’est de ça que je parle.
-La fila quoi?
-La filature.
-De quoi?
-Vous savez ce que «filature» veut dire.
-Bin.
-Bin?
-Bin nan.
-Alors pourquoi en faites vous une?
-Nous?
-Oui, vous. Allô. Youhou. Wake up. Vous me suivez = vous faites une filature.
-Ah. Aaaaah, ok.
-Oui, «ah». On devrait jamais avoir le droit de faire quelque chose dont on ne connaît même pas le nom. C’est comme la sociologie. C’est ridicule, votre vie, sérieux, ça me fait pitié. (Je dis «pitié» comme si le mot pesait plus lourd que les autres, dans ma bouche, au fait, et qu’il me fallait faire peser plus lourd chaque lettre)
-Bin au moins on sait qu’une fille à sa fenêtre en plein milieu de la journée c’est une entretenue hein.
-Mais, ça, c’est pas une action que VOUS faîtes.
-Bin.
-Bin non. Cause que vous, si vous vouliez justement être entretenus, faudrait déjà que vous soigniez cette vilaine peau, comme dit lot’, et que vous achetiez des jeans à votre taille. Sans ça, je donne pas cher de votre carrière.
-Ouais d’accord ouais. ... Quel «ot’»?
-Non mais ok, ok, je suis la vieille, vous êtes les jeunes, ok, mais y’a quoi comme action que vous faîtes dont vous connaissez le nom? Hein?
Je sors une cigarette, rapport au fait que finalement, oui, j’ai envie d’entendre absolument leurs arguments hyper cons. En fumant.
-Genre marcher ça fait la marche?
Il sort son briquet.
-Genre ça ouais, j’dis, en attendant que la nicotine rentre.
-Bin...
-Bin?
-Enculer, ça fait la sodomie.
-Super, et sucer, ça fait la fellation, d’accord. Mais à part des trucs de morveux prépubères?
-...
-Et t’as déjà enculé quelqu’un? Tu t’es déjà fait sucer? Tu parles que de trucs que tu fais pas? Tu veux qu’on cause du yoga en 69 en saut à l’élastique au Pérou peut-être?
Et j’imagine, en le disant, que ça n’existe pas, mais qu’il faudrait que j’en parle à 2,3 personnes tout de même.
Il rougit et sort un briquet, va pour l’allumer et n’y arrive pas. Il se trouve qu’il tremble. J’allume ma cigarette toute seule avec son briquet à lui, et ça m’énerve d’imaginer que je rentre là dans une scène de grande dadame face à ces petites crottes de peteux. Faut que j’arrête de fumer, sérieux. Faut qu’ils grandissent, please.
-Du genre, par exemple, je sais pas hein, je dis ça au hasard, peut-être quelque chose comme «réfléchir» ça fait «la réflexion», ou, mettons, «manger autre chose que des hamburgers» ça fait «une peau qui rend présentable» non?
-Mais vous êtes une entretenue alors? Vous fumez vachement bien. -Mais, c’est vrai que les ados ils leur faut beaucoup de temps pour comprendre qu’on a changé de sujet?
-Les entretenues, elles répondent jamais directement aux questions.
-Personne ne répond jamais directement aux questions.
-Pourquoi?
-Bin...
-Ah vous dites «bin» vous aussi?
-Non mais. Parce que sans ça, on s'ennuierait à mourir. Sans ça, je devrais vous répondre que, non, je suis pas une entretenue, et votre f.i.l.a.t.u.r.e. perdrait toute raison d’être, et alors vous vous sentiriez aussi cons que vous l ‘êtes et on n’aurait plus aucune raison de se parler alors que bon.
-Bon?
-Bin. Bon. On se parle tous toujours un peu sur des malentendus. C’est joli.
-...Ah ouais.
-Non mais attendez on n’est pas obligés de parler. C’est vous qui m’avez suivie.
J’écrase ma cigarette. Avec mon pied, même.
-Parfait, je crois qu’on a atteint la fin de notre conversation. On peut maintenant se dire au revoir et retourner à nos occupations. Vous, le biactol, moi, les capotes, tout ça tout ça, quoi.
-...Vous écrasez vachement bien votre cigarette.
-...
-Un ange passe.
-(m’étouffant) Non! on dit encore «un ange passe» à votre âge? Arrêtez!
-Quoi notre âge?
-Quoi notre âge, ouais? (Là c’est le deuxième boutonneux qui parle, et pour la première fois).
-Bin, votre âge quoi. Pourquoi t’as rien dit jusqu’à maintenant, toi?
-Il aime pas parler.
-Ah je vois. T’as décidé qu’il aimait pas parler parce que toi t’aimes parler. Du coup il parle jamais et quand il parle tu dis qu’il aime pas ça comme ça, toi tu peux..
-(me coupant)N’importe quoi. N’IMPORTE QUOI.
-N’IM-POR-TEUH-QUOI (Là c’est le deuxième boutonneux qui parle pour la deuxième et finalement seconde et donc dernière fois)
Et ils partent. Je fais demi-tour, je me rappelle même plus vraiment ce que je devais acheter absolutment avant une certaine heure. De la vodka? Ils m’ont fatiguée. Est ce possible? Ils m’ont réellement fatiguée. Ils reviennent, tiens, d’ailleurs, tant qu’à faire, les bougres.
-Ouais, bin, on voulait vous dire que, on n’est pas si des bébés que ça vu que vous nous parlez comme à des demeurés.
Dit-il en se balançant sur ses pieds et en tripotant ses boutons. Et sa mèche.
-Ok. Cette phrase n’a absolument aucune syntaxe, mais j’vais faire comme si je l’avais comprise.
-On n’est pas des bébés. On n’est pas des demeurés.
-J’ai pas dit ça.
-Ouais mais bon.
-Ok, pas de problème.
-Non mais on a bien vu que vous nous preniez pour des bébés.
-...
-Bin, quoi? C’est pas vrai p’t’être?
- Je sais pas. J’en sais rien. Vraiment, je sais pas.
- Bin demandez nous.
-Demander quoi?
-Si on est des bébés.
Voilà que je ressors une cigarette.
-Ok. Heu.Voyons... Ah. Ok: Est-ce que vous avez déjà arraché des ailes à une mouche?
-Pfff, quel rapport?
Il ressort son briquet. L’autre est toujours à l’écart.
-Rapport au côté bébé.
-Pfff, bin ouais.
-Et Pfffff. Donne moi ton feu. Et re-Pfffff.
J'allume ma cigarette avec son bic et cette fois, oui, clairement, pas de pitié, je me le range dans ma poche à moi.
-Ok quoi? C’est quoi le problème, quel rapport?
-Le rapport c’est «Pourquoi faire?»
-Pourquoi faire quoi?
-Rhaaaaa, pourquoi faire «arracher des ailes à des mouches» Einstein!
-Bin pffff.
-Pfff, quoi?
-Pour voir si elle volait, tiens.
-Cause que tu penses que si une mouche qui passe son temps à voler, quand tu lui enlèves ses ailes, tu peux enfin réaliser qu’elle avait des ailes pour voler, c’est ça?
Je ris d’une façon qui peut être un peu méprisante, c’est vrai.
-Quoi?
-Quoi, quoi?
-Bin, la mouche trouduc.
-Bin j’voulais voir.
-Ce que tu savais déjà?
-Bin.
Ras le bol des «bin». Alors, oui, Bébés. Bébés Cadum. Rejetons. Boutonneux. Puceaux. Castra. Petites bites. Frimeurs. Baltringues. Oui.
-Non mais, j’ai juste enlevé les ailes pour voir si ... ... si ça marchait. Je sais pas.
-Tu vois toi même en le disant que c’est ridicule et que ça n’a pas de sens.
-Mais je veux pas vous vexer!
-Mais, je suis pas une mouche!
-Non mais je veux pas que vous pensiez que... tout ça.
-Je pense rien. Merci pour le briquet. A bientôt.
-Quoi?
Je pars, un peu, en essayant de me rappeler où est le supermarché et en me disant, pour plus tard, que je ne parlerai plus jamais à quelqu’un dans un quartier qui n’est pas le mien.
Pour ne pas oublier ce que je devais faire.
Que je ne parlerai plus jamais à quelqu’un qui a encore des boutons. Pour ne pas oublier qui nous sommes.
Les petits morveux me dégoûtent.
On tape sur mon épaule.
-Oui. («oui» très lassé, hein)
-Vous êtes formidable.
-Super.
-Non mais vous avez quel âge?
-Comment ça. Ho. Ca vous regarde pas. J’en sais rien.
-Vous avez 20 ans non? C’est sûr. Vous avez 20 ans. 21?
Ma tête formule des trucs, des idées, des pensées aussi, je sais jamais vraiment quel âge j’ai, dans la vie, je suis toujours à 2,3 ans d’écart de mon certificat de naissance. Mais ça, je sais que non, j’ai pas 20 ans, non. «T’as vu mon foie», j’ai envie de lui dire. Et finalement, je lui réponds:
-Non. Non, j’ai 29 ans. Ou 28. Je sais plus.
-N’importe quoi.
-Si, si, je suis née en 82.
Silence de cimetière.
-Bon, ça va, 82 de 1900 hein. Je suis pas en talc non plus, ho.
-Ouais mais 82 quand même. Je vous crois trop pas. Vous avez 24 ans! Mais oui, 24 ans.
-Comme tu voudras.
-...
-...
-Si c’est pas une réponse d’entretenue, ça.
-Oh, dégage. Et pour de bon, là. Allez. Ouste.
Mais j’ai ri quand même, soulagée d’entendre enfin quelque chose d’un peu perspicace dans sa bouche.
Il m’a suivie jusqu’au tabac. Il se cachait derrière des brindilles. Il laissait voir ses yeux malicieux. Malins? Son ami était rentré. J’ai vu son ombre avant de passer la porte. Et, il regardait à ma fenêtre pendant l’explication de texte de Flaubert le lendemain. Il était le seul à ne pas mortellement s'ennuyer.
Les heures passent trop lentement pour eux, et les années trop vite. Pour moi.
Si derrière lui, je devrais voir un homme, peut-être que derrière moi, il voit une gosse. C’est possible. Ca a tellement d’imagination, à c’t’âge là, ces imbéciles.
Il a laissé un mot, à la concierge, un jour plus tard. Ca disait «Hey Missise Robinson Ouide Like Too Now a Liteulle Beat Of You files»
Il y avait un point de marqué, pour la culture, mais un point de perdu pour l'écriture. Anne Bancroft aurait peut-être pu trouver à ces fautes d'orthographe une nonchalance attrayante.
Il se trouve que Anne Bancroft est morte.
Et pas moi. J’ai un début de ride sur le front, j’ai vu ça ce matin, je sais que c’est à cause de mon étonnement perpétuel et de ma perplexité quotidiennement passagère. Je le sais. Il n' y pas d’autre explication, j'imagine.
-maispastrop-
Inscription à :
Articles (Atom)